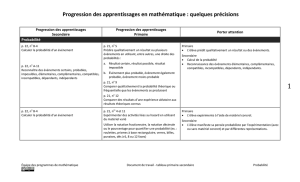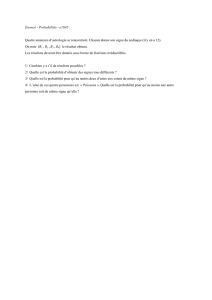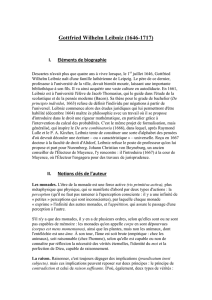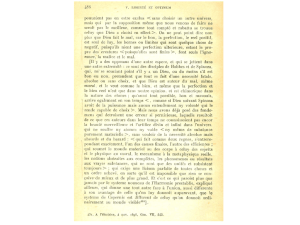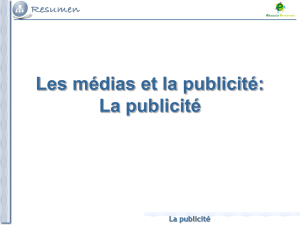Vincent SULLEROT - Bibliothèques

Université de Montréal, 30 septembre-2 octobre 2004
Colloque « G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain (1704-2004) »
Vincent Sullerot
(Université Paris IV – Sorbonne)
La naturalisation du probable
Une réforme conceptuelle dans les Nouveaux Essais de Leibniz
• Nouveaux Essais sur l’entendement humain, livre IV, chapitre
XV
, § 1
Réf. : A VI
VI
457-458 (éd. J. Brunschwig, Paris, GF-Flammarion, 1990, p. 361-362).
N. B. : le texte et la variante sont ceux de l’édition de l’Académie ; l’orthographe a été
ici modernisée.
Chapitre
XV
De la Probabilité
§. I. PHILAL. Si la démonstration fait voir la liaison des idées, la probabilité
n’est autre chose que l’apparence de cette liaison fondée sur des preuves où l’on ne voit point
de connexion immuable. §. 2. Il y a plusieurs degrés d’Assentiment depuis l’assurance
jusqu’à la conjecture, au doute, à la défiance. §. 3. Lors qu’on a certitude, il y a
intuition dans toutes les parties du raisonnement, qui en marquent la liaison ; mais ce qui me
fait croire est quelque chose d’étranger. §. 4. Or la probabilité est fondée en des conformités
avec ce que nous savons, ou dans le témoignage de ceux qui le savent.
THÉOPH. J’aimerais mieux de soutenir qu’elle est toujours fondée dans la vrai-
semblance ou dans la conformité avec la vérité : et le témoignage d’autrui est encore une
chose que le vrai a coutume d’avoir pour lui à l’égard des faits qui sont à portée. On peut
donc dire que la similitude du probable avec le vrai est prise ou de la chose même ou de
quelque chose étrangère. Les Rhétoriciens mettent deux sortes d’arguments : les artifi-
ciels qui sont tirés des choses par le raisonnement, et les inartificiels qui ne se fondent
que dans le témoignage exprès ou de l’homme ou peut-être encore de la chose même. Mais
il y en a de mêlés encore, car le témoignage peut fournir lui-même un fait qui sert à
former un argument artificiel.
19 d’étranger. | THÉOPH. J’ai déjà dit que la probabilité est fondée dans la similitude avec la
vérité barré | §. 4. Or L
1

Colloque NE – Montréal, 30 sept.-2 oct. 2004
1
Avertissement : le texte qui suit est une version à peine remaniée de la communication
donnée au colloque ; il en conserve donc largement le caractère oral.
I. Le problème et la méthode : le probable dans les Nouveaux Essais
1. La raison du lieu et le choix d’une lecture interne
La question du probable chez Leibniz est une question « embarrassée ». Leibniz
formule trop souvent le desideratum d’une logique du probable, ou tout au moins d’une
théorie des degrés de probabilité, pour que l’on s’autorise à l’ignorer purement et
simplement ; simultanément, il semble avoir trop peu avancé ce projet pour qu’il soit possible
d’en traiter sérieusement ex professo. Si l’on s’obstine pourtant à poursuivre les linéaments de
cette question dans son œuvre, il apparaît que les Nouveaux Essais sont un lieu d’élaboration
majeur, peut-être le principal, d’une théorie du probable et de la connaissance probable.
Avant de tenter une présentation synthétique d’un aspect de cette réflexion,
relativement dispersée dans le texte des NE, il convient donc de se demander pourquoi il
fallait que ce fût ici, à l’occasion de ses « remarques » ou « observations » sur l’Essay de
Locke, que Leibniz réunît la plus grande partie de ses considérations sur cette question – en
termes leibniziens : pourquoi ici plutôt qu’ailleurs, car on sait bien que si « c’est partout
comme ici », deux textes de Leibniz ne diffèrent pourtant jamais solo numero. Cette question
initiale de la raison du lieu, simplement circonstancielle en apparence, pourrait bien nous
aider à saisir la signification d’ensemble de cette théorie en l’inscrivant dans son contexte
propre.
Cette suggestion appelle comme son corrélat un choix méthodologique : celui d’une
lecture interne des NE, qui tire sa substance de ce seul texte. On ne s’autorisera à en sortir
(pour aller ailleurs dans le corpus leibnizien) que dans le but d’éclairer ou de développer un
élément des NE eux-mêmes, et non pour trouver ailleurs une réponse aux questions que
poseraient les NE, ou pour poser aux NE des questions qui ne sont pas les leurs.
Cette option méthodologique est sous-tendue par une hypothèse exégétique relative au
statut des NE au sein du corpus leibnizien, hypothèse selon laquelle l’économie du texte des
NE obéit à une relative clôture problématique. Elle n’implique pas nécessairement de clôture
conceptuelle ; encore moins, bien sûr, de clôture génétique : on peut, et il faut souvent aller
chercher ailleurs des éléments qui rendent intelligible le texte des NE, l’origine et le sens de
certains termes et de certains énoncés. On peut aussi trouver ailleurs des éléments qui rendent
problématiques certaines thèses ou formules des NE. Mais si l’on veut comprendre les NE au

Colloque NE – Montréal, 30 sept.-2 oct. 2004
2
seul plan des problèmes qui y sont posés et du traitement qu’ils y reçoivent, l’Essay de Locke
et les NE devraient en principe suffire.
2. Le problème : probabilité et connaissance (du) probable
Ces contraintes formelles étant explicitées, reste à donner une première formulation de
notre problème. J’ai déjà mentionné l’énoncé, récurrent chez Leibniz, du desideratum d’une
logique du probable. Quelle qu’en soit la forme, on sait qu’il s’agit en général d’un projet qui
vise à doter l’esprit humain de la pièce maîtresse d’une méthode spécialement adaptée à la
connaissance des vérités contingentes. On sait aussi que la logique et la métaphysique de
Leibniz assignent à ces vérités une nature à part ; cette nature, d’un seul et même mouvement,
élève en droit ces vérités à une intelligibilité rationnelle complète, et soumet en fait la
connaissance effective de ces vérités à des exigences plus qu’humaines. Il est donc essentiel à
la pensée leibnizienne d’élaborer, sur le plan épistémologique, des procédures qui permettent
une appréhension concrète de ces vérités par la raison humaine. C’est ici qu’intervient le
probable, comme une norme épistémique générale propre à régler ces procédures, mais aussi
comme un concept qui s’y révèle directement opératoire – un concept, ou plutôt une famille
de concepts qui lui associe notamment la certitude morale, la présomption ou la conjecture.
Cet effort théorique de Leibniz est cependant toujours fragmentaire. Son apparente
disparité conceptuelle, et sa dispersion matérielle bien réelle, obligent à s’interroger sur sa
véritable unité. On est tout naturellement porté, pour ce faire, à poser la question de l’exacte
signification donnée par Leibniz au concept de probabilité, soit, pour parler comme Leibniz,
de la nature du probable. C’est à cette seule question que sera consacré cet exposé, où
j’essaierai de décrire par quelle réforme conceptuelle Leibniz restitue au probable ce qu’il
tient pour son unité et son fondement réels. Les résulats de cette enquête permettraient par
ailleurs, ce que l’on ne fera pas ici, de mieux comprendre les fonctions épistémologiques du
probable, autrement dit les usages qui lui sont assignés dans le cadre de la théorie de la
connaissance probable qui se dessine progressivement au fil des pages des NE. Il s’agirait
alors de mieux cerner le statut ou le type de cette connaissance, c’est-à-dire de la situer au
sein des différents régimes de perception distingués par Leibniz, et d’apprécier les parts
respectives que prennent l’art et la nature à sa mise en œuvre.
3. Une stratégie : du réseau des réflexions probabilistes au commentaire du chap.
XV
Un tel programme serait trop ambitieux, et je me concentrerai exclusivement sur le
problème de la nature du probable. Il faut cependant situer ce problème en décrivant

Colloque NE – Montréal, 30 sept.-2 oct. 2004
3
brièvement le réseau de pensées des NE dont il constitue un nœud décisif, pour mieux en faire
percevoir la portée.
Il s’agit d’une part des différents cas particuliers d’usages du probable dans les NE :
les concepts et les arguments probabilistes, hors du cadre où ils apparaissent thématiquement,
sont en effet opératoires en de nombreux autres lieux. Leibniz les mobilise en particulier pour
défendre les pouvoirs de la raison humaine contre les défis du scepticisme, qu’il s’agisse des
preuves de la vérité de la religion chrétienne (ou motifs de crédibilité pour la foi humaine), de
la défense des vérités qui sont de foi divine, ou encore des preuves de l’extériorité – preuves
de l’existence de la res extra et de la réalité des phénomènes. Je laisserai a fortiori de côté les
champs déjà traités ici par d’autres intervenants, tels que la théorie des espèces au livre III, la
méthode des hypothèses présentée par F. Duchesneau ou encore l’art de disputer traité par
M. Dascal. L’ensemble de ces usages particuliers permet de constater comment opère
effectivement la théorie de la connaissance probable.
D’autre part, et concernant cette fois le traitement thématique du probable, je ne
m’attarderai pas sur certains aspects pourtant très importants des réflexions de Leibniz. J’ai
déjà évoqué le problème du statut de la connaissance probable et de sa position au sein de la
gradation des types de perception, entre le régime empirique des bêtes et le régime de pure
raison dont est capable l’esprit humain. Mentionnons enfin d’autres éléments plus étroitement
liés au problème de la nature du probable, déjà relativement connus
1
ou développés ailleurs
par Leibniz au moins autant que dans les NE, qu’il s’agisse de la critique du probabilisme
théologique ou de la question du fondement logico-métaphysique du probable en termes de
degré de possibilité.
Le but ici est plus modeste, et la stratégie est simple : clarifier la nature du probable en
proposant un commentaire du début du chap.
XV
du livre IV (cf. texte supra). En restreignant
ainsi l’objet de mon attention, j’espère pouvoir examiner dans son détail un échantillon du
dialogue noué sur ce point avec Locke. Une petite originalité de ce commentaire : je me
donnerai la liberté de parcourir ce passage dans le désordre, et plutôt selon une lecture
régressive, de la fin au début de l’intervention de Théophile, espérant ainsi mieux mettre au
jour ses conditions d’intelligibilité.
1
Notamment par les travaux de Marc Parmentier : L’estime des apparences. 21 manuscrits de Leibniz
sur les probabilités, la théorie des jeux, l’espérance de vie, Paris, Vrin, 1995 ; « Concepts juridiques et
probabilistes chez Leibniz », Revue d’Histoire des Sciences, 46, 1993, p. 439-485.

Colloque NE – Montréal, 30 sept.-2 oct. 2004
4
4. Le cadre conceptuel de la réforme leibnizienne
Concernant la nature du probable, on pourrait réunir les interventions de Leibniz dans
les NE sous le titre de réforme conceptuelle, réforme dont l’orientation principale se
comprend comme une naturalisation du probable. On peut ici parler de réforme au sens où il
arrive à Leibniz de définir la reformatio comme un « changement » fondé en raison ou
« accompagné d’un motif d’amendement » (mutatio cum praetextu emendandi)
2
. Cette
réforme, on va le voir, s’accompagne d’un déplacement terminologique qui conduit du
« probable » au « vraisemblable ». Pour la comprendre, il convient de porter la plus grande
attention à l’usage que l’on fait dans le commentaire de notions empruntées à l’histoire
ultérieure et à la philosophie contemporaine de la probabilité.
Je voudrais en particulier mentionner, pour la mettre à distance, la dualité du concept
de probabilité telle que l’a décrite Ian Hacking en 1975 dans son Émergence de la
probabilité
3
, dualité conceptuelle à laquelle est subordonnée son interprétation de la pré- ou
protohistoire philosophique de la probabilité classique, elle-même menée sous les auspices
d’une généalogie « hégéliano-foucaldienne ». Le premier versant de ce concept dual est la
probabilité « statistique », qui s’applique aux lois des processus aléatoires, soit la tendance
présentée par certaines techniques aléatoires (chance devices) à produire des fréquences
stables. Son second versant est constitué par la probabilité « épistémique » (epistemological),
qui sert à évaluer les degrés de la croyance raisonnable, garantie par certains éléments
d’évidence factuelle. Cette division constitue par ailleurs une version possible du partage
entre probabilité objective et probabilité subjective.
Cette distinction, comme Hacking le mentionne lui-même, vient en ligne directe de
l’article séminal publié en 1945 par Rudolf Carnap : « The two concepts of probability »
4
.
Carnap, recherchant une « explication » du « concept préscientifique de probabilité »,
distingue entre une « probabilité
1
», le « degré de confirmation » logique, et une
« probabilité
2
», la fréquence relative observée dans une longue suite, ou fréquence
statistique. Or cette distinction permet à Carnap de défendre la compatibilité de la probabilité
« logique » (probabilité
1
) avec le programme de l’empirisme, pour faire de cette probabilité le
2
[Vorarbeiten zur Characteristica Universalis. Definitionentafel], A VI
II
508, 2
e
moitié 1671-
printemps 1672 ? (où Leibniz suit l’ordre de l’Essay… de John Wilkins).
3
The Emergence of Probability. A philosophical study of early ideas about probability, induction and
statistical inference, Cambridge, Cambridge University Press, 1975 ; réimpr. 1978 ; L’émergence de la
probabilité, trad. Michel Dufour, Paris, Seuil, 2002.
4
Philosophy and phenomenological research, 5, 1945 ; reproduit avec quelques légers changements in
R. Feigl & M. Brodbeck (dir.), Readings in the philosophy of science, New York, Appleton Century Crofts,
p. 438-451 ; trad. R. Blanché in R. Blanché, La méthode expérimentale et la philosophie de la physique, Paris,
A. Colin, 1969, p. 355-367.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%