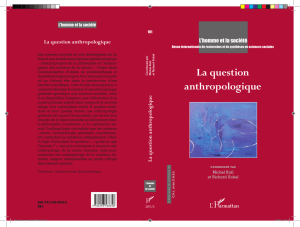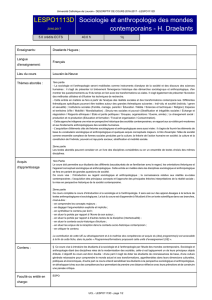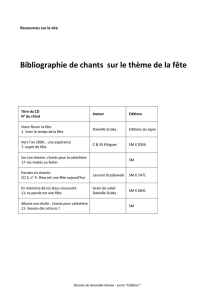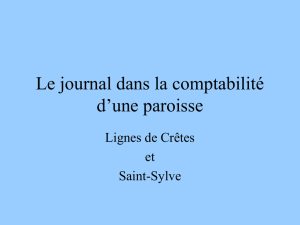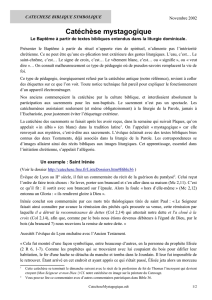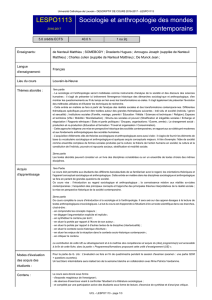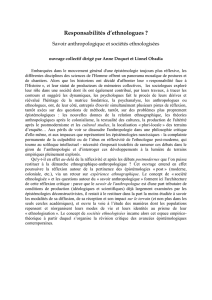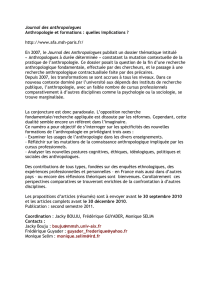Crise anthropologique et catéchèse La fin d`un consensus

1
Crise anthropologique et catéchèse
La fin d’un consensus humaniste
Par Joël Molinario1
Introduction :
Crise anthropologique et catéchèse : problématique
L’action pastorale de l’Eglise catholique s’est largement inspirée pour son action
catéchétique des modèles anthropologiques des années 60. Se démarquant du
modèle de catéchisme néo-scolastique2 et des modèles kérygmatiques3 l’action
catéchétique cherchait un modèle lui permettant de rejoindre l’expérience
humaine fondamentale et de recueillir les valeurs communes afin de les traduire
dans le langage de la foi. Le souci de l’homme devenait premier, pas seulement
par un intérêt pédagogique mais par une préoccupation fondamentale. Cette
perspective accompagna4 et fut confirmée par la publication de Gaudium et
Spes. « Croyants et incroyants sont généralement d’accord sur ce point : tout sur
terre doit être ordonné à l’homme comme à son centre et à son sommet »5. La
détermination de l’Eglise à rejoindre les hommes de ce temps, à partager leur
humanité et à observer les signes des temps correspondait parfaitement à
l’attitude catéchétique que promouvaient les nouveaux modèles
anthropologiques.
Ce déplacement dans les modèles catéchétiques reposait sur une théologie de
la corrélation et de l’expérience, dont les points d’appuis se trouvaient chez de
grands théologiens du XXè siècle : Rahner, Tillich, Schillebeeckx et Bouillard
pour les plus connus. La vie de l’homme comme question et comme expérience,
attendait la foi comme réponse et la double herméneutique de la vie et de la foi
fournissait le terrain privilégié de la pratique catéchétique.6
1 Théologien de la catéchèse, Maître de Conférence au Theologicum, directeur adjoint de l’Institut supérieur de
pastorale catéchétique (ISPC). Le sujet de cet article a été pour la première abordé dans un atelier du Congrès de
la Société internationale de théologie pratique (SITP) à Beyrouth, le 6 mai 2012.
2 Sur la période néo-scolastique du catéchisme, voir E. Germain, Jésus-Christ dans les catéchismes, coll. Jésus et
Jésus-Christ, Desclée, Paris, 1986, du même auteur, Parler du salut, aux origines d’une mentalité, coll.
Théologie historique n°8. Aussi notre ouvrage, Joseph Colomb et l’affaire du catéchisme progressif, un tournant
pour la catéchèse, coll. théologie à l’université, n°15, DDB, Paris, 2009, seconde partie ;
3 Lorenzi, L’héritage du renouveau catéchétique et le caractère performatif de la parole en catéchèse, volume I,
Introduction et chapitres 1-5, Volume II, chapitres 5b-8, Conclusion générale et bibliographie, thèse pour
l’obtention du doctorat en théologie, directeur Gagey, Janvier 2007, 565p.
; Fossion, La catéchèse dans le champ de la communication, coll. cogitatio fidei, Cerf, 1991, deuxième partie ;
Cahiers internationaux de théologie pratiques (CITP), www.pastoralis.org, série Documents n°1.
4 Notamment par le lien et l’influence du Père Haubtmann (un des principaux rédacteurs de GS) sur les
responsables de la pastorale en France.
5 GS §12, édition Fides, Montréal & Paris, 1967.
6 Fossion op.cit. p.204-216.

2
Il y avait cependant un a priori non discuté qui sous-tendait ce renouveau
catéchétique : un consensus culturel et anthropologique. Ce consensus laissait
légitimement croire que des valeurs humanistes profondes liaient entre eux les
hommes et qu’une fois écarté l’obstacle d’une institution ecclésiale pesante et
d’un langage dogmatique abstrait, l’expérience catéchétique rassemblerait et
révèlerait à eux-mêmes ceux « qui croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient
pas » comme l’écrivait Louis Aragon.7 Un consensus qui faisait écrire à ce
même poète communiste en 1969 : « Tout peut changer de sens et de nature/ le
bien le mal les lampes et les voitures/…/Tout peut changer mais non la femme et
l’homme ».8
Dit autrement, les catéchistes fondaient leurs actions sur un présupposé
de valeurs et de marqueurs chrétiens qui imprégnaient la culture et étaient
encore disponibles dans des attitudes, des thématiques, des façons de se
comprendre et des désirs des jeunes du XXè siècle en occident. Les expériences
existentielles fondamentales que pouvaient faire des jeunes (partage, amitié,
pardon, liberté, solitude, vie d’équipe, relation au corps, mort et vie…) étaient
masquées dans l’Eglise par un langage, une ritualité et une institution trop
lourde pour faire éclore une vie de foi.9 Le courant anthropologique de la
catéchèse se démarquait aussi d’une trop longue habitude de présenter le
mystère de Dieu comme un en-soi, sans lien avec la vie humaine, de même les
catéchismes d’avant Vatican II avaient intellectualisé au maximum la foi en
opérant par la même occasion une coupure entre nature et surnature.10 L’action
catéchétique consistait alors, premièrement à faire émerger cette humanité
fondamentale et deuxièmement à révéler cette humanité à elle-même par le
langage de la foi (évangile, sacrements, dogmes).11
Le présupposé humaniste sur lequel s’appuyait la catéchèse est de moins
en moins repérable. Le christianisme a contribué à façonner la culture et
l’homme moderne,12 par l’émergence du sujet (du soi13), de la conscience, d’une
7 Aragon, « La rose et le réséda », texte écrit pendant la seconde guerre mondiale.
8 Aragon, Les poètes, coll. poésies, Gallimard, Paris, 1969,
« Ceci illustre parfaitement ce que Rémi Brague nomme l’humanisme exclusif, 4è étape de la formation
théorique de l’humanisme occidental. Un humanisme sans Dieu, mais qui selon l’auteur suppose les autres
humanismes. Brague, Le propre de l’homme, sur une légitimité menacée, coll. Bibliothèque des savoirs,
Flammarion, Paris, 2013, p.14-22.
9 Jean-Marie Swerry, dir, Transmettre la foi est-ce possible ? Histoire de l’aumônerie catéchuménale, 1971-
1997, coll. Signes des temps, Karthala, Paris, 2009, 299p.
10 Mgr Coffy, « Théologie et anthropologie », dans la revue Catéchèse n°32, pp.319-332 ; aussi Molinario, « Le
contenu de la foi et les catéchismes », dans La catéchèse et le contenu de la foi, Moog, Molinario (dir), Coll.
Théologie à l’université, pp.31-48.
11 Le titre d’un livre de Bagot donne bien l’axe catéchétique de cette époque : Dieu, enfin ! Bagot, Dire Dieu
enfin, Desclée de Brouwer, Paris, 1991, 168p. Voir aussi les semaines internationales de catéchèse de Manille et
Medellin dans les Cahiers Internationaux de Théologie Pratique (CITP), www.pastoralis.org, série document
n°1. Mon article, « Les semaines internationales sur la catéchèse et la mission (1956-1971) », dans Esprit & Vie,
n°229, novembre 2010, pp.2-11.
12 « La philosophie occidentale moderne pourrait en effet se définir comme une tentative de retraduire les grands
concepts de la religion chrétienne à l’intérieur d’un discours laïc, c’est-à-dire d’un discours rationaliste. D’une
certaine façon, la déclaration des droits de l’homme […] n’est bien souvent pas autre chose que du christianisme
laïcisé ou rationalisé. » Ferry, (dialogue avec Gauchet) dans Le religieux après la religion, biblio essais, Livre de

3
possible conception de l’égalité et de la fraternité, par la croyance dans le
progrès de l’humanité et son accès à la raison universelle. L’ex-culturation
actuelle du christianisme réalise son œuvre dans un autre sens.14Ainsi, nous
pouvons observer depuis 50 ans, plusieurs ruptures dans les conceptions
anthropologiques qui habitent la culture occidentale.
Une rupture philosophique : A l’heure même où l’Eglise catholique
reconnaissait des valeurs humaines positives et se rapprochait de tous les
hommes de bonne volonté, (GS) la philosophie opérait une entreprise de
déconstruction radicale des présupposés du sujet moderne mettant à mal
l’humanisme15 que l’Eglise pensait rejoindre dans sa quête d’ouverture au
monde.16
Une rupture anthropologique : Si le déconstructivisme ne toucha d’abord
qu’une élite intellectuelle et artistique,17 les penseurs comme Foucault et Derrida
restent les références d’un mouvement profond de remise en cause de
l’humanisme qui dépasse largement le strict domaine de la philosophie pour
pénétrer toutes les disciplines attenantes à l’anthropologie. Cela créée
aujourd’hui un éclatement complet du consensus humaniste et ouvre une
véritable crise anthropologique que nous n’avons pas fini de devoir comprendre,
évaluer et affronter. Si de nombreux observateurs ont parfaitement montré
poche, 2004, p.23. Luc Ferry développe les mêmes idées dans L’homme-Dieu ou le sens de la vie, essai, Grasset,
1996. Aussi, J.-F. Mattéi, « Le christianisme comme religion de la sortie du monde séculier », dans
Transversalités, n°123, juillet-septembre 2012, p.83-92.
13 Charles Taylor, Les sources du moi, La formation de l’identité moderne, coll. La couleur des idées, Seuil,
Paris, 1989.
14 Il ne faut évidemment pas oublier les expériences politiques extrêmes de la négation de l’homme au XXè
siècle, (Stalinisme, Nazisme, Pol Pot…)
15 La fin de l’ouvrage de Foucault, Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines, ouvre une
brèche dans le consensus humaniste : « L’homme est une invention dont l’archéologie de notre pensée montre
aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont
apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, mais dont nous ne
connaissons pour l’instant encore ni la forme ni la promesse, elles basculaient, comme le fit au tournant du
XVIIIè siècle le sol de la pensée classique, - alors on peut bien parier que l’homme s’effacerait, comme à la
limite de la mer un visage de sable. », coll. Bibliothèque des sciences humaines, nrf, Gallimard, Paris, 1966,
p.398.
16 Le mouvement de déconstruction philosophique de l’humanisme a été anticipé par les artistes, cf François
Chevallier, La société du mépris de soi, de l’urinoir de Duchamp aux suicidés de France télécom,
Gallimard,2010. Bruno Pelletier, La crise catholique, religion, société, politique en France (1965-1978), Petite
bibliothèque Payot, Paris, 2002, chap. 1.
17 François Chevallier, dans son essai, La société du mépris de soi… op.cit., avance la thèse suivante qui n’est
pas sans argument ; une part des mouvements artistiques du XXè fut une anticipation d’une évolution vers la
post-modernité et le mépris du sujet moderne. « Comme si le nouvel art annonçait en réalité un nouvel homme
dont Duchamp était le prototype et dont la caractéristique principale semblait bien le désir de faire table rase de
lui-même. De se débarrasser de soi. A cet égard on n’a pas assez remarqué ce fait troublant qu’au début du XXè
siècle le dadaïste Raoul Hausmann fait sa tête mécanique « pour prouver que la conscience est inutile », au
moment où John Broadus Watson, inventeur du Béhaviorisme, affirme que le fonctionnement de l’homme par
stimulus et réaction « rend inutile » le rôle de la conscience. » p.16-17 aussi, « avec l’intervention du hasard dans
les œuvres (dripping, pliages, accumulations, art cinétique, Land art, emballages, etc.) la désubjectivation battait
son plein sans que le mot puisse être encore prononcé. » p.67. Nathalie Heinich défend un point de vue assez
proche, en parlant « d’incivilités artistiques », « Incivilité du regard ou éthique de la transparence », dans
Malaise dans la civilité, Claude Habib, Philippe Raymaud, (dir), coll. Tempus essai, Perrin, 2012, p.31.

4
l’évolution culturelle vers la post-modernité,18 si notamment les textes
préparatoires au synode sur la nouvelle évangélisation d’octobre 201219 ont pris
en compte les évolutions culturelles actuelles sous l’expression de 6 ou 7
scenarii, il semble cependant qu’une crise anthropologique d’une toute autre
ampleur sourde en occident, qui remet en cause des structures élémentaires
faisant jusqu’ici consensus.
Une rupture pastorale : nombre d’acteurs de terrain constatent que les
problématiques de langages, d’institutions ou de pédagogies ne suffisent plus à
rendre compte des décalages culturels rencontrés chez les jeunes et les
catéchisants. Eviter les lourdeurs ecclésiales, mettre en place une bonne
pédagogie ne résout pas les problèmes de transmission. Le problème de la
transmission, c’est ce qui est transmis. Les valeurs et les expériences chrétiennes
ne sont plus seulement à recueillir elles ont à être proposées. Bref, l’à priori
transcendantal rahnérien ne fonctionne plus.
Il convient donc, dans un premier temps, de prendre la mesure de
l’ampleur des mutations anthropologiques en cours.20Une fois ce diagnostic
posé, dans une seconde partie nous montrerons que ces mutations n’affectent
pas seulement les cercles restreints des philosophes et des anthropologues mais
la culture dans son ensemble d’où une remise en cause des modèles théoriques
et pratiques de la catéchèse et de l’action évangélisatrice de l’Eglise. Ceci laisse
augurer des tâches nouvelles pour la réflexion catéchétique.
1- Les lieux de la crise anthropologique
« - …Si la cour voulait simplement nous rappeler, la définition de l’homme,
la définition ordinaire, enfin celle dont on se sert…
- Non dit le juge en souriant ; toutefois, cette définition légale, il faudrait
d’abord qu’elle existe. La chose est étrange peut-être, mais le fait est
qu’elle n’existe pas. » Vercors, Les animaux dénaturés, Le livre de
Poche, p.167.
18 Taylor, Le Malaise dans la modernité, tr. Charlotte Melançon, coll. Humanités, Cerf, Paris, 2005 ; Augé, Pour
une anthropologie de la mobilité, Rivages poche/ petite bibliothèque, Paris, 2012 ; Augé, Où est passé l’avenir,
coll. essais Points, seuil, Paris, 2011.
19Synode des évêques, XIIIè assemblée ordinaire, La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi,
Lineamenta , cité du Vatican, 2011, voir § 6 et Synode des évêques, XIIIè assemblée générale ordinaire,
Instrumentum laboris , La nouvelle Evangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, Cité du Vatican, §
47 à 67, site : www.vatican.va/phome_fr.htm.
20 C’est en nous appuyant sur les travaux du Groupe de recherche en anthropologie chrétienne (GRAC) de
l’Institut catholique de Paris que nous mettrons en perspective ce paysage nouveau. Le GRAC de l’ICP a été mis
en place sur l’initiative d’H-J. Gagey et rassemble des chercheurs de différentes disciplines. Le texte théorique
fondateur s’intitule : « how post-moderne we are ? ». Extrait : « Si la crise moderniste provient de
l’affrontement de la foi à la nouvelle expérience de soi du sujet moderne, on peut dire que nous sommes aux
prises avec une crise « postmoderniste » qui provient de l’affrontement de la foi avec la nouvelle expérience de
soi que fait le sujet postmoderne. Pour cette raison, le renouveau théologique dont nous avons besoin ne peut
passer prioritairement et immédiatement par un ressourcement comparable à ceux qui ont caractérisé le XXe
siècle théologique (ressourcement biblique, patristique et liturgique). En effet, pour entreprendre un tel
ressourcement, un tel « pas en arrière » prospectif, il faut disposer du « questionnaire » susceptible de guider
l’enquête. Or nous commençons à peine à déchiffrer les questions auxquelles nous nous affrontons. Nous
n’avons pas encore pris la mesure de la crise anthropologique dans laquelle nous sommes plongés et contre
laquelle nul retour en arrière ne nous prémunira. »

5
Nous allons nous arrêter sur les lieux où les mutations anthropologiques sont les
plus visibles. Nous observerons ces mutations à partir de trois axes principaux :
la différence sexuelle, le rapport homme/animal et le rapport homme/machine.21
a. Trouble dans le genre : la théorie du queer
En France, ces questions sont bien mieux connues et en parties débattues
depuis la législation sur le mariage homosexuel. Cette loi et les idées qui s’y
sont exprimées à cette occasion sont le symptôme d’une évolution de l’opinion :
une indifférence à la différence sexuelle. C’est l’avenir de la nature humaine qui
est ici en débat.22 Le phénomène le plus connu de cette crise anthropologique
actuelle a été préparé et rendu célèbre par les travaux de l’étasunienne Judith
Butler avec son livre de référence Gender Trouble23 publié en 1990 aux Etats
Unis.24
Le point de départ de Butler25 dans ses gender studies se situe au cœur de
situations d’oppression des minorités sexuelles à l’heure du développement du
SIDA et dans l’in-pensé anthropologique que cela provoque. Comment prendre
en compte et penser anthropologiquement ceux qui, méprisés, vivent comme
homosexuels, transexuels, bisexuels. Cela amène l’auteure à penser de façon
nouvelle la normativité et l’éthique des genres sexuels. En effet, si la norme
règle des vies, façonne des comportements et s’impose par la répétition, la
norme existe en fait aussi par une résistance intérieure du sujet et créée ainsi un
trouble pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette norme. Ainsi,
influencée par Derrida et Foucault, Judith Butler comprend la normativité
comme une relation de pouvoir d’une majorité sur une minorité qui impose sa
conception du genre comme une contrainte. « La signification n’est pas un acte
21 Il est tout à fait possible d’observer les mutations à partir d’autres critères : Dufour s’arrête quant à lui sur
« Dix lignes d’effondrement du sujet moderne », dans Cairn.info-inst_cp. Voir aussi, du même auteur, Il était
une fois le dernier homme, Denoël, 2012. Il s’intéresse à la problématique du nouvel homme d’après Nietzche
en passant par une critique de Sloterdijk.
22 Le débat fut déjà lancé par Habermas à propos de la question du DPI (diagnostic préimplantatoire). Habermas,
L’avenir de la nature humaine, vers un eugénisme libéral ?, nrf essais, Gallimard, 2002. Il fut relancé en France
avec le livre d’E. Dufourcq, L’invention de la loi naturelle, Des itinéraire, grecs, latins, juifs, chrétiens et
musulmans, Paris, Bayard, 2012.
23 Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, 1990.
24 Seulement traduit en 2005 (La découverte) en français. Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la
subversion, préface d'E. Fassin, La Découverte, Paris, 2005.
25Depuis de nombreux ouvrages de cette professeure de littérature comparée de Berkeley ont été publiés en
français. Humain, Inhumain. Le Travail critique des normes. Entretiens, Editions d’Amsterdam, Paris, 2005.
Défaire le genre, Editions Amsterdam, Paris, 2006.Le récit de soi, traduit de l'anglais Giving an account of
oneself par Bruno Ambroise et Valérie Aucouturier, Paris, Puf, 2007. L'État global, avec Gayatri Chakravorty
Spivak, traduit de l'anglais par Françoise Bouillot, Paris, Payot et Rivages, 2007. (titre original Who sings the
Nation-State? Language, politics, belonging, Seagull Books, 2007). Ces Corps qui comptent ; de la matérialité
et des limites discursives du "sexe", (Bodies that Matter. On the Discursive Limits of 'Sex'), Paris, Éditions
Amsterdam, 2009. Sexualités, genres et mélancolie, Campagne Première, mai 2009. Sois mon corps, avec
Catherine Malabou, Paris, Bayard, 2010. Ce qui fait une vie, Paris, Zone/La Découverte, 2010.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%