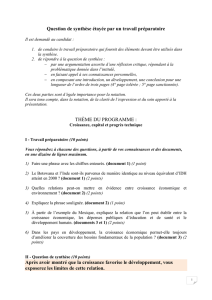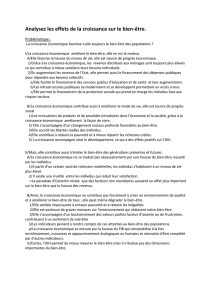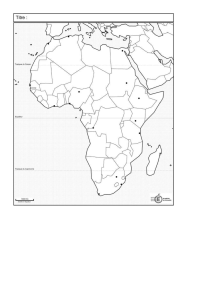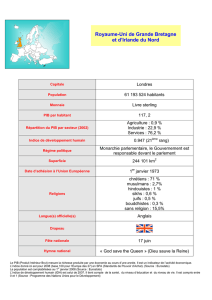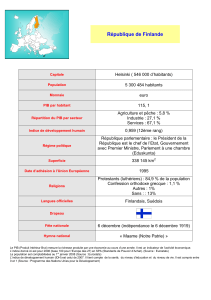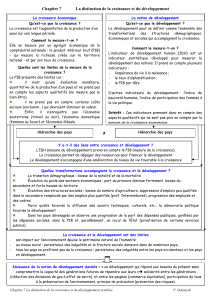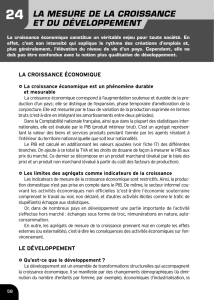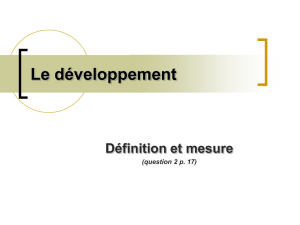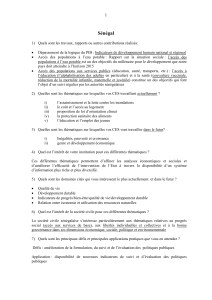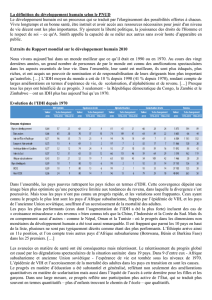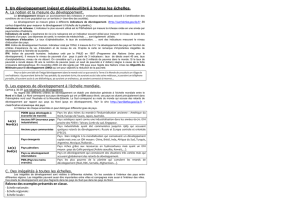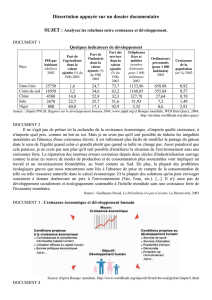LES 16 PREMIERS PAYS selon le PIB par habitant (2006), l`IDH

Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique page 51
• Dénitionetindicateurs
•Caractéristiquesetorigines
dusous-développement
•Stratégiesdedéveloppement
A - Définition et mesure du développement
Croissance : augmentation quantitative de la production, mesurée par le PIB.
Développement : phénomène qualitatif, irréversible, qui correspond à un ensemble de transformations techniques,
sociales et culturelles.
* Indicateur de pauvreté humaine
LES 16 PREMIERS PAYS selon le PIB
par habitant (2006), l’IDH (2004) et l’IPH*
Rang PIB/hab. IDH IPH
1 Lux. Norvège Suède
2 États-Unis Islande Norvège
3 Norvège Australie Pays-Bas
4 Irlande Irlande Finlande
5 Islande Suède Danemark
6 Suisse Canada Allemagne
7 Danemark Japon Suisse
8 Pays-Bas États-Unis Canada
9 Autriche Suisse Luxembourg
10 Australie Pays-Bas France
11 Finlande Finlande Japon
12 Suède Luxembourg Belgique
13 Canada Belgique Espagne
14 Belgique Autriche Australie
15 France Danemark Royaume-Uni
16 Japon France États-Unis
IDH : Indicateur
de développement
humain, composé
du PIB/hab.,
espérance de vie
et niveau
d’instruction
IPH : Indicateur de pauvreté humaine
avec : IPH1 pour les PVD regroupe :
risque de mourir avant 40 ans, taux
d’analphabétisation et conditions
de vie (accès à l’eau, sous nutrition…)
IPH2 pour les pays industrialisés :
probabilité de décéder avant 60 ans +
population vivant en dessous du seuil
de pauvreté + chômage longue durée
ISS : Indice de santé
sociale regroupe
des critères de santé,
chômage, pauvreté,
accidents
et risques divers
BIP 40 : mesure
l’évolution
de la pauvreté
et des inégalités
à partir de 40 critères
(revenus, logement,
santé, emploi…)
Mesure du développement par
Chapitre 7Chapitre 7Chapitre 7
Le développementLe développementLe développement
économiqueéconomiqueéconomique
Les finalités de la croissanceLes finalités de la croissanceLes finalités de la croissance

page 52 Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique
B - Les caractéristiques du sous-développement
Caractéristiques démographiques et sociales : mortalité infantile en baisse et maintien d’une natalité élevée car la famille a valeur
de symbole. Transition démographique non achevée avec de faibles résultats en matière d’alphabétisation, d’éducation, d’espérance
de vie…
Économies dépendantes : structure de la production encore très axée sur les produits primaires, dépendance des importations et
des exportations aux pays riches.
Structures sociales très inégalitaires : souvent liées aux particularités de la détention du pouvoir économique par une petite élite
urbaine qui oriente la production vers des produits peu adaptés à l’ensemble de la population pour laquelle ils apparaissent comme
des produits de luxe. Industrie fortement capitalistique sans création d’emplois.
D - Les stratégies du développement
L’industrialisation par les industries industrialisantes : résultats peu convaincants de l’Algérie en 1962 qui comptait sur les indus-
tries lourdes pour entraîner l’ensemble de l’économie mais problèmes de main-d’œuvre, d’investissement…
Le modèle de développement par substitution des importations privilégie un remplacement progressif des produits importés
par des fabrications locales mais suppose une forte intervention de l’État, des capitaux importants, l’importation des technologies.
Exemple de pays d’Amérique latine dont le Brésil qui a diminué l’importation de biens de consommation superflus qui n’intéressaient
qu’une fraction privilégiée de la population et qui a développé les clivages sociaux.
Le modèle de développement extraverti par promotion des exportations : priorité donnée aux exportations, d’abord de produits à
faible intensité technologique, puis par remontée de filière, à des produits plus complexes. Nécessite l’implantation de firmes multi-
nationales, une forte intervention de l’État et une main-d’œuvre bon marché. Exemple des NPI d’Asie.
C - La croissance ne suffit pas au développement
Si la croissance crée de la richesse nécessaire à l’amélioration du niveau de vie, elle n’est cependant pas suffisante.
Le sous-développement a plusieurs signes :
* Dégradation des termes de l’échange.
- Phénomènes naturels (climat, pauvreté
en ressources naturelles) et démographi-
ques (surpopulation), l’exemple des pays
développés ayant réussi à surmonter ces
handicaps illustre l’insuffisance de cette
explication.
- Retard de développement en se référant
aux différentes étapes de la croissance
selon Rostow : société traditionnelle, condi-
tions préalables au démarrage, décolla-
ge, marche vers la maturité, société de
consommation de masse.
- Blocage du développement : prend en
compte les phénomènes de domination
des pays développés sur l’économie mon-
diale, l’échange inégal, la dégradation des
termes de l’échange*, le dualisme des
économies (coexistence d’un secteur mo-
derne et d’un secteur traditionnel).
Références :
www. banquemondiale.org
www.bis.org (site de la BRI, banque des règlements internationaux)
www.unetad (site de la Cnuced)
www.inf.org (site du FMI)
www.undp.org (site du programme des nations unies pour le développement)
Économie mondiale 2009 - Coll Repères Ed. La découverte

Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique page 53
Document 1
On peut partir de la définition, devenue canonique, du développement proposée par F. Perroux : une « combinaison de
changements mentaux et sociaux d’une population qui le rendent apte à faire croître cumulativement et durablement
son produit réel global » pour établir un premier bilan. F. Perroux caractérisait les économies sous-développées par
leur désarticulation, le manque d’effets d’entraînement entre les branches, les régions et les acteurs économiques et la
dépendance forte de la conjoncture économique à l’égard des chocs extérieurs. En 2006, le continent africain répond
encore à ces caractéristiques. Les branches modernes, tournées vers l’exportation, génè-
rent peu d’effets de croissance durable. Les chocs extérieurs et intérieurs sont nombreux
et entraînent de brusques renversements de tendances sur tous les plans.
À la suite des travaux d’A. Sen, la définition du développement s’est complexifiée. Pour
A. Sen, le développement « consiste à surmonter toutes les formes de non-libertés qui
restreignent le choix des gens, et réduisent leurs possibilités d’agir ». Ces formes de non
libertés s’expriment, entre autres, par un accès sélectif au système éducatif et au système
de santé. Cette définition a contribué à l’élaboration d’indicateurs de développement so-
ciétaux dont le plus connu - et maintenant le plus utilisé - est l’« indice de développement
humain » (IDH). Les IDH des différents pays africains révèlent de nombreux retards malgré
quelques progrès.
Extrait de Espace Prépa n° 107
1-CommentezlesdénitionsdudéveloppementquedonnentFrançoisPerrouxetAmartyaSen.
2-CitezdesindicateursalternatifsauPIBpourmesurerledéveloppement.
Document 2 L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Classement de quelques pays selon le PIB/hab et écart entre leur place dans ce classement et dans celui selon l’IDH
L’indice de développement humain (IDH) combine trois critères : le PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance
et le niveau d’instruction (taux de scolarisation et taux d’alphabétisation des adultes). Utilisé comme principe de clas-
sement des pays, il dévoile une hiérarchie sensiblement différente de celle du PIB (même si les deux indicateurs sont
liés ne serait-ce que parce que le PIB/hab. est dans l’IDH).
0
PIB/hab.
-14
-6
-16
-49
-18
-7
+10 +12
+7
1 852 13 205 43 968
4 682 31 9808 949
9 087
10 031
2 489
148e
Nigeria
55e
Russie
8e
États-Unis
104e
Chine
23e
France
77e
Brésil
57e
Iran
68e
Afrique
du Sud
134e
Inde
RangselonlePIB/hab.
Écartdeclassement
Lecture: un chiffre positif signie que le pays
estmieuxclasséselonl’IDHqueselonlePIB/
hab.,unchiffrenégatif,qu’ilestmoinsbienpla-
cé.Exemple:lesÉtats-Unissontau8erangpour
PIB/hab.etau15epourl’IDH.
Source : Pnud
Fotolia©AlessioLaconi
Chapitre 7 - Le développement économique

page 54 Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique
Document 3
L’ÉPARGNE NETTE AJUSTÉE
Épargne nette ajustée de quelques pays,
en % du revenu national brut
L’épargne nette ajustée ou « épargne véritable » est un
indicateur de soutenabilité mis au point par la Banque
mondiale pour exprimer la variation du capital économi-
que, humain et naturel d’un pays à l’issue d’un cycle de
production. À partir de la mesure standard de l’épargne
nationale brute, il procède à quatre types d’ajustements :
déduction de la consommation de capital fixe, ajout des
investissements en capital humain (assimilés aux dépen-
ses d’éducation), déduction de la baisse des stocks de
ressources naturelles consommées (énergie, minerais,
forêts) et des dommages causés par la pollution (dont les
émissions de CO2).
Un taux d’épargne net ajusté négatif simple signifie un
déclin de la richesse totale. C’est le cas des pays exces-
sivement dépendants de l’exportation de ressources
non renouvelables. En revanche, presque tous les pays
développés exhibent une épargne nette ajustée positive.
En effet, les différents types de capitaux sont considérés
comme substituables : la croissance du capital économi-
que ou humain peut compenser la baisse du patrimoine
naturel. Les dommages à l’environnement sont en outre
faiblement valorisés dans la version actuelle de cet indi-
cateur.
L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Empreinte écologique pour quelques pays en 2005,
en hectare global par personne
L’empreinte écologique a été lancée par des organisations
non gouvernementales (ONG) réunies au sein du Global
Footprint Network. Elle évalue l’impact de la consomma-
tion d’une population donnée selon la surface de sol et
d’océan nécessaire pour la produire et pour assimiler les
déchets qu’elle génère. Si l’empreinte dépasse la bioca-
pacité (c’est-à-dire la capacité de la Terre à produire ces
ressources et absorber ces rejets), cela signifie que les ca-
pacités régénératives de la planète sont dépassées. Il fau-
drait ainsi aujourd’hui 1,3 planète pour absorber l’impact
des activités humaines.
Grâce à une formulation très intuitive, cet indicateur a ga-
gné une grande audience. La métrique qu’il utilise pour
agréger des impacts environnementaux hétérogènes
est cependant moins évidente qu’il n’y paraît. La notion
d’hectare global suppose d’établir des équivalences en-
tre différents types de surface (terres cultivées, zones de
pêche, surface forestière nécessaire à l’absorption du CO2
émis par la combustion des énergies fossiles…) et de faire
des hypothèques sur leur rendement.
L’empreinte écologique porte sur la consommation, non
sur la production comme l’épargne nette ajustée, ce qui
véhicule un tout autre message : les pays riches les plus
consommateurs de ressources sont ici clairement mon-
trés du doigt.
Alternatives Économiques n° 283 - septembre 2009
États-Unis +4,1
+11,4
+3,5 +35,0
+20,6
-29,6
-0,3
-23,2
-13,8 Russie
Iran
Afrique du Sud
Nigeria
France
Brésil
Chine
Inde
+4,1
États-Unis
Russie
Iran
Afrique du Sud
Nigeria
Biocapacité totale = 2,1
France
Brésil
Chine
Inde
Source : banque mondiale
Source : Planète vivante 2008
9,4
4,9
3,7
2,7
2,1
2,4
2,1
0,9
1,3

Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique page 55
RécemmentembauchéparlaBanqueMondiale,ilvousestdemandéd’analyserlarelationentrecroissanceet
développementenrépondantauxquestionssuivantes:
1-Quelestl’impactdelacroissancesurledéveloppementdelaChine?
2-Commentexpliquerl’échecdesstratégiesdedéveloppementdel’Afrique?
Depuis 30 ans, la Chine a adopté un modèle de croissance qui a permis au pays de sortir du sous-développement
pour devenir aujourd’hui la 2e puissance économique mondiale. Ce modèle, dont le moteur principal est constitué
par les exportations engendre cependant, depuis plusieurs années, des tendances qui, si elles se poursuivent,
pourraient conduire le pays dans l’impasse.
La structure des exportations de la Chine contraste avec celle des économies africaines qui n’ont pas su, par leur
insertion internationale, ni atteindre une croissance durable, ni bénéficier des avantages de la mondialisation ac-
célérée depuis les années 80.
Document 1 Nouveaux défis pour la prochaine décennie
À court et moyen termes, les questions sociales et démographiques vont devenir beaucoup plus sensibles, car le
changement de « régime » de croissance, de 10 % - 11 % par an à 8 % - 8,5 %, pourrait être suffisant pour induire une
incapacité à absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. Le risque de chômage ou sous-emploi croissant
se double paradoxalement de tensions localisées (types de compétences, régions, secteurs) et d’un enjeu majeur lié au
retournement de la structure des âges qui s’opérera dès la prochaine décennie. Cette question est mécaniquement liée
à la transformation de la structure industrie/services, à l’amélioration des qualités professionnelles et, probablement
de façon plus essentielle, à une meilleure allocation de l’épargne et du capital. De ce point de vue, une nouvelle étape
dans la réforme financière est inévitable pour les prochaines années.
Les inflexions structurelles de la Chine doivent intégrer le défi de la réduction impérative de sa dépendance à l’égard
de l’énergie et des autres matières premières, évolution intimement liée aux questions environnementales, chinoises
comme globales.
L’extension territoriale de la réussite chinoise des provinces côtières et le rôle croissant d’une demande intérieure ali-
mentée par le gonflement des classes moyennes ne pourront se faire sur la même base d’inefficience énergétique et
de dégâts environnementaux.
Thierry Apoteker
Revue d’économie financière N° 95 - novembre 2009
Document 2 L’Afrique : un continent en mal de développement
Le continent dispose de près du tiers
des ressources minérales mondia-
les, d’où son importance stratégique
actuelle. Il existe aussi un potentiel
agricole et des réserves d’eau inex-
ploitées. Ensuite, son espace géo-
graphique et ses débouchés océani-
ques constituent des bases solides
pour un grand marché. Enfin, l’Afri-
que contient un potentiel humain
considérable et en pleine crois-
sance. Ainsi, « le continent africain
n’est pas un continent pauvre. Les
potentialités économiques considé-
rables devraient en faire une grande
puissance économique si une indé-
pendance véritable, fruit d’une poli-
tique cohérente et d’un authentique
dessein unitaire, permettait à ses
peuples d’œuvrer pour leurs intérêts
propres et l’affirmation de leur per-
sonnalité. »
L’Afrique : de mauvais choix
stratégiques
Pendant les années 1960, les prévi-
sions économiques peuvent légitime-
ment anticiper sur une croissance et
un développement économique fort
et durable de la plupart des pays du
continent. En 1969, le rapport Pearson
financé par la Banque mondiale dési-
gne l’Asie et non l’Afrique comme le
continent suscitant le plus de craintes
quant à son futur. Les choix écono-
miques effectués par les États Afri-
cains après les indépendances sont
conformes aux enseignements de
l’économie du développement : prio-
rité à l’industrialisation - surtout in-
dustries agroalimentaires et textiles -
part substitution des importations
selon les avantages comparatifs,
prise en charge par l’État et l’admi-
Fotolia©CarlaMarcellin
MISE EN SITUATION MISE EN SITUATION MISE EN SITUATION MISE
Chapitre 7 - Le développement économique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%