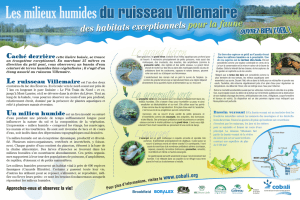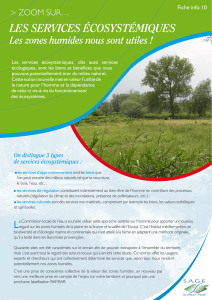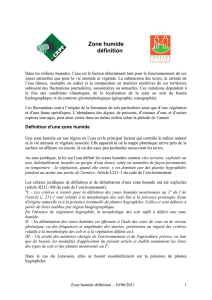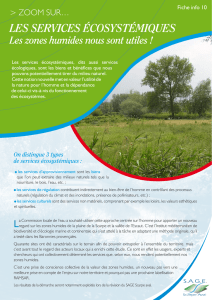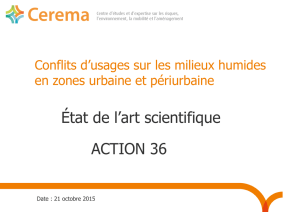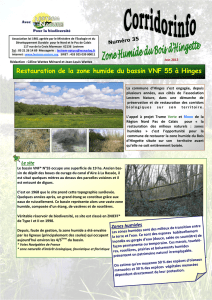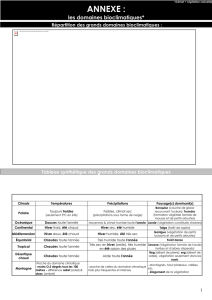Les menaces sur la zone humide - Agence de l`Eau Seine Normandie

91
Juin 2013
Agir
Zones humides prioritaires
Zones humides à protéger ou restaurer en priori-
té au vu de l'importance de leurs fonctions, de
leurs valeurs ou des menaces. Les zones
humides prioritaires peuvent être des zones
humides à fort intérêt patrimonial ou des zones
humides jouant un rôle important pour la gestion
de l'eau1.
Site fonctionnel
Regroupement de zones humides ayant un fonc-
tionnement hydrologique homogène et une
cohérence écologique et géographique. Ces
zones humides peuvent être géographiquement
connectées ou déconnectées1.
Un site fonctionnel peut correspondre à :
• un ensemble de plusieurs petites zones
humides (exemple : un ensemble de zones
humides de fond de vallée, plusieurs tour-
bières d'un même versant ou un réseau de
mares).
• une seule zone humide isolée géographique-
ment (exemple : une mare ou une tourbière
isolée)
• une seule zone humide ayant un fonctionne-
ment indépendant des zones humides voi-
sines (exemple : une zone humide de bordure
de plan d'eau).
Unité hydraulique cohérente (UHC)
Portion continue du territoire, disposant d'une
autonomie propre en termes de niveaux d'eau et
d'au moins une entrée et une sortie d'eau. Les
bornes structurelles des UHC sont des exhaus-
sements (digues, buttes, bosses, bourrelets de
curage), des surcreusements (fossés, canaux)
ou des ouvrages en dur (vannages de toutes
sortes). La notion d'Unité Hydraulique Cohérente
(UHC) particulière aux marais endigués rejoint
celle de site fonctionnel (valable pour tout type
de zone humide).
AGIR :
LE VOCABULAIRE
Illustration de la notion de site fonctionnel sur un inventaire de zones humides
(Source : Forum des Marais Atlantiques)
Illustration de la compartimentation fonctionnelle des zones humides littorales
(Source : Forum des Marais Atlantiques)
En orange : Syndicat de marais ou découpage équivalent
En bleu : UHC au sens strict du terme (compartiment hydraulique)
En rouge : Unité d'exploitation (ensemble de parcelles)
1Définition issue du Manuel d'aide à l'identification des zones humides prioritaires, des ZHIEP et des ZSGE (2011)
Plus d'informations sur la notion d'UHC,
“Contribution des zones humides au bon
état des masses d'eau” (Forum des Marais
Atlantiques, 2005) :
http://www.forum-zones-humides.org/editions-
zones-humides.aspx

92
Espace de fonctionnalité
Espace proche de la zone humide, ayant une
dépendance directe et des liens fonctionnels évi-
dents avec la zone humide, à l'intérieur duquel,
certaines activités peuvent avoir une incidence
directe, forte et rapide sur le milieu et conditionner
sérieusement sa pérennité2.
Cet espace est considéré comme la zone du bas-
sin versant dans laquelle toute modification de la
quantité ou de la qualité de l'eau, risque d'être
directement dommageable pour la zone humide. Il
peut s'agir :
• du bassin versant entier ou de la tête de bassin ;
• du “proche bassin versant” limité par des rup-
tures de pente, des couloirs écologiques, des
haies ou boisements, des limites de cultures ou
de prairies, des limites de zones inondables,
etc. ;
• d'un ensemble de zones humides complexes
comportant plusieurs objets, par exemple plu-
sieurs plans d'eau, un cours d'eau avec les fos-
sés humides qui s'y rattachent et quelques por-
tions de prairies humides.
Unité hydro-géomorphologique (HGMU)
Élément du paysage caractérisé par un type géo-
morphologique et un régime hydrologique unifor-
me, présentant un même type de sol.
A l'intérieur d'une zone humide, le fonctionnement
hydrologique n'est pas homogène et plusieurs uni-
tés hydro-géomorphologiques peuvent être identi-
fiées. La microtopographie du site, les différences
de végétation et les profils de sol sont des indices
pour caractériser les différentes unités hydro-géo-
morphologiques.
La zone humide et son espace de fonctionnalité
(Source : Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse)
Illustration des différentes unités hydro-géomorphologiques
d'une zone humide de fond de vallée
(Source : B. Clément)
2Définition de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse
Pour agir, plusieurs étapes :
• identifier les zones humides prioritaires où l'action est à mener ;
• établir un diagnostic préalable en caractérisant ces zones humides de manière détaillée afin
de dresser un état des lieux : fonctionnement, dégradations, contexte humain et menaces ;
• définir des objectifs d'actions en concertation. Il s'agit de s'accorder sur l'état de la zone
humide le plus propice au vu des enjeux du territoire et sur les principes de gestion pour
atteindre cet état ;
• élaborer un programme d'actions en définissant précisément les actions à mener pour
atteindre les objectifs d'action ;
• mettre en place un suivi des actions engagées et des zones humides du territoire.
Juin 2013 Agir

93
Juin 2013
Agir - Fiche 17
Les compétences nécessaires
FICHE N° 17
SÉLECTION DES ZONES HUMIDES PRIORITAIRES
Par nature, toutes les zones humides présentent
un intérêt pour le fonctionnement hydrologique,
la biodiversité, les paysages et l'Homme. Ainsi,
toutes les zones humides peuvent être prises en
compte dans certaines démarches :
• inscription dans les documents d'urbanisme ;
• prescriptions dans les Schémas d'Aména-
gement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
• intégration à la Trame Verte et Bleue et aux
chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR),
etc.
Cependant, les moyens mobilisables sont limités
et ne permettent pas d'intervenir de manière
forte sur toutes les zones humides. Dans cer-
tains cas, il est souhaitable d'identifier des zones
humides prioritaires (budget limité, territoire
étendu).
Les zones humides prioritaires sont :
• les zones humides en bon état (fonctions et
valeurs importantes) mais menacées ;
• les zones humides dégradées se situant sur
des territoires à forts enjeux (par exemple,
objectif de bon état des masses d’eau pour
2015, risque de non-atteinte du bon état, pré-
sence d’un captage d’eau potable, présence
d’espèces protégées, etc.).
Pour les identifier, il existe trois méthodes : l'ana-
lyse cartographique, la sélection par attributs et
la confrontation avec les avis d'experts.
Avant de réaliser cette sélection, il est nécessai-
re au préalable :
• d’identifier et de cartographier les enjeux sur le
territoire (voir fiche 9) ;
• de cartographier les zones humides effectives
(voir fiche 13) ;
• de réaliser une caractérisation simplifiée pour
ces zones humides (voir fiche 15).
La sélection des
zones humides prioritaires
est basée sur le croisement
de 3 critères : les enjeux,
les fonctions et les
menaces.
Si l'identification des enjeux et la caractérisation
simplifiée des zones humides sont réalisées
convenablement, la sélection des zones
humides prioritaires est une opération simple.
Elle demande cependant des compétences en
gestion de bases de données et une maîtrise
des Systèmes d'Information Géographique
(SIG). Elle peut être réalisée en interne (par le
technicien ou l’animateur “zones humides”) ou
en passant par un prestataire extérieur (par
exemple dans le cadre de la réalisation d'un
inventaire des zones humides ou de l'élaboration
d'un programme d'actions à l'échelle d'un bassin
versant).
Pour plus d'informations, voir le manuel d'aide
à l'identification des zones humides prioritaires,
des ZHIEP et des ZSGE (Forum des Marais
Atlantiques, 2011) :
http://www.forum-zones-humides.org/editions-
zones-humides.aspx

94
Les trois critères suivants permettent de sélection-
ner les zones humides prioritaires :
• les enjeux du territoire ;
• les fonctions et valeurs des zones humides ;
• les menaces sur les zones humides.
Le tableau ci-dessous aide à l'identification des
zones humides prioritaires :
Croisement des trois critères : enjeux/fonctions/menaces
Zones humides
avec des fonctions
importantes et un fort
niveau de menaces
Zones humides prioritaires pour une protection particulière
(acquisition, réglementation, etc.)
avec un diagnostic
hydraulique “dégradé”
(voire “très dégradé”)
Zones humides prioritaires
pour la restauration
avec un diagnostic
patrimonial “dégradé”
(voire “très dégradé”)
Zones humides
prioritaires pour la
restauration
avec des valeurs socio-
économiques peu
développées
Zones humides
prioritaires pour la
valorisation
Territoires à enjeux importants
pour la
quantité d'eau
pour la qualité
physico-chimique de
l'eau
pour la biodiversité
et le paysage
pour les
usages
Afin de conserver une cohérence
fonctionnelle, il est préférable de regrouper
les zones humides par site fonctionnel avant la
sélection des zones humides prioritaires.
Attention à ne pas surdimensionner le nombre de
zones humides prioritaires
Pour certains territoires, le nombre de zones humides
sélectionnées comme prioritaires peut être très
important. Dans ce cas, la présence d'un maître d'ou-
vrage et les motivations locales peuvent constituer un
quatrième critère de sélection.
Juin 2013 Agir - Fiche 17
© CDC Charly-sur-Marne

95
Juin 2013
Agir - Fiche 17
L'analyse cartographique consiste à sélectionner
les zones humides en fonction des territoires où
les enjeux sont les plus importants. Pour cela, il
est nécessaire de se baser sur la cartographie
des enjeux (voir fiche 9). Le recoupement entre
la cartographie des zones humides et celle des
enjeux peut se faire grâce à un logiciel SIG
(QGIS, ArcGIS, MapInfo) ou grâce au logiciel
Gwern.
Utilisation du logiciel Gwern
Le logiciel Gwern permet de réaliser des croisements géographiques avec d'autres documents cartographiques
(couche SIG type shapefile) :
Rubrique “Sélection”
Sous-rubrique “Sélection par croisement géographique”
Pour sélectionner les zones humides se situant sur un secteur à forts enjeux :
• choisir la couche SIG concernée (ex : secteurs où les enjeux qualité de l'eau sont importants) ;
• valider la sélection.
Le nombre de zones humides concernées est affiché (la surface figure sur le bandeau du bas).
A l'intérieur de cette sélection, il est possible de faire une sélection des zones humides par attributs.
Il est parfois nécessaire de retravailler la cartographie des enjeux. C'est le cas si les différents enjeux sont
confondus dans une même couche SIG (enjeux liés à la quantité d'eau, à la qualité de l'eau, à la biodiversité,
au paysage et aux usages) ou si les enjeux sont classés par ordre d'importance. L'objectif est d'importer dans
Gwern uniquement les secteurs où l'enjeu concerné est important.
Cette étape consiste à sélectionner les zones
humides ayant les attributs suivants :
• un diagnostic hydraulique “dégradé” voire “très
dégradé” ;
• un diagnostic patrimonial “dégradé” voire “très
dégradé” ;
• aucune valeur socio-économique “impor-
tante” ;
• des fonctions hydrologiques, épuratrices et
écologiques “importantes” (ou “majeures”)
ET un niveau de menaces “fort”.
Pour cela, il est nécessaire de s'appuyer sur les
données issues de la caractérisation simplifiée
des zones humides (Fiche 15). La sélection des
zones humides par attributs peut se faire grâce à
un logiciel de base de données (type Access), un
tableau (type Excel) ou grâce au logiciel Gwern.
Utilisation du logiciel Gwern
Le logiciel Gwern permet de faire des recherches par attributs :
Rubrique “Sélection”
Sous-rubrique “Sélection par attributs”
Pour sélectionner des zones humides ayant un attribut :
• choisir le critère concerné (ex : diagnostic hydraulique) ;
• choisir le ou les libellés concernés (ex : dégradé et très
dégradé) ;
• valider la sélection.
Le nombre de zones humides concernées est affiché (la
surface figure sur le bandeau du bas).
Analyse cartographique pour les enjeux du territoire
Sélection par attributs
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%