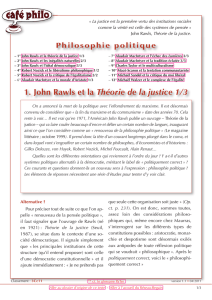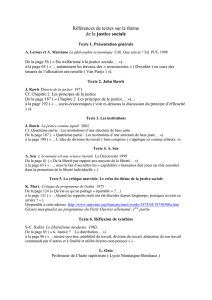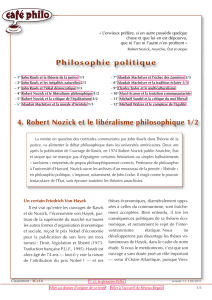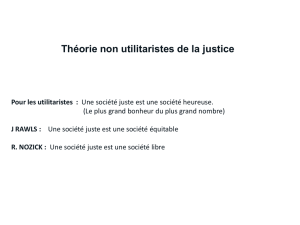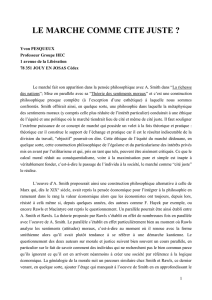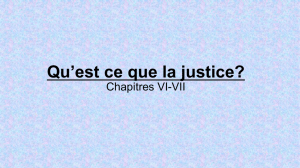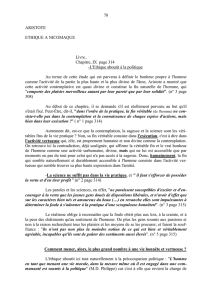6. Alasdair MacIntyre et la morale d`Aristote 1/3 - Reseau

Rawls, Nozick : « même combat »
On ne trouvera pas chez MacIntyre l’an-
crage de ses réflexions philosophico-politiques
dans un « état originel » fictif ou réel, cher à la
philosophie politique depuis Hobbes, encore
présent chez Rawls sous la forme de ce qu’il
appelle la « position originelle », et chez No-
zick sous les traits d’un « état de nature »
proche de la conception qu’en donnait John
Locke. Un tel état-hypothèse conduit à s’inter-
roger sur la naissance et la justification du
pouvoir politique. Centrés essentiellement sur
le concept de justice sociale, Rawls et Nozick
relèguent donc au second plan les exigences
morales dont la philosophie politique peut dif-
ficilement faire l’économie. Quant à la fiction
d’un nouveau point de départ, visant à ren-
voyer dos à dos les thèses capitalistes et
marxistes, elle part sans doute d’une bonne in-
tention, mais elle évacue un autre ingrédient
central de la philosophie politique : le lourd
lest de l’Histoire dont on ne peut pas davan-
tage faire abstraction.
Le livre de John Rawls, Théorie de la justice paru en 1971, a suscité débats et contro-
verses, notamment dans les universités américaines. À la recherche d’une alternative à
la fois au capitalisme et au communisme, il sera jugé trop « communautariste » par les
partisans du libéralisme — tel Robert Nozick — et trop « libéral » par les partisans du
communautarisme. Nous avons donné un résumé du point de vue « libéral » de Nozick.
Il restait à faire entendre l’autre réaction : celle des « communautariens ». Nous en trou-
vons un exemple développé par le philosophe américain Alasdair MacIntyre dans son
livre Après la vertu qui paraîtra dix après l’ouvrage de Rawls (1981, traduction française
parue en 1997) et n’est pas dénué d’intérêt, loin s’en faut. Il entend, en effet, faire porter
davantage l’accent sur les rapports inévitables entre politique, Histoire et morale.
6. Alasdair MacIntyre et la morale d’Aristote 1/3
Philosophie politique
– 1° John Rawls et la théorie de la justice 1/3 (é.35)
– 2° John Rawls et les inégalités naturelles 2/3 (é.36)
– 3° John Rawls et l’idéal démocratique 3/3 (é.37)
– 4° Robert Nozick et le libéralisme philosophique 1/2
– 5° Robert Nozick et la critique de l’égalitarisme 2/2
– 6° Alasdair MacIntyre et la morale d’Aristote 1/3
– 7° Alasdair MacIntyre et l’échec des Lumières 2/3 (é.41)
– 8° Alasdair MacIntyre et la tradition éclatée 3/3
–9° Charles Taylor et le multiculturalisme (é.43)
– 10° Macé-Scaron et la tentation communautariste
– 11° Michaël Sandel et la critique du moi libéral (é.45)
– 12° Michaël Walzer et le complexe de l’égalité
«…dans la théorie de la justice comme équité, le
concept du juste est antérieur à celui du bien ».
John Rawls, Théorie de la justice, p. 438
Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012
Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 1/5

MacIntyre va profiter de ces défaillances
communes à Rawls et Nozick pour mettre les
deux auteurs “dans le même sac” : il fait en
deux partisans du « libéralisme ». Il y aurait
beaucoup à dire — et nous en avons un peu dit
précédemment — sur ce rapprochement dont
on se demandera s’il est licite et qui rappelle,
par certains côtés, un procédé fétiche de la dia-
lectique marxiste : « l’amalgame ». Mais nous
n’entrerons pas dans la polémique ; il nous pa-
raît plus regrettable que MacIntyre soit telle-
ment hanté par ses préoccupations
« communautariennes ».
La critique adressée à Rawls souligne tout
d’abord que celui-ci présuppose les hommes
comme seulement et entièrement rationnels, ce
qui fausse son raisonnement — puisque tel
n’est pas le cas. Là-dessus, MacIntyre est
convaincant. Il l’est moins lorsqu’il reproche à
Nozick de ne donner aucune justification des
prémisses qui fondent sa théorie selon laquelle
chaque individu a des droits inaliénables sur ce
qu’il est « habilité » à posséder. Certes, la no-
tion « d’habilitation » est relativement suspecte.
Mais l’on sent poindre chez MacIntyre une vo-
lonté d’évacuer un peu rapidement et sans dis-
tinction toute justification de l’héritage de
biens personnels ; la question est complexe :
faut-il séparer par un gouffre insondable l’héri-
tage culturel de l’héritage économique ? Faut-
il aliéner autoritairement toute volonté de
transmettre les fruits d’une existence de labeur
et de sacrifices à ses enfants ou à sa famille ?
Vieux débat qui ne se règle pas d’un revers de
main…
Plus inattendue est la façon dont MacIntyre
entend dépasser ce qui oppose Nozick à Rawls
pour montrer en quoi ils sont finalement d’ac-
cord — à tort, selon notre auteur : « Il y a pour-
tant, entre Rawls et Nozick, un point commun
important même s’il est négatif. Ni l’un ni l’au-
tre ne fait la moindre référence au mérite dans
leur exposé de la justice, et il serait incohérent
de le faire » (Après la vertu ; pp. 241-242).
Du livre noir du communisme au
livre blanc du marxisme
Bien que partisan d’une société dans la-
quelle la politique doit veiller à bannir tout in-
dividualisme, MacIntyre ne peut décemment
pas prôner le retour au communisme. Il a lu
Soljenitsyne et nous le fait savoir : « il n’est pas
étonnant que la politique des sociétés mo-
dernes oscille entre une liberté qui n’est
qu’une absence de régulation du comporte-
ment individuel et des formes de contrôle col-
lectiviste ne visant qu’à limiter l’anarchie des
intérêts privés. Les conséquences de la vic-
toire de l’un ou l’autre camp sont souvent de
la plus haute importance dans l’immédiat
mais, comme l’a bien compris Soljenitsyne,
les deux modes de vie se révèlent intolérables
à long terme » (loc. cit. ; p. 36). Pourtant,
comme on pourra s’en apercevoir par la suite,
les thèses de MacIntyre flirtent souvent avec
un marxisme revisité. Certes, il cherche à
prendre ouvertement ses distances ici ou là,
prétextant que le marxisme, s’il prend le pou-
voir politique, sera nécessairement “infecté”
par l’individualisme moderne ; comme s’il y
avait là une virginité à refaire et un crédit en
sous-main pour laver le communisme de ses
horreurs historiques. Dans la dialectique
marxiste, le procédé ici à l’œuvre s’appelle le
«transfert des responsabilités»: « Depuis
l’origine, le marxisme est en son sein un indi-
vidualisme radical […] d’après les prémisses
de Trotsky, l’Union soviétique n’était pas so-
cialiste et la théorie qui aurait dû illuminer la
voie de la libération humaine avait en fait
Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012
Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 2/5

mené aux ténèbres » (p. 254). « En son sein »
signifie « à l’insu » de Marx lui-même qu’on ne
saurait, bien entendu, taxer de penseur « indi-
vidualiste »!
MacIntyre est, il faut bien l’avouer, de mau-
vaise foi sur ce point important : il considère le
marxisme comme « épuisé en tant que tradition
politique », mais il voit cependant en lui « l’une
des plus riches sources d’idées sur la société
moderne » (p. 255). Reste à savoir si ces
« idées » ne sont pas plutôt des idéologies
meurtrières. Et l’on en vient à se demander si
l’entreprise de l’auteur ne consiste pas à dépla-
cer la théorie marxiste du plan de l’horreur
spectaculaire historique à celui, plus séditieux,
d’une inoculation indolore dans la « morale ».
Au reste, il finit par avouer : « Pourtant, la
conception de l’idéologie créée par Marx, bril-
lamment reprise par des penseurs aussi divers
que Karl Manheim et Lucien Goldmann, sous-
tend en partie ma thèse centrale sur la morale »
(p. 108).
Un bon début
Pourtant l’idée générale qui commande la
réflexion de MacIntyre est plus que justifiée ;
il s’agit d’un désenchantement de la politique
moderne qui semble avoir perdu le sens des
valeurs morales auxquelles elle devrait, nor-
malement, rester subordonnée. Les derniers
mots de la première édition de l’ouvrage sont
impressionnants de réalisme : « Cette fois,
pourtant, les barbares ne nous menacent pas
aux frontières ; ils nous gouvernent déjà de-
puis quelque temps. C’est notre inconscience
de ce fait qui explique en partie notre situa-
tion. Nous n’attendons pas Godot, mais un
nouveau (et sans doute fort différent) saint Be-
noît » (p. 255). Un saint Benoît « fort diffé-
rent », certes, qui aurait reçu sa mission
« apostolique » marxiste par l’intercession de
Trotsky, c’est-à-dire au fond d’un marxisme
débarrassé de ses préoccupations politiques,
véritable revanche des « révisionnistes » sur
les bolcheviks. Notre « nouveau » saint Be-
noît révisionniste serait en quelque sorte
chargé de redresser les errements historiques
qui ont conduit au capitalisme et aux échecs
du marxisme ; en un mot de « toutes les tra-
ditions politiques de notre culture » (Ibid.)
Le constat d’échec est signalé, dès le départ,
comme ayant atteint un point de non-retour que
MacIntyre appelle « l’émotivisme » dans les do-
maines de la morale et de la politique — la pre-
mière étant, à ses yeux, primordiale par rapport
à la seconde. Cet « émotivisme » rend stérile
toute position politique fondée sur les émotions
ou le sentiment d’avoir raison, soit que l’on
cherche une justice égalitaire, soit que l’on
veuille respecter le droit individuel de la pro-
priété. Et, dans le souci de refuser toute rupture
entre le présent et le passé de notre culture, Ma-
cIntyre examine les raisons historiques pour les-
quelles la morale et la politique modernes ont
occulté l’importance capitale de la tradition.
C’est la partie la plus longue — et par chance
la plus intéressante — de l’ouvrage, en dépit de
quelques raccourcis et de quelques simplifica-
tions historiques qu’il serait mesquin de trop lui
reprocher.
Les vertus selon Aristote
La vertu aristotélicienne qui intéresse au plus
haut point MacIntyre est, bien entendu, la jus-
tice. Les débats politiques contemporains por-
tent en effet sur la justice sociale et la question
de savoir si elle doit correspondre à l’égalité des
biens, notamment. Voici que notre auteur veut
donc remettre en selle l’autre sens du mot jus-
tice. Et il rappelle que dans l’Antiquité grecque
on avait l’avantage de réfléchir moins sur
l’homme « tel qu’il est » que sur « l’homme tel
Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012
Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 3/5

qu’il doit être ». Qu’est-ce donc qu’un homme
« juste » selon Aristote ? Celui qui agit kata ton
orqon logon, ainsi qu’il dit dans l’Éthique à Ni-
comaque (1138 b25), c’est-à-dire selon la rai-
son correcte. Et « seul celui qui possède la vertu
de justice, commente MacIntyre, saura com-
ment appliquer la loi » (Après la vertu ; p. 148).
Le rapport est inversé dans le débat politique de
nos sociétés modernes, puisqu’il faut appliquer
la loi pour être considéré comme « juste ». Au
contraire, être juste au sens aristotélicien, « c’est
donner à chacun ce qu’il mérite, et pour que
cette vertu fleurisse dans une communauté, il
faut donc qu’existent des critères rationnels de
mérite et un consensus socialement établi sur
ces critères » (pp. 148-149). On soupçonne que
l’auteur détecte chez Aristote un “communau-
tarien” avant l’heure : « Cette idée de la com-
munauté politique comme projet commun est
étrangère au monde moderne individualiste et
libéral » (p. 152). Et il est vrai que la liberté chez
les anciens différait de ce qu’elle est chez les
modernes, ainsi que l’a longuement souligné
Benjamin Constant qui n’est, bien sûr, même
pas évoqué par MacIntyre, sans doute en raison
de ses accointances avec le libéralisme. Le ci-
toyen grec ne peut envisager sa vie sans se re-
placer dans le contexte de la Cité à laquelle il a
l’honneur d’appartenir. Voilà qui donne, pour
notre auteur, un énorme avantage à Aristote. Il
ne se perdrait donc pas dans l’inextricable et
vain débat qui oppose Rawls à Nozick : « Les
concepts de justice selon les règles récemment
avancées par deux moralistes contemporains ne
peuvent en rien nous aider ».
Hélas le pauvre Aristote se serait fourvoyé,
car il n’aurait pas compris le message de la tra-
dition et de la morale homériques (dans l’esprit
de MacIntyre), tant il était “aveuglé” par l’im-
portance de « l’amitié ». On sait en effet quelle
place centrale occupe la philia dans l’éthique
aristotélicienne. Certes MacIntyre souligne qu’il
ne s’agit pas d’une « amitié » au sens moderne
du mot : « pour Aristote, l’amitié implique bien
sûr l’affection. Mais cette affection naît dans
une relation définie par l’allégeance commune,
par la recherche des mêmes biens » (Ibid.). Bref
ce n’est pas une « amitié » au sens « émoti-
viste » moderne. Bien ; mais cela ne suffit pas
aux yeux de notre auteur : elle vient quand
même “perturber” les intuitions prémarxistes
qu’aurait pu avoir Aristote ; mais personne n’est
parfait ! Bien entendu, ces intuitions MacIntyre
n’en parle pas aussi franchement : il fait un léger
détour par Homère pour aboutir finalement à
cette conclusion saugrenue : si les conflits de la
tragédie peuvent en partie venir des défauts des
personnages (Antigone, Créon, Ulysse…), « ce
qui constitue l’opposition tragique de ces indi-
vidus, c’est le conflit entre biens rivaux, conflit
incarné dans leur rencontre indépendamment
de toute caractéristique individuelle. C’est à cet
aspect de la tragédie qu’Aristote est nécessaire-
ment aveugle dans sa Poétique. Privé de cette
vision du rôle central du conflit dans la vie hu-
maine, Aristote ne perçoit pas l’une des sources
de l’éducation morale et l’un des milieux où
l’homme pratique les vertus » ! (p. 159). Pas de
conflits, pas de vertu, pas de morale, pas de po-
litique possibles.
Les vertus selon MacIntyre
L’auteur commence par rejeter toute préten-
tion de l’éthique à l’universalité. C’est, selon lui,
l’erreur fondamentale de Kant que d’avoir pensé
le contraire. Il donnait par là-même un coup
fatal à la tradition ancrée chez Aristote d’une
morale « communautaire ». C’est ainsi que la
plupart des débats moraux contemporains ont
en commun un caractère interminable et inso-
luble. Ils s’appuient sur des concepts hétéro-
gènes et incommensurables. Il manque
Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012
Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 4/5

aujourd’hui un consensus clair sur les notions
morales, donc sur les vertus.
Le langage de la morale a survécu jusqu’à
notre époque, mais sous une forme particuliè-
rement confuse et qui juxtapose des fragments
conceptuels de divers moments de notre passé.
Ce désordre est le résultat d’une longue histoire,
allant de la fin du Moyen Âge à nos jours, au
cours de laquelle le catalogue des vertus s’est
transformé, ainsi que le concept même de vertu.
À l’époque des lumières, les philosophes reje-
tèrent la tradition aristotélicienne, tentant en
vain de la remplacer par un exposé rationnel et
laïque de la nature des vertus.
Suivi par les existentialistes et les « émoti-
vistes », Nietzsche crut pouvoir refuser tout l’hé-
ritage théorique du XVIIIe siècle. Mais sa
position apparaît à notre auteur comme « une
facette supplémentaire de cette culture morale
dont Nietzsche se croyait le critique implaca-
ble. L’opposition morale essentielle se situe
donc bien finalement entre l’individualisme li-
béral, dans une quelconque version, et la tradi-
tion aristotélicienne, sous une forme ou sous
une autre » (p. 252). Mutatis mutandis, Marx,
ne paraît pas plus à même, dans sa version pro-
phétique, de fournir une solution au problème
moral et politique : « le marxisme produit sa
propre version du Surhomme : le prolétaire
idéal de Lukacs, le révolutionnaire idéal de Lé-
nine. Quand le marxisme ne devient pas une
démocratie sociale wébérienne ou une tyrannie
grossière, il tend à devenir une fantaisie nietz-
schéenne » (p. 255). Marx est mort et avec lui
le marxisme.
Au fond, le catalogue des vertus a bien
changé au cours de l’Histoire culturelle occi-
dentale. Celui de l’auteur reste tout de même
assez flou. Il se veut essentiellement lié à une
communauté morale et culturelle qui considé-
rerait avant tout l’individualisme comme le pire
des vices. La vertu consisterait alors dans une
« pratique » qui tiendrait compte de la tradition
sociale et culturelle de l’époque. La définition
que donne l’auteur de la vertu reste tout de
même peu édifiante : « Une vertu est une qua-
lité humaine acquise dont la possession et
l’exercice tendent à permettre l’accomplisse-
ment des biens internes aux pratiques et dont le
manque rend impossible cet accomplissement »
(p. 186). Mais peut-on fonder une morale et sur-
tout une politique sur une telle conception ? Et
c’est peut-être la raison pour laquelle l’auteur
veut situer son discours « après la vertu ».
Au fond, MacIntyre propose, par une refor-
mulation du message d’Aristote, de rendre à
notre discours moral son intelligibilité perdue.
Mais l’on reste tout de même quelque peu sur
sa fin. Et c’est la raison pour laquelle MacIntyre
publiera une suite à Après la vertu, réclamée
par ses lecteurs : Quelle justice ? Quelle ratio-
nalité ?
Jean-Louis Linas
Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012
Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 5/5
1
/
5
100%