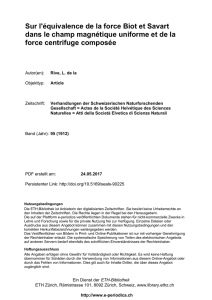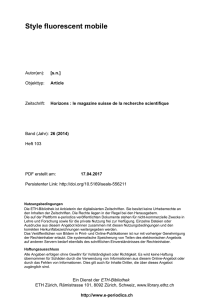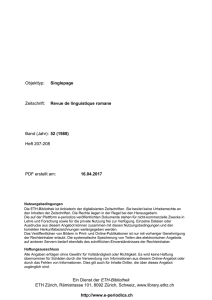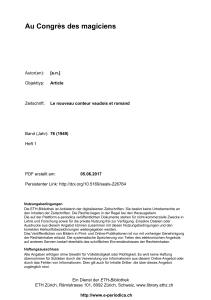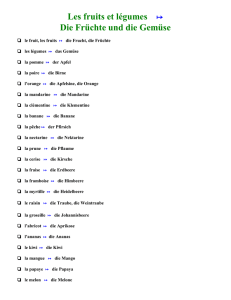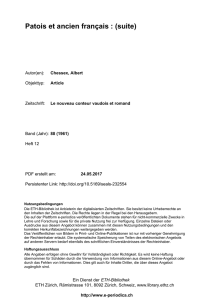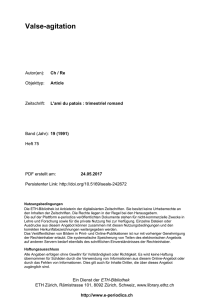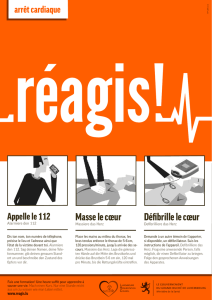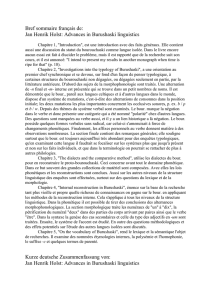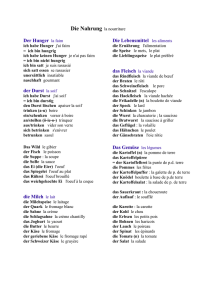rien: Medizinische Ethik diene dazu, verantwortliches Han

Bioethica Forum / 2010 / Volume 3 / No. 1 37
Tagungsbericht / Notes de colloque / Symposium notes Rezensionen / Recensions / Book reviews
rien: Medizinische Ethik diene dazu, verantwortliches Han-
deln in der Medizin zu ermöglichen und zu unterstützen und
«auf Vorrat» zu denken. Der Sonntag startete mit dem zweiten
Block zum Thema theoretische und methodische Ansätze der
Medizinethik. Silke Schicktanz erläuterte die These, dass bio-
ethische Urteile gemischte Urteile seien, also auf normativen
und deskriptiven Aussagen bauen, und sprach den letzteren
im Rahmen des in Frage stehenden Verhältnisses von Medizi-
nethik und Empirie eine grosse, aber vorsichtig zu handha-
bende Bedeutung zu. Claudia Wiesemann beleuchtete anhand
von Fallbeispielen und moralischen Dilemmata relationale
Ansätze in der Medizinethik und betonte die Wichtigkeit so-
zialer Beziehungen für die Moral. Oliver Rauprich erläuterte
die Prinzipienethik und forderte die Teilnehmen auf, diese in
der Diskussion von Fallbeispielen anzuwenden. Den letzten
Teil des Tages bestritt Friedemann Nauck, der aus praktischer
palliativmedizinischer Sicht einige Anforderungen an die Me-
dizinethik formulierte und die längst erwartete Sicht der Pra-
xis in die Diskussion einbrachte. Zum Abschluss des informa-
tiven Tages waren die Teilnehmenden eingeladen, ihren
persönlichen Eindruck der Fortbildung zu äussern, der im
Ganzen sehr positiv ausfiel.
Während der beiden letzten fakultativen Tage der Fortbildung
bot die Veranstalterin den Teilnehmenden die Möglichkeit, in
verschiedenen Abteilungen der Universitätsmedizin Göttingen
zu hospitieren. Dieses Angebot, das vor allem von Nicht-Medi-
zinern und Nicht-Medizinerinnen dankend angenommen
wurde, bot die wertvolle Gelegenheit, Einsicht in die klinische
Tätigkeit zu erhalten und den Blick für diese unerlässliche Per-
spektive auf medizinethische Fragen zu schärfen.
Die Fortbildung bot ein passendes Forum für den wertvollen
Erfahrungsaustausch und für das Knüpfen neuer Kontakte.
Sie trumpfte zudem mit einer hervorragenden und zuvor-
kommenden Organisation und mit dem seltenen Angebot
begleiteter und engagiert durchgeführter Hospitationen. Die
inhaltliche Seite vermochte allerdings nicht in jeder Hin-
sicht zu überzeugen. Dies lag weniger an den Referenten und
Referentinnen selber, als vielmehr an einer fehlenden Syste-
matik der Referatsinhalte und ihres Zusammenhangs, die
dem Titel «Einführung in die Medizinethik» – und besonders
auch den Doktorandinnen und Doktoranden ohne Philoso-
phiestudium – hätte gerecht werden können. So wurde denn
auch symptomatisch fast durchgehend der philosophische
Gehalt des breiten Feldes der Medizinethik in den Vorder-
grund gerückt, ohne ihre derzeitige Vielfalt einmal grundle-
gend zum Thema zu machen. Zudem ist auch gemäss einiger
Rückmeldungen der Teilnehmenden die praktische Seite et-
was zu kurz gekommen. Gerade diese hätte die Komplexität
medizinethischer Fragen verdeutlichen können.
Insgesamt war die Fortbildung für Doktorandinnen und Dok-
toranden «Einführung in die Medizinethik» aber ein Gewinn,
der sich für weitere Nachwuchswissenschaftler und -wissen-
schaftlerinnen hoffentlich wiederholen wird. Das eingangs
zitierte Ziel der Veranstaltung – die Möglichkeit, Gespräche
mit renommierten Vertretern der Medizinethik zu führen,
um Anregungen für die eigene Forschungsarbeit zu erhalten
– wurde in motivierender Weise erfüllt.
Contact
Eliane Pfister, lic. phil.
Institut für Biomedizinische Ethik
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH-8032 Zürich
e-mail: pf[email protected]
Guy Widdershoven, John McMillan, Tony Hope, Lieke van
der Scheer (Eds.) (2008), Empirical Ethics in Psychiatry.
Oxford University Press, 265 pages
ISBN 978-0-19-929736-8
The field of psychiatric ethics has been supported by recent
anthologies such as «Psychiatric Ethics» (2009) edited by Sidney
Bloch and Stephen A. Green or «Ethics, Culture, and Psychiatry»
(2000) edited by Ahmed Okasha et al. While these recommend-
able books give a comprehensive overview of ethical and culture
related questions in modern psychiatry they do not capture the
specific challenges of how to integrate empirical, descriptive
information into normative reasoning and decision making.
The anthology under review closes this gap in a very elaborative
way on the one hand but it also closes a second gap concerning
the current literature on empirical ethics in general. The so
called field of empirical ethics and the general interest in how
empirical and philosophical methods can be combined found
increasing attention in the last decade. Findings of empirical
ethics research and original work on the epistemological chal-
lenges in empirical ethics have been published recently. How-
ever, we still lacked a focused contribution to empirical ethics
that illustrates to the practicing health care community and to
the professional ethicists how empirical methods can be used,
in different ways, to improve patient understanding, physician-
patient relationship, medical decision making and other tasks
that are strongly linked to their implicit normativity.
Altogether, the 26 authors (4 editors included) of the 15 chap-
t
ers cover a wide range of different disciplines (psychiatry, phi-
losophy, social sciences, nursing etc.). After the introduction
the first three chapters complete the existing literature about
the concepts and epistemology of empirical ethics. Whereas two
editors (J. McMillian and T. Hope) argue from the standpoint of
an analytical philosophy and present an overview of six ways in
which ethics and empirical work can be combined, the other
two editors (G. Widdershoven and L. van der Scheer) present
a concept of empirical ethics embedded in pragmatic herme-
neutics and Aristotle’s idea of practical wisdom (phronèsis).
The second part of the book consists of 11 chapters describing em-
pirical ethics studies about various ethical dimensions of mental
health care, for example, different notions of good clini
cal care
(Ch. 5), dissimilar definitions of mental disorder among various
health professions (Ch. 6), different types of familial responsibil-
ity in caring for family members with dementia (Ch. 7), different
ways of how advance directives can retain or lose their valid-
ity (Ch. 9), different physician-client relationships in treating
Prader-Willi syndrome (Ch. 11), reasons women with anorexia

Bioethica Forum / 2010 / Volume 3 / No. 1 38
Rezensionen / Recensions / Book reviews
give to refuse life-saving interventions (Ch. 13), criminal offend-
ers’ abilities to reason morally (Ch. 14). It should be stressed that
unlike many other contributions presenting empirical ethics
findings a good part of these chapters reflect explicitly on their
choice of the methodology (linguistic analysis, participant ob-
servation techniques, grounded theory approaches and other
qualitative and semi-quantitative work) and on how they com-
bined empirical and conceptual/normative work.
The anthology closes the mentioned gaps satisfactorily and
constitutes a valuable contribution to the fields of mental
health care and medical ethics.
Daniel Strech, Hannover
Hubert Doucet (2008), Soigner en centre d’hébergement:
Repères éthiques.
Fides, Montréal, 174 pages
ISBN: 978-2762127331
Hubert Doucet, théologien et bioéthicien québécois bien
connu nous offre un petit livre où il fait montre de toute sa
riche expérience de réflexion éthique et de pratique de
l’accompagnement des équipes soignantes dans le domaine de
la gériatrie de long séjour. Sans couvrir l’entier du champ des
problématiques, il aborde des sujets délicats qui reviennent
constamment dans le débat public. L’auteur les aborde avec un
souci pédagogique évident, cherchant constamment à rendre
son propos intelligible pour un public le plus large possible.
Ceci tout en relevant le défi de ne pas simplifier à l’excès les
thèmes abondés, mais d’en montrer la complexité.
Chacun des 6 chapitres se présente avec le même schéma très
didactique, commençant par une histoire clinique ce qui l’an-
cre dans la réalité, se poursuivant sur l’analyse du problème de
manière détaillée avec présentation et discussion des diverses
opinions et directives existantes, puis revenant à l’histoire où
l’auteur montre très concrètement comment on peut faire évo-
luer la situation. Il traite successivement de: 1) La contention
avec d’emblée un regard sur la multiplicité des acteurs (pa-
tient, soignants, famille, institution) chacun ayant son inten-
tionnalité et ses valeurs; 2) L’alimentation d’un patient souffrant
de démence, élargie au problème des états végétatifs chroni-
que; 3) La réanimation ou plutôt le problème de la non-réanima-
tion avec une intéressante comparaison internationale; 4)
L’euthanasie et les interruptions de traitement où il désem-
brouille les confusions habituelles au niveau du vocabulaire;
5) La prise de décision en cas d’incapacité où il montre la néces-
sité de dépasser la rigidité de procédures formelles pour voir
l’histoire de la personne dans sa dynamique, d’un «passé qui
doit être conjugué avec le présent»; 6) Le rationnement des soins
pour les personnes âgées qui dans un élargissement du regard
hors du champ institutionnel amène à se poser la question des
objectifs du système de santé voire de la médecine.
Deux axes traversent l’ouvrage: d’une part l’accent mis sur l’in-
décidabilité de la plupart des situations évoquées qui disqualifie
tout dogmatisme ou l’idée que l’éthique sert à donner des ré-
ponses univoques. D’où l’importance que l’auteur accorde aux
différents regards posés sur une situation, mais aussi, et c’est
le deuxième axe, la nécessité de ce qu’il nomme à fort juste ti-
tre «conversation». Il cherche constamment à privilégier la dis-
cussion et le contact entre les différents acteurs plutôt que le
recours automatique à des procédures formelles.
On remarquera cependant que, comme souvent dans ce type
d’ouvrage, malgré le titre la réflexion est beaucoup plus
abordée à partir de la perspective de l’éthique médicale, déci-
sionnelle centrée sur des situations problématiques, que
d’une éthique soignante centrée sur la relation et l’accompagne-
ment au quotidien. On regrettera aussi que, pour un ouvrage
qui se veut grand-public la majorité des références bibliogra-
phiques soient en anglais. Malgré ces petits bémols, ce livre
sera très utile à ceux qui veulent découvrir comment tra-
vailler ces questions mais aussi à ceux, plus informés, qui
veulent en avoir un résumé synthétique.
Thierry Collaud, Fribourg
Marco Hofheinz (2008), Gezeugt, nicht gemacht.
In-vitro-Fertilisation in theologischer Perspektive
Ethik im theologischen Diskurs, Bd. 15, Lit-Verlag,
Münster, 670 Seiten, ISBN 978-3-03735-154-3
Die 2006 an der Universität Bern abgeschlossene theologische
Dissertation von Marco Hofheinz zur ethischen Diskussion
der In-vi
tro-Fertilisation hebt sich in verschiedener Hinsicht
von vergleichbaren bioethischen Arbeiten ab: Es handelt sich
um eine Monumentalstudie von 670 Seiten, deren Lektüre je-
doch für theologisch Interessierte durchgehend spannend und
lehrreich ist; methodisch wird eine «wahrnehmungsorien-
tierte Ethik» (108) vertreten, die an keiner Stelle den morali-
schen Zeigerfinger erhebt, sich durch Detailgenauigkeit, Sen-
sibilität gegenüber betroffenen Paaren und wissenschaftliche
Gründlichkeit auszeichnet, gleichwohl aber eine dezidiert ab-
lehnende Einschätzung der IVF vertritt (hier werde die Grenze
des Erlaubten überschritten, 573); schliesslich wird eine schöp-
fungstheologisch grundgelegte, trinitarisch (insbesondere
christologisch) interpretierte, explizit kirchliche Ethik entwor-
fen, die nicht beim Menschen-, sondern beim Gottesbild an-
setzt, welche die christliche Glaubensperspektive voraussetzt
und damit in Kauf nimmt, einen universalen Anspruch auf
Richtigkeit der Urteile und ihrer Begründungen aufzugeben,
also einen ethischen Partikularismus vertritt (182). In sieben
Kapiteln wird eine theologisch umfassende (exegetisch, pa-
tristisch, dogmengeschichtlich, ekklesiologisch, dogmatisch,
eschatologisch, ethisch und diakonisch argumentierende)
Abhandlung geboten, die 1. bei der Realität der IVF-Praxis
einsetzt, 2. eine Ethik der Geschöpflichkeit entfaltet, 3. die
philosophisch-ethische Debatte rekonstruiert, 4. die Debatte
um den Status von Embryonen aufgreift, 5. die theologisch-
ethische Debatte exemplarisch darlegt und bewertet, 6. die
Erkenntnisse trinitarisch, vor allem christologisch vertieft
und 7. danach fragt, wie die Kirche solch «unattraktive» Posi-
tionen einer anti-selektionistischen Ethik in der Öffentlich-
keit vertreten könnte.

Bioethica Forum / 2010 / Volume 3 / No. 1 39
Rezensionen / Recensions / Book reviews
Das
alles sind Gründe genug, diese Arbeit mit Gewinn zu lesen,
und es gäbe weitere hinzuzufügen. Wer so umfassend ansetzt
wie M. Hofheinz, provoziert allerdings auch kritische Rückfra-
gen. Fünf seien angedeutet: Erstens lässt sich das Problem mög-
licher Behinderungen infolge einer IVF empirisch weit weniger
eindeutig nachweisen als vom Autor behauptet. Die zweite
Rückfrage betrifft das zentrale Motiv der Studie, nämlich die
Grenze bzw. Grenzziehung. Wird beim Gottesbild angesetzt
und dabei Gottes schöpferische Selbstbegrenzung als Urbild
gewählt (69), erstaunt es nicht, dass auch das Menschenbild
vom «Pathos der Selbstbegrenzung» (87) und damit vom Ver-
zicht bzw. dem Sich bestimmen-lassen her gedacht wird. Was
fehlt, ist die hermeneutische Anerkennung der Interdepen-
denz von gewähltem Gottes- und Menschenbild. Drittens be-
steht ein Problem des in protestantischer Tradition begründe-
ten Primats der Christologie darin, den Dialog mit einer
jüdischen Schöpfungstheologie zu gefährden: Besteht hier
nicht viel mehr Kontinuität zwischen altem und neuen Bund,
als die christologische Zuspitzung dies erkennen lässt? Vier-
tens kommt angesichts des Nachdenkens über die Annahme
von Krankheit und Leiden die Unterscheidung zwischen dem
Selektieren (und Verwerfen nicht passender Embryonen) und
der Suche nach Heilung zu kurz (456): Während das Erstere
tatsächlich hoch problematisch ist, ist das Zweite auch bib-
lisch gedeckt, während die Selektion von menschlichem Leben
abzulehnen ist, ist die Linderung des Leidens an einer unfrei-
willigen Kinderlosigkeit und damit unter Umständen auch
eine IVF positiv zu gewichten. Fünftens schliesslich bleibt eine
ungelöste Aufgabe, wie der Autor mit innerkirchlichen Kont-
roversen umzugehen gedenkt. Würden solche in allen Kirchen
bestehende Kontroversen autoritär und nicht über den Aus-
tausch vernünftiger Argumente gelöst, sähen wir uns mit
neuen Fundamentalismen konfrontiert.
Wer theologisch interessiert ist, sollte sich vom Umfang des
Buches nicht abschrecken lassen. Die Lektüre ist kurzweilig,
intellektuell spannend und lehrreich. Die theologische Bio-
ethik wird damit um einen pointiert kirchlichen, gleichzeitig
wahrnehmungsorientierten, für den lei
denden Menschen sen-
siblen Entwurf bereichert.
Markus Zimmermann-Acklin, Fribourg
Ruwen Ogien, Christine Tappolet (2008), Les concepts
de l’éthique. Faut-il être conséquentialiste?
Hermann, Paris, 233 pages
ISBN 978-2-7056-6800-6
Il est courant, en philosophie morale, de distinguer et d’oppo-
ser deux types de théorie: le conséquentialisme, d’une part, selon
lequel nous devons promouvoir le bien quel que soit le prix
personnel à payer, et la déontologie, d’autre part, selon laquelle
il existe des choses que nous devons faire ou ne pas faire quel
que soit le bien qui en résulterait. Dans Les concepts de l’éthique.
Faut-il être conséquentialiste?, le but des deux auteurs – Ruwen
Ogien, directeur de recherche au CNRS (Paris) et Christine Tap-
polet, professeure de philosophie morale à l’Université de Mon-
tréal – est de confronter ces deux théories, sur la base de l’idée
que l’opposition entre conséquentialisme et déontologie re-
pose sur la manière dont ces deux théories articulent la rela-
tion entre normes et valeurs. Selon les auteurs, «le conséquen-
tialisme et la déontologie se distinguent du fait que, selon le
premier, les normes doivent être justifiées par les valeurs alors
que pour la seconde, les valeurs ne sont qu’un moyen parmi
d’autres de justifier les normes» (p. 205). Autrement que sur
des valeurs, les normes pourraient être fondées sur des faits
naturels ou bien sur d’autres normes.
Ruwen Ogien et Christine Tappolet partent de l’hypothèse
selon laquelle les valeurs doivent justifier ou fonder les nor-
mes. Si cette hypothèse est correcte, affirment les auteurs,
alors le conséquentialisme est mieux placé dans sa confron-
tation avec la déontologie.
Afin d’évaluer leur hypothèse, les auteurs proposent d’abord
une série d’arguments en faveur de la distinction entre normes
et valeurs (chap. 1 et 2). Ils examinent ensuite la possibilité de
réduire les valeurs aux normes, puis la possibilité inverse de
réduire les normes aux valeurs (chap. 3 et 4). Pour les deux phi-
losophes, parce qu’elles éliminent l’un des deux termes et ne
permettent pas de comprendre leur relation, les tentatives de
réduction font fausse route dans les deux cas. Mais si la tentative
d’expliquer les normes par des faits naturels échoue, les valeurs
semblent en revanche bien placées pour fonder les énoncés nor-
matifs. Le chapitre 5 examine la place des normes et des valeurs
dans les trois théories morales: déontologie, conséquentialisme
et éthique de la vertu. Dans le chapitre 6, les auteurs répondent
aux objections les plus courantes à l’encontre du conséquenti-
alisme. Dans le dernier chapitre, les auteurs arrivent à la conclu-
sion que si la déontologie peut être sauvée, ce n’est pas sur la
base de la distinction entre promouvoir et honorer les valeurs
– ce qui distinguerait le conséquentialisme et la déontologie
serait une différence d’attitude à l’égard des valeurs – mais sur
la base d’une distinction entre fondation ontologique et justification
épistémique des normes. Même si les normes doivent être fondées
sur des valeurs, au sens d’une fondation ontologique, certaines
normes morales fondamentales seraient toutefois relativement
indépendantes des valeurs du point de vue de leur justification
épistémique; en d’autres termes, la connaissance du devoir ne
dépendrait pas nécessairement de la connaissance des valeurs
qui le fondent.
Au travers d’une réflexion sur les rapports de fondation entre
normes et valeurs, ainsi qu’en répondant aux objections faites
au conséquentialisme, le but de l’ouvrage est la défense et la
formulation d’un «conséquentialisme raisonnable»: un consé-
quentialisme compatible, par exemple, avec la reconnaissance
des droits, et qui se limite à l’exigence négative de faire le moins
de mal possible plutôt que de maximiser le bien. La conclusion
de l’ouvrage fait ainsi le lien avec l’idée d’éthique minimale – la
morale se limite aux exigences de ne pas nuire à autrui – déve-
loppée par Ruwen Ogien notamment dans l’Ethique aujourd’hui.
Maximalistes et minimalistes (Paris, FolioEssais, 2007).
Nathalie Maillard Romagnoli, Genève
1
/
3
100%