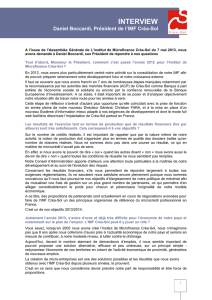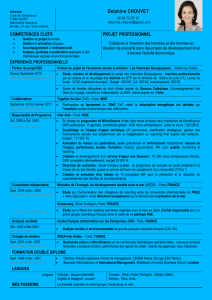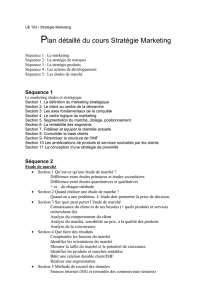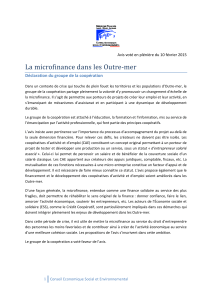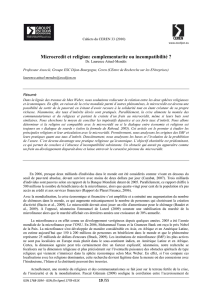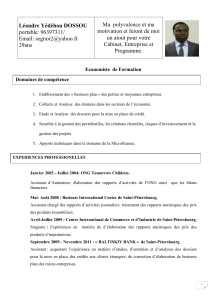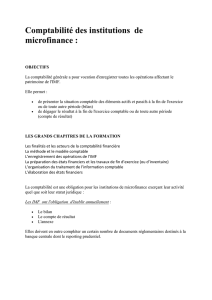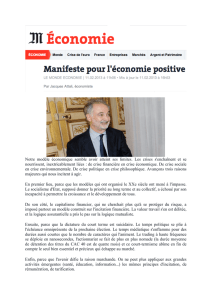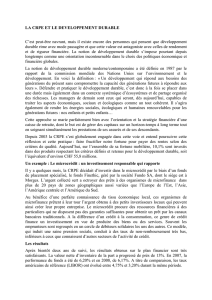Transformation et ou échec des institutions de microfinance dans l

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
193
RÉSUMÉ • Au cours de leur développement, les
institution de microfinace (IMF) intègrent l’économie
de marché et excluent des catégories pauvres, faisant
penser à un double échec : échec du modèle mutualiste
d’abord et ensuite échec de ce modèle à lutter pour la
réduction de la pauvreté. La réduction de la pauvreté
devenue un objectif mondial, il importe d’infirmer
l’hypothèse de l’inefficacité des IMF en dynamique
pour que celles-ci trouvent leur place au rang des
meilleures politiques alternatives. Sur ces points,
l’auteur montre d’abord qu’il n y a pas échec des IMF
mais bien une transformation nécessaire et compatible
avec la lutte contre la pauvreté. Il soutient ensuite que
dans un « système complet de microfinance », l’exclu-
sion ne peut pas être absolue mais relative pour un
individu doté d’un minimum de capital social ; il trou-
vera dans « le système complet de microfinance » une
institution apte à satisfaire son besoin. Quant à l’exclu-
sion absolue de l’espace de la microfinance, sa solution
relève de l’action sociale et des politiques publiques.
ABSTRACT • As they follow their development
process, the microfinance institutions (MFIs) integrate
market economy and exclude poor categories, making
think of a double failure : they fail, first as mutualist
model and second, they fail against poverty alle-
viation. As the reduction of poverty becomes a world
objective, it is important to counter the hypothesis
of the ineffectiveness of the MFIs in dynamic so that
these find their place to the rank of alternative policies
against poverty. The subject of this article is concerned
with these two points. Going into the market economy
does not mean failure. They do so because of their own
socio-economic transformation process which is in fact
compatible with poverty alleviation. About exclusion,
attention must be paid to a distinction between relative
exclusion and absolute exclusion. The first which is
Transformation et ou échec
des institutions de microfinance
dans l’espace de l’Union
économique monétaire
ouest-africaine1
S. SOULAMA
Professeur agrégé des Facultés
des sciences économiques2
UFR/SEG, Université
de Ougadougou, Burkina Faso

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
194 Économie et Solidarités, volume 35, numéros 1-2, 2004
concerned in this paper, means that in a “complete system of MFIs”, an individual
endowed with a minimum of social capital cannot be excluded absolutely ; he will
find an institution which fits his demand and his capacity. Absolute exclusion
means an individual so poor that he cannot have access to any MFI in the “com-
plete system of MFIs”. Theses cases cannot be solved by the MFI system but must
be taken in charge by others social institutions and public policies.
RESUMEN • Durante su desarrollo, las IMF integran la economía de mercado y
excluyen categorías pobres, haciendo pensar en un doble fracaso : el del modelo
mutualista, en primer lugar, y luego el de lucha por la reducción de la pobreza.
Debido a que la reducción de la pobreza se ha convertido en un objetivo mundial,
es importante invalidar la hipótesis de la ineficiencia de la dinámica de las IMF
para que éstas encuentren su lugar en el rango de las mejores políticas alterna-
tivas. Sobre estos puntos el autor pone de manifiesto, en primer lugar, que no
hay fracaso de las IMF sino una transformación necesaria y compatible con la
lucha contra la pobreza. Sostiene a continuación que en un « sistema completo de
microfinanza », la exclusión no puede ser absoluta sino relativa para un individuo
dotado con un mínimo de capital social, quien encontrará en « el sistema completo
de microfinanza » una institución capaz de satisfacer su necesidad. En cuanto a
la exclusión absoluta del espacio de la microfinanza, su solución proviene de la
acción social y de las políticas públicas.
— • —
INTRODUCTION
Deux idées fortes inspirées par les expériences de la microfinance dans
l’espace UEMOA (Union économique monétaire ouest-africaine) ont été à la
base de cet article : en premier lieu, il y a le développement quantitatif et quali-
tatif des institutions de microfinance (IMF) dans cet espace depuis le début des
années 1990 notamment. Suivant la définition de la Banque centrale des États
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO-BIT, 1997), les IMF ou les systèmes financiers
décentralisés (SFD) sont « un ensemble regroupant une variété d’expériences
d’épargne et ou de crédit, diverses par la taille, le degré de structuration, la
philosophie, les objectifs, les moyens techniques, financiers et humains, mis
en œuvre pour les populations à la base avec ou sans le soutien des parte-
naires extérieurs en vue d’assurer l’autopromotion économique et sociale de
ces populations ». La BCEAO distingue principalement trois types de struc-
tures : les coopératives ou mutuelles d’épargne et de crédit, les institutions de
crédit solidaire et les projets à volet crédit. La croissance du nombre de clients,
de guichets ouverts, de volume d’épargne ou de crédit est impressionnante3
(UEMOA-BCEAO-BIT, 1999 ; Haudeville et Dado, 2002). Leur développement
fut si rapide dans l’espace UEMOA qu’on a conçu en 1994 un cadre réglemen-
taire pour l’exercice de la profession.

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Économie et Solidarités, volume 35, numéros 1-2, 2004 195
En deuxième lieu, deux faits majeurs apparaissent dans les transforma-
tions qui accompagnent le développement des IMF : le premier fait est relatif
à ces membres de plus en plus nombreux, qui se plaignent d’être marginali-
sés par leur propre structure ; les conditions d’accès aux services financiers
sont devenues plus difficiles avec le temps de sorte qu’ils sont exposés à un
« risque d’exclusion par le bas ». Avec l’effet de sélection adverse en faveur des
riches, il existe donc un risque, tout comme le prédit la loi de Gresham4 dans
le domaine de la monnaie (Yunus, 19975, p. 95) que « le mauvais pauvre chasse
le bon pauvre ». L’expérience des caisses populaires du Burkina Faso montre,
notamment à partir des années 1990, qu’une institution de microfinance qui
a pour vocation de s’adresser à une population, tous niveaux de bien-être et
de richesse confondus, a le plus souvent tendance à écarter les clients les plus
démunis et donc à produire elle-même ses propres exclus. L’ouverture au
milieu urbain à partir des années 1990 a accru le degré d’exigence. Les clients
candidats à un crédit sont contraints de produire une garantie matérielle ou
une caution plus exigeante. Le deuxième fait est relatif à ces dirigeants de
caisses populaires qui se trouvent confrontés à la difficulté suivante : que faire
des membres, micro-entrepreneurs dynamiques, que la caisse a contribué
à former, et qui sont devenus aujourd’hui très performants à tel point que
sans modification majeure des conditions financières de fonctionnement de
la caisse, ces acteurs dynamiques se sentent à l’étroit et sont prêts à « migrer »
vers une institution financière formelle. Cette deuxième catégorie d’acteurs
est exposée à un « risque d’exclusion par le haut ».
Ces deux types de risque sont caractéristiques du développement de
l’IMF et relèvent d’une même problématique : la capacité des IMF à lutter
pour la réduction de la pauvreté dans une économie de marché tout en sauve-
gardant leur caractère mutualiste ou solidaire. Tandis que l’exclusion « vers le
haut » risque de confiner l’IMF dans un espace étroit avec en prime le respect
des principes de solidarité, l’exclusion « par le bas » intègre davantage l’IMF
dans l’économie de marché avec pour conséquence le relâchement des liens
de solidarité. Ne serait-il donc pas possible de croître sans exclure, ni « par
le haut », ni « par le bas » ? Cela est possible dès que l’on ne traite plus d’une
IMF particulière mais que l’on se situe dans l’optique d’« un système complet
d’IMF ». Il apparaît donc qu’au cours de leur développement les IMF intègrent
l’économie de marché et excluent des catégories pauvres, faisant penser à un
double échec : échec du modèle mutualiste d’abord et ensuite échec de ce
modèle à lutter pour la réduction de la pauvreté. La réduction de la pauvreté
devenue un objectif mondial, il importe d’infirmer l’hypothèse de l’ineffica-
cité des IMF en dynamique pour que celles-ci trouvent leur place au rang des
meilleures politiques alternatives. Cet article montre qu’il n y a pas échec des
IMF mais bien une transformation nécessaire et compatible avec la lutte contre

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
196 Économie et Solidarités, volume 35, numéros 1-2, 2004
la pauvreté. En outre, il est montré que, dans un « système complet de micro-
finance », l’exclusion ne peut pas être absolue mais relative pour un individu
doté d’un minimum de capital social ; il trouvera dans « le système complet de
microfinance » une institution apte à satisfaire son besoin.
Pour démontrer cette thèse, il est discuté dans un premier temps de
la nature de l’exclusion replacée dans le contexte d’un « système complet
de microfinance » ; il est possible d’expliquer ensuite par l’analyse socio-
économique, le processus de transformation nécessaire par lequel des
IMF particulières en viennent à être sélectives. Cette même analyse socio-
économique permet de concilier la croissance de l’IMF avec la lutte contre la
pauvreté. Les IMF auxquelles se réfère cette analyse sont celles qui ont un fon-
dement mutualiste ou solidaire, qu’elles soient formelles ou informelles. Elles
ont été tirées des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine,
notamment du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal6.
LA DYNAMIQUE D’EXCLUSION DANS UN SYSTÈME
COMPLET D’INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
Les IMF à fondement mutualiste ou solidaire sont contraintes, dans une éco-
nomie de marché, d’arbitrer entre leur objectif spécifique de développement
économique et social dans la solidarité et l’objectif normatif de rentabilité
économique et financière (Gentil et Fournier, 1993 ; Guérin, 2000 ; Haudeville,
2001 ; Parodi, 2000). Pour ce faire, elles exigent une garantie de plus en plus
substantielle, excluant certains clients pauvres. Les IMF peuvent produire
ainsi leurs propres exclus. Mais si l’on se situe dans l’optique d’un « système
complet d’IMF » l’exclusion est relative et non absolue. Dans cet espace, la
transformation d’une IMF particulière est nécessaire et compatible avec la
lutte contre la pauvreté. La définition préalable du système complet d’IMF
permettra de distinguer les deux modes d’exclusion : l’exclusion relative
d’un individu et son exclusion absolue, de relier celles-ci à la nécessaire
transformation de l’IMF qui en est la cause.
Le « système complet d’IMF »
À partir d’une typologie des IMF fondée sur la garantie exigée, on peut
construire un système complet d’IMF. Ce système sera constitué d’un conti-
num d’IMF différentes les unes des autres par leur système de garantie ; la
garantie est plus ou moins sélective d’une IMF à une autre. Admettons que
la garantie minimale (la moins sélective) soit l’appartenance à un groupe de
caution solidaire, appartenance qui est fonction du capital social de l’indi vidu.
Plus généralement, le capital social est défini comme la densité des rapports

© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de: Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves
et R. Schediwy, responsables • EES3501N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Économie et Solidarités, volume 35, numéros 1-2, 2004 197
sociaux d’un individu, de son insertion sociale. Formellement, le « système
complet d’IMF » est un ensemble E formé d’un continuum d’IMF tel que :
E ={IMF1, IMF2, IMF3, … IMFi, … IMFN}.
Les IMF sont différentes les unes des autres et elles peuvent être ordon-
nées elles-mêmes selon un degré d’exigence croissante de leur système de
garantie, de la manière suivante : IMF1 < IMF2 < IMF3 … < IMFi … < IMFN.
L’IMF1 est moins exigeante que l’IMF2, elle-même, moins exigeante que
l’IMF3 et ainsi de suite. La garantie la plus faible, celle exigée par l’IMF1 est
par hypothèse l’appartenance à un groupe de caution solidaire. On parle de
système complet parce que l’union des IMF, IMF1∪ IMF2 ∪ IMF3….∪ IMFi
…..∪ IMFN couvre tout l’espace de la microfinance de sorte que toute tran-
saction financière quelle qu’elle soit, répondant aux conditions minimales,
celles de l’IMF1 (la capacité d’appartenir à un groupe de caution solidaire),
trouve sa place dans le système microfinancier. Une comparaison7 peut être
faite avec le système de distribution des marchandises (Haudeville et Dado,
2002). Les banques formelles seraient en fait des grossistes des transactions
financières, les mutuelles et coopératives d’épargne et de crédit seraient des
demi- grossistes, les institutions de crédit solidaire seraient l’échelon intermé-
diaire équivalent de la grosse épicerie ou de la supérette et, enfin, la finance
informelle pourrait être assimilée aux détaillants qui recyclent de petits lots de
produits. On serait alors en présence d’un « système financier complet », selon
qu’on traite de la globalité du système financier, ou d’un « système micro-
financier complet » selon qu’on traite de la seule microfinance. Comme indi-
qué, au sens large, on peut inclure dans le « système complet de micro finance »
toutes les institutions de microfinance formelle et informelle allant des coo-
pératives et mutuelles d’épargne et de crédit aux tontines en passant par le
crédit solidaire, etc. ; dans ce cas, l’ensemble sera borné au niveau inférieur
par les institutions de la finance informelle. Dans une analyse plus restrictive
qui exclurait la finance informelle, le « système complet de microfinance » est
borné à son niveau inférieur par les modèles de type crédit solidaire et à son
niveau supérieur par les mutuelles d’épargne et de crédit dont les garanties
sont assimilables dans certains cas à celles demandées par les banques com-
merciales. Que signifie alors l’exclusion d’une catégorie socioéconomique de
l’accès à cet espace d’IMF ?
L’exclusion relative d’un individu ou d’une catégorie
L’analyse des IMF montre que le passage de la caution solidaire comme garan-
tie à l’épargne préalable (forme de garantie supérieure, plus exigeante) se tra-
duit par l’exclusion des membres très pauvres pour qui la garantie morale est
la seule qu’ils peuvent mobiliser. Mais si cette population pauvre est dotée
d’un « capital social », son exclusion par une IMFi particulière est relative, car
elle n’est pas exclue pour autant du « système complet de microfinance » qui
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%