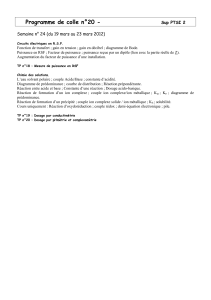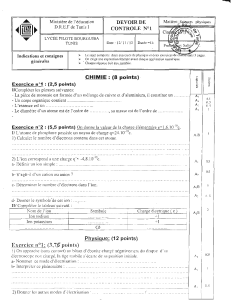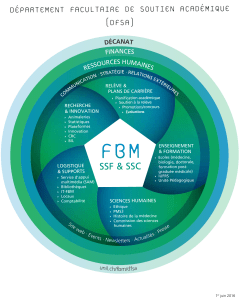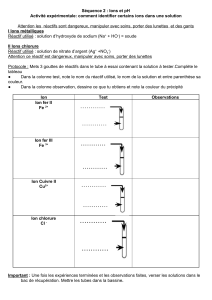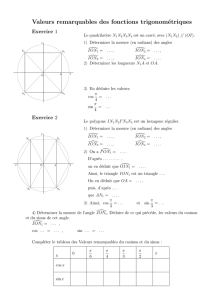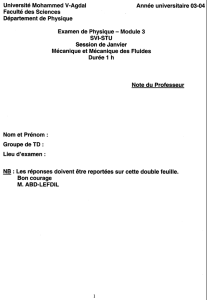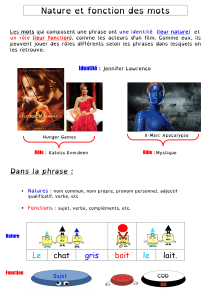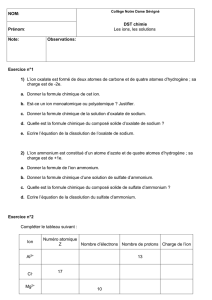la logique de l`argumentation

LA LOGIQUE DE L 'ARGUMENTATION
NYNFA BOSCO
La présence, pour ainsi dire, philosophique de Ch. Perelman s'est
révélée à moi en 1954; quant à sa présence physique, quat re ans en-
core devaient passer avant qu'une rencontre, qui eut lieu à Venis e
l'occasion du X I I ' Congrès I nternational de philosophie, m' en con-
sentît la première expérience. Ma découverte paraîtra tardive si l ' on
pense à l'activité et à la solide renommée, qui l'ont rendu très connu,
depuis bien plus longtemps, même hors d'Europe.
Ce fut, toutefois, assez précoce pour mo i qui n'avais t erminé mes
études universitaires que depuis peu d'années. Dans tous les cas ce
fut le début d'un intérêt qui dev int une appréciation sincère, a u f ur
et à mesure que les années passaient et que ma connaissance deve-
nait plus profonde.
Ce qui m'at t ira dès le début, dans l'ceuvre de Perelman, ce f ut l'in-
tensité, et plus encore la qualité de l'intérêt qu'il mont rait pour toute
la partie de notre expérience, qu i ne se laisse n i ex primer pa r les
langages f ormalis és o u formalis ables des sciences logic o-mathéma-
tiques, ni reconduire à des protocoles analogues à ceux dont se servent
les sciences physiques.
L'atmosphère philos ophique que j'avais trouvée, en y entrant à d i x -
huit ans, à l'Universit é de Turin était la plus adaptée à favoris er une
tendance nat urelle à m'intéresser à la c ondit ion humaine, sans res-
triction. Tandis que Nicola Abbagnano nous enseignait, par l'ex emple
de ses cours d'his t oire de la philosophie, qu'on ne doit pas déraciner
les théories des situations et des personnalités où elles naissent, l'en-
seignement théorétique d'Augusto Guzzo q u i pour moi dure, dans
un certain sens, encore aujourd'hui, dans l'habitude d u t rav ail en
commun r a p p e l a i t énergiquement not re attention s ur l'homme et
sur la variété de ses entreprises spirituelles, en la ret enant souvent
sur l'effort, bien humain, de jus tif ier par l'argument at ion cela encore
qui ne saurait être logiquement démont ré (
1
) .
Je commençai, alors, à sent ir la menace d' un danger qui, encore
de nos jours, semble peser lourdement s ur la pensée contemporaine.
Je veux dire le danger que, e n oscillant parmi les manifes tations de
(') Ce thème rev ient avec u ne t elle fréquenc e dans la s érie de volumes
qu'Auguste Guzzo a dédié à L'homme, et plus spécialement dans le premier
de ceux -la: Le moi et la raison, qu'il m'est impos sible de renvoy er le lecteur
a des passages particuliers .
40

l'irrat ionalisme, telles que les existentialismes négatifs et les dif f é-
rentes espèces de pragmatisme, et un nouveau genre exigeant e t res-
treint de rationalisme, tel que l'est la philosophie analytique dans ses
différentes formes, on se trouve obligé de déclarer que de larges et im-
portantes zones de l'expérience humaine sont rationnellement inc on-
trôlables. Dans cette situation la tentative que Perelman était en t rain
d'accomplir, d e f onder une logique de l ' a r g
-
u m e n t a t i o n , n e
p o u v a i t
que soulever mon plus v if intérêt. Elle me parut en effet, et me paraît
encore, c omme la tentative de t rouv er une voie qui nous permette de
nous év ader de l'alt ernativ e, q u i v oudrait oppos er l a connaissance
rigoureusement formalisable a u manque absolu de connaissance, l a
parfaite démons trabilit é à l'irrat ionalit é absolue. Da ns l a perspec-
tive proposée par Perelman, entre la démonstrabilit é et l ' i r r a t i o n a
l i
t é
se place en effet la possibilité de l'argunentat ion: entre l e discours
formalisé et le discours insensé se plac e le discours rhét orique.
Ce dernier mot pourrait sembler ambigu. I l f aut ici un éclaircisse-
ment. Perelman l u i donne une signification tout e particulière, qui se
rattache à l'usage aristotélique. Dans le premier liv re de la Rhét ori-
que, Aristote af f irme v ouloir t rait er les arguments «sur lesquels nous
devons délibérer, et desquels nous n' av ons aucune technique, devant
des auditeurs q ui ne sont pas à même d'inf érer à travers plus ieurs
degrés, et de suivre un raisonnement d'un point lointain», et aussi de
vouloir traiter des raisonnements qui concernent l'opinable et le v rai-
semblable, c'est-à-dire, des rais onnements bi en dif férents d e c eux
dont i l s'était occupé dans les «Analytiques», concernant le v ra i et
surtout le nécessaire.
Les af f irmations d'Aristote sont elles-mêmes, à v rai dire, ambiguës;
en contenant plusieurs références elles se prêtent à plus ieurs int er-
prétations. Elles pourraient, par exemple, suggérer l'idée que la rhéto-
rique trouve sa propre justification dans l'ignoranc e de c elui qui parle,
ou dans l'incapacité de c elui qui écoute, ou dans les deux. Elles pour-
raient ins inuer la sensation que le discours rhét orique est le discours
d'un incompétent, v is ant a u b u t purement prat ique d'obt enir, p a r
toutes sortes de moyens empiriques ou même trompeurs, le consente-
ment d'autres incompétents. Elles pourraient f aire paraître la rhétori-
que c omme un mauvais succédané de la philosophie, c omme le v rai-
semblable, qu'elle aurait pour objet, n'est qu' un mauv ais succédané
du vrai.
Mais les paroles d'Aristote semblent aussi suggérer que la rhét ori-
que a son propre champ, dans lequel elle n'est pas remplagable: l e
champ des jugements délibératifs, concernant non pas le nécessaire
ou l e vrai, mais le possible et le préférable.
41

C'est précisement à cette suggestion que Perelman se rattache. I l
sait bien que ce sont les significations négatives qui ont prévalu. Mais
il croit pouvoir en trouver la raison dans une suite de malheureuses
circonstances historiques, qui sont en t rain de s'épuiser de nos jours,
et qu'il ne vaut pas la peine en tous les cas de perpétuer.
C'est ains i qu' un monis me de v aleurs aurait été instauré dans l a
pensée grecque des derniers siècles, a u début grâce au platonisme,
ensuite grâce au stoïcisme et au néo-platonisme, q u i l' aurait rendu
peu sensible a u problème de f onder logiquement les jugement s de
valeurs. L a f orc e même de ses convictions philosophiques et r e l i-
gieuses aurait plus t ard forcé le Moy en Age à conserver, en l'accen-
tuant, la tendance à t rans former les problèmes de v aleur en problè-
mes de vérité. Quant à l'humanis me, q u i f êla l'unit é des certitudes
moyenâgeuses, i l n' aurait pas su f aire renaître l'int érêt pour les dis-
cours rhétoriques et argumentatifs à cause d' un princ ipe p a r lequel
il se serait laissé dominer dès le début: le principe de l'évidence, soit
de l'évidence int érieure du protestantisme, s oit de l'év idence rat ion-
nelle du cartésianisme, s oit de l'évidence sensible de l'empiris me.
Dans un horiz on spirituel dominé par la logique de l'évident et du
nécessaire, de ce q u i ne peut pas ne pas paraître v rai à t out e s p
-
A t
normal, il n' y avait point de place pour la logique du préférable, de
ce q u i s eulement mérit e d'êt re univers ellement reconnu. Sous c et
aspect l'idéalis me et le positivisme qui dominèrent, par une sorte de
oconcordia discors», la pensée philosophique d u X I X
è
m e s i è c l e r e p r é -
sentent le terme d'une parabole, commencée plus de trois siècles au-
paravant.
Il semble, aujourd'hui, que le moment est v enu de prendre enf in
en sérieuse considération l a référence aristotélique a u x argument s
rhétoriques, c omme à ces arguments dont nous nous servons «quand
nous devons délibérer», et qui ne concernent pas le v rai ou le néces-
saire, mais le possible. Cert ains mot ifs qu i pouv aient dans l e passé
justifier, au moins en partie, l' illus ion que l a logique de l'évidence
est la seule possible sont tombés. A côté des sciences physico-mathé-
matiques, qu' on considérait dans le passé c omme les seules sciences
possibles, d'autres sciences se sont constituées: ce sont les ains i nom-
mées sciences de l'esprit, où ne joue pas l'appel à l'évidence et à la
nécessité.
Ce qui est plus, c'est que les sciences mêmes phy s ico-mathémati-
ques Ont cessé de considérer leurs théories c omme l a v is ion obligée
d'une v érit é nécessaire, et ont commencé à s'appuyer non plus s ur
l'évidence mais sur la cohérence, no n plus s ur la nécessité mais s ur
l'opportunité. Donc , si, encore i l y a u n siècle, c elui qu i aurait dé-
42

montré le t héorème d'Euclide pouvait être tenu, grâce à ce seul fait,
en même temps pour rat ionnel et pour raisonnable, et même pour
raisonnable parce que rationnel, par ce fait même nous pouvons nous
considérer de 110S jours c omme raisonnables seulement. Nous savons
en ef f et que la géomét rie euclidienne n'est qu'une par mi les nom-
breuses géométries qui sont possibles, n'étant pas plus rat ionnelle ni
plus évidente que les autres. Par conséquent nous ne pouvons en jus-
tifier l'adoption qu'en mont rant que not re c hoix a été, ét ant donné
les circonstances, justement le plus raisonnable.
Nous sommes donc dans les condit ions les plus favorables pour
comprendre que toutes les oeuvres humaines, les plus spéculatives
même, impliquent une opt ion, u n jugement de valeur, de t elle ma-
nière que l a logique de l a déduction présuppose t oujours une logi-
que de l'invention, ou mieux du choix. Or, u n argument rhét orique
est précisément un jugement de valeur, ains i qu'une logique de l'ar-
gumentation est une logique du choix. Perelman est t out à f ait ex -
plicite sur ce point. Les arguments rhétoriques ne sont jamais s i évi-
dents qu'ils ne laissent à l' audit eur une large marge d'appréciation,
une libert é de décision, q u i f ont de son adhésion u n acte dont l e
sujet doit av oir la responsabilité. C'est pourquoi, ains i qu ' i l s 'expri-
me l u i même, la logique de l'argumentation est une logique des juge-
ments de v aleur concernant non le v rai mais le préférable, où l' ad-
hésion n'est jamais une s imple soumission mais toujours une déc i-
sion et un engagement.
Par conséquent elle int roduit dans not re t héorie de la connaissan-
ce un élément nouveau, qui permet de ne pas borner le débat à l'ac-
ceptation o u a u ref us, sans plus , d ' u n rat ionalisme q u i considère
comme seuls valables les seuls procédés scientifiques. E lle consent,
d'après les propres mots de Perelman, de «briser les limit es de l' al-
temative: objectivis me sans s ujet ou subjectivisme sans objet» (Phi-
losophie et Rhétorique, p. 48). Ce qu i rend possible c e remarquable
résultat c'est la distinction, exempte de complexes soit de supériorité
soit d'infériorit é, que le f ait de posséder une logique de l'argrumen-
tation nous permet d'établir entre le discours s c ientif ique et le dis-
cours philosophique. Nous voyons alors qu'ayant une fonction et une
nature différentes ils ne sauraient n i s'exclure n i se remplac er. Les
traits q ui les distinguent, et dans une certaine mesure, les opposent
sont nombreux et bien connus. Nous ne nommerons donc que les
principaux.
Le discours scientifique es t objectif, public , émot iv ement neutre,
et dans un certain sens, collectivement possible à atteindre. I l n' y a
pas de découverte, quelque géniale qu'elle soit, qui, une f ois faite,
43

ne puisse être refait e n'import e quand par tous ceux qui possèdent
la compétence suffisante. Ses énoncés s ont des passages logiques
(dans les sciences formelles) ou des faits d'expérience (dans les scien-
ces naturelles). Ils ont un caractère pérempt oire; ils prétendent à une
reconnaissance universelle, mais , e n mê me temps, i l ne souffrent
aucune perte lorsque cette reconnaissance le ur est refusée par quel-
ques personnes. Ces personnes sont s implement repoussées, a cause
de leur refus même, dans le monde négligeable des incompétents.
La science fait alors recours a ce que Perelman appelle, avec Ferdi-
nand Gonseth, le «principe de technicité». Elle f ait recours à sa con-
science collective et réussit, de cette manière, à passer au-dessus de
ses divergences intérieures. Ce que cette conscience considère accep-
table, c'est-à-dire intégrable au patrimoine de ses notions précédem-
ment acquises, reste dès lors définitiv ement prouvé.
Une théorie scientifique pourra néanmoins être sujette à une rév i-
sion, elle reste même cont inuellement sujette à une révision a cause
des nouvelles expériences qui peuvent toujours se présenter, et qu',ffle
doit chaque fois intégrer. Mais cela ne s ignifie pas qu'elle sera aban-
donnée, elle sera seulement redimensionnée, placée dans une nou-
velle perspective, ains i qu ' il est arriv é pa r exemple à l a phys ique
classique, au f ur et a mesure que la physique atomique s'est imposée
de plus en plus. Nous pourrions appeler ce principe «principe de cor-
rigibilité». Grâce a celui-c i, dans la science beaucoup s e crée, r i en
ne se détruit.
La connaissance philosophique est t out e différent e. El le est s ub-
jective, privée, émotiv ement qualifiée. On peut la poursuivre unique-
ment dans la recherche personnelle. Ses énoncés ne concernent pas
des faits d'expérience ni des passages logiques, mais des valeurs ; ils
n'ont rie n d e péremptoire, il s mérit ent u n consentement univers el
mais ils ne sauraient l'imposer. En même temps, et justement parc e
qu'ils ne peuvent pas s'imposer, ils ont besoin d'être aimés , choisis
et défendus, et souffrent de tout e reconnaissance q u i leur est niée,
bien que, même dans ce cas, ils conservent toute leur validité.
Le princ ipe de technicité n'a auc une légitimité dans le c hamp de
la philosophie. Le philosophe ne peut pas, c omme le f ait l'homme de
science, repousser les objections des adversaires en qualif iant ceux -
ci d'incompétents, parce que le c rit érium de la compétence renvoie
dans s on cas a ux fondements mêmes de sa pensée et l'oblige pa r
conséquent à une «pétition de principe». I l n'y a en effet aucune con-
science collective a laquelle i l puisse faire recours, et i l n' a pas l a
possibilité d'int égrer les résultats de sa recherche au pat rimoine phi-
losophique précédemment constitué.
44
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%