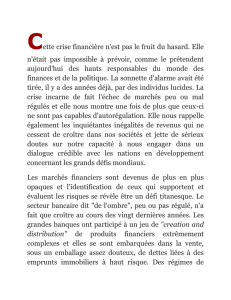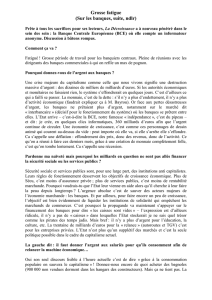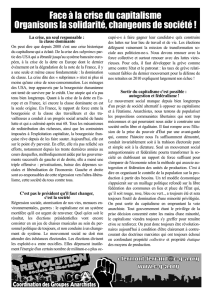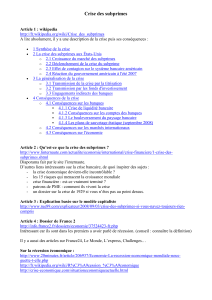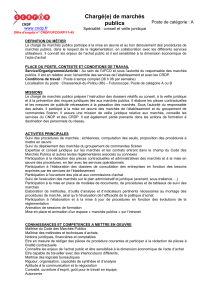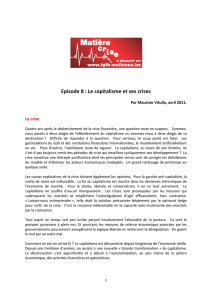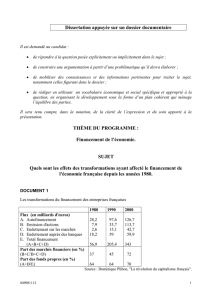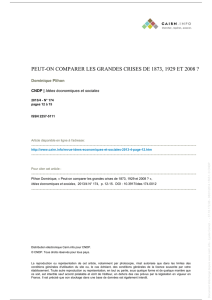la crise des subprimes : une crise historique du capitalisme

LA CRISE DES SUBPRIMES : UNE CRISE HISTORIQUE DU
CAPITALISME
Dominique Plihon
CNDP | Idées économiques et sociales
2013/4 - N° 174
pages 6 à 11
ISSN 2257-5111
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2013-4-page-6.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plihon Dominique, « La crise des subprimes : une crise historique du capitalisme »,
Idées économiques et sociales, 2013/4 N° 174, p. 6-11. DOI : 10.3917/idee.174.0006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour CNDP.
© CNDP. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP

6
DOSSIER I Crise et régulation nancière
idées économiques et sociales I n° 174 I décembre 2013
ces croyances. Dans le domaine de la nance, cette
conception a donné naissance à l’hypothèse d’«e -
cience des marchés», qui s’était imposée à la veille de
la crise tant dans le monde académique que profes-
sionnel. Cette crise nancière démontre le caractère
fallacieux de ce paradigme. Il faut lui substituer une
approche alternative et beaucoup plus réaliste de la
nance, initialement proposée par J.M.Keynes, selon
laquelle les crises sont endogènes au cycle nancier et
inhérentes au fonctionnement de la nance dont les
mécanismes sont spéci ques.
L’une des erreurs des économistes orthodoxes est
de postuler que le marché des actifs nanciers est un
marché ordinaire sur lequel s’applique la tradition-
nelle loi de l’o re et de la demande. Selon cette loi,
le prix joue un rôle d’ajustement: si la demande est
trop forte, le prix monte et cette augmentation fait
baisser la demande et croître l’o re. Or, il n’en va
pas de même sur les marchés des actifs nanciers et
du crédit. Car les actifs nanciers sont des éléments
de valorisation de la richesse; donc, lorsque les prix
montent, la demande augmente! C’est l’e et de
richesse bien connu des économistes. De son côté, le
crédit est lié au prix des actifs. En e et, plus le prix des
actifs augmente, plus nombreux sont les acheteurs à
s’endetter, puisqu’ils peuvent gager leur dette sur des
Une crise idéologique et intellectuelle
La crise qui éclate en 2007 est l’aboutissement
d’une transformation profonde de l’économie et de
la société qui s’est produite à partir des années1980
sous l’e et de la doctrine néolibérale devenue «la
nouvelle raison du monde3», et dont les hérauts
furent au départ M.Thatcher et R.Reagan. Le
principal précepte des politiques néolibérales est
la dérégulation tous azimuts du marché du travail,
des échanges, des mouvements de capitaux. Leur
objectif est de «libérer» l’économie de l’emprise
supposée néfaste des politiques publiques. L’une
des conséquences majeures de ces politiques a été
le développement vertigineux de la finance, qui
a donné naissance à un «nouveau capitalisme» [3]
dominé par la nance. La doxa néolibérale est fondée
sur la croyance que l’économie de marché s’autoré-
gule, car les marchés tendraient spontanément vers
l’équilibre. Cette conception aboutit à deux conclu-
sions: d’une part, les politiques publiques de régu-
lation nancière sont inutiles, et souvent néfastes;
et d’autre part, s’il peut y avoir des crises, celles-ci
sont temporaires et liées à des chocs exogènes (une
innovation, une guerre, une mauvaise récolte). Toutes
les politiques de dérégulation et les innovations nan-
cières des trois dernières décennies sont basées sur
La crise des
subprimes
:
une crise historique
du capitalisme
La crise des subprimes qui a éclaté aux États-Unis en 2007 et s’est propagée à l’éco-
nomie mondiale, a donné lieu à une abondante littérature. La plupart des économistes y
ont vu principalement le résultat d’un dysfonctionnement du système fi nancier. Il s’agit
en réalité d’une crise beaucoup plus profonde du capitalisme contemporain, dans la
lignée des grandes crises de 1873 et 19291. Pour comprendre la spécifi cité de cette
crise, il est bien sûr nécessaire de décrire les mécanismes fi nanciers qui ont contribué
à son déclenchement2, mais il est tout aussi important de faire apparaître la nature
systémique de cette crise, qui se manifeste par son caractère pluridimensionnel – idéo-
logique, social, politique et écologique.
Dominique Plihon,
Centre d’économie de
Paris-Nord, université
Paris 13 Sorbonne
Paris Cité
1 Voir notre article « Peut-on
comparer les grandes crises de
1873, 1929 et 2008 ? » dans ce
même numéro, p.12.
2 Voir à ce sujet deux
publications de la
Documentation française citées
dans la bibliographie [1] et [2].
3 Titre du livre de Pierre
Dardot et Christian Laval, La
Découverte, 2009.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP

Crise et régulation nancière I DOSSIER
7
décembre 2013 I n° 174 I idées économiques et sociales
actifs de plus en plus chers. Ce sont précisément ces
mécanismes qui ont produit les bulles immobilières
qui ont été au cœur de la crise nancière récente. En
réalité, sur les marchés d’actifs nanciers, le prix ne
peut jouer le rôle d’ajustement. Les marchés nan-
ciers fonctionnent selon des lois qui ne sont pas celles
du marché des biens et services ordinaires. L’une des
conclusions majeures qui se dégage de cette analyse
est que, contrairement aux recommandations du
paradigme néolibéral, les marchés nanciers doivent
être étroitement régulés par les autorités publiques
dans la mesure où, loin de s’autoréguler, ceux-ci sont
fondamentalement instables [4].
La fi nance moderne mise en échec
La crise qui a débuté en 2007 conduit à une
deuxième leçon: la remise en cause des propriétés
supposées de la finance moderne4. La crise a en
e et révélé que la nance contemporaine n’est pas
en mesure de remplir ses deux fonctions princi-
pales, telles qu’elles sont énoncées dans la plupart
des manuels d’économie: d’une part, permettre
l’allocation optimale des ressources nancières, en
assurant le transfert de celles-ci vers les emplois les
plus utiles pour la société et, d’autre part, favoriser
la gestion des risques. Dans ces deux domaines, il y a
un fossé considérable entre la réalité et la vision théo-
rique enseignée dans les meilleures universités [5]. La
nance internationale contribue à polariser les ux
nanciers sur un nombre limité d’acteurs et de pays,
alors qu’elle devrait se diriger vers les pays en déve-
loppement où la rareté du capital est la plus grande.
C’est ainsi que moins de 50% des investissements
directs à l’étranger, qui servent à la construction
d’usines et au rachat d’entreprises, vont vers les pays
en développement (y compris les pays émergents)
alors que ces derniers représentent 80% de la popula-
tion mondiale [6]. L’un des chefs de le de l’économie
néoclassique, le prix Nobel Robert Lucas, a quali é
de «paradoxe» cette contradiction entre les faits et
la théorie en ce qui concerne l’allocation du capital
dans l’économie mondiale [7]. Le paradoxe de Lucas
n’est-il pas en réalité un aveu d’échec?
Si l’on s’intéresse maintenant à la deuxième fonc-
tion supposée des marchés nanciers – leur capacité
à gérer les risques –, la crise actuelle lui apporte
également un cinglant démenti. La nance moderne
a bouleversé les modalités de l’intermédiation
bancaire. Soumises à la double pression des exigences
de rendement des actionnaires, et des normes de
supervision prudentielle, les banques ont transformé
leur activité et innové. Pour atteindre cet objectif,
ces dernières ont développé deux axes stratégiques.
Elles ont mis en œuvre une nouvelle forme d’inter-
médiation, quali ée d’«intermédiation de marché»,
fondée sur une activité intense sur les marchés nan-
ciers, ce qui a constitué une nouvelle source de
pro ts. En second lieu, pour satisfaire les exigences
prudentielles, et en particulier le ratio de fonds
propres, les banques ont cherché à sortir de leurs
bilans une partie de leurs actifs et de leurs risques.
Cette stratégie a amené les banques à faire un usage
massif des produits dérivés et surtout de la titrisation
des créances. Innovation nancière majeure, la titri-
sation consiste à transformer des crédits bancaires en
titres négociables pour les vendre à des investisseurs,
ce qui permet de transférer du crédit, et donc des
risques, du bilan des banques vers celui d’institutions
non bancaires. Les banques se sont ainsi éloignées
du modèle d’intermédiation traditionnel, dénommé
originate to hold, dans lequel elles accordent des crédits
et les gardent dans leur bilan jusqu’à l’échéance en
contrôlant la qualité et les résultats de l’emprun-
teur. La titrisation a favorisé l’adoption d’un modèle
nouveau originate to repackage and sell, dans lequel les
banques continuent certes d’accorder des crédits,
mais avec l’idée de les restructurer et de les vendre
au plus vite. Sachant qu’elles ne porteraient pas les
risques liés à leurs opérations de nancement, les
banques commerciales ont eu tendance à s’exposer
à des prises de risques excessives, dans une pure
logique d’aléa moral. Dans ce modèle d’intermédia-
tion, les banques commerciales ne remplissent plus
leurs fonctions traditionnelles – nancer l’économie
et contrôler les risques – qui sont transférées à des
acteurs non bancaires, principalement les banques
d’investissement et les fonds spéculatifs. S’est ainsi
constitué un secteur bancaire parallèle, quali é de
«shadow banking system» (la banque de l’ombre),
qui échappe largement au contrôle des autorités de
supervision, et qui a été le principal rouage de la crise
des subprimes [8]. En e et, les banques d’investisse-
ment en charge de la titrisation se sont mises à mixer
des risques de nature di érente, créant des produits
complexes dont le risque est difficile à évaluer.
L’opacité des opérations s’est trouvée renforcée du
fait que les produits titrisés sont échangés sur des
marchés de gré à gré non régulés. Il faut ajouter à
4 L’attribution du prix 2013
de la Banque royale de Suède
en sciences économiques,
communément appelé « prix
Nobel d’économie » à trois
économistes – Eugene Fama,
Lars Peter Hansen et Robert
Shiller – qui défendent des
approches contradictoires sur
le fonctionnement des marchés
fi nanciers, illustre la crise de la
théorie fi nancière moderne.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP

8
DOSSIER I Crise et régulation nancière
idées économiques et sociales I n° 174 I décembre 2013
victime de ses contradictions. Le fonctionnement de
ce régime de croissance peut être caractérisé comme
suit: la mondialisation néolibérale (libre circulation
des marchandises et des capitaux) a élargi les oppor-
tunités de placements nanciers en même temps
qu’elle mettait en concurrence les travailleurs de
tous les pays, pesant ainsi sur les salaires dans les pays
avancés; le partage de la valeur ajoutée s’est déplacé
dans la plupart des pays en faveur des pro ts et au
détriment des rémunérations salariales (y compris
les transferts sociaux); par ailleurs, le partage des
pro ts s’est modi é en faveur des actionnaires, et
au détriment de l’épargne des entreprises (auto -
nancement). Les inégalités de revenus se sont forte-
ment creusées avec la montée des revenus du capital
concentrés sur une minorité de ménages, le renfor-
cement des salaires élevés et le développement des
emplois à bas salaires, ce qui a été démontré par les
travaux de P.Krugman [10] et de T.Piketty [11, 12]
sur les États-Unis et la France. De plus, les politiques
publiques de redistribution scales et sociales ont été
réduites sous la pression de la concurrence interna-
tionale exacerbée par la mobilité internationale des
capitaux5.
La stagnation des revenus bas et moyens aurait
dû entraîner un ralentissement de la demande des
ménages. Mais le système financier a permis aux
ménages d’accroître leurs dépenses à la fois en favo-
risant leur endettement – le taux d’endettement des
ménages a doublé en France et aux États-Unis –, et
en faisant jouer des e ets de richesse. Deux facteurs
ont joué un rôle moteur dans ce processus de nancia-
risation et d’endettement des ménages: d’une part,
la libéralisation nancière qui a a aibli – allant même
jusqu’à les supprimer aux États-Unis – les règles de
ce tableau les agences de notation qui n’ont pas joué
leur rôle d’évaluation externe des risques, piégées
par des con its d’intérêt, ce qui a amené celles-ci
à attribuer la même note AAA à des bons du Trésor
sans risque et à des produits structuréscontenant des
actifs «toxiques»! La titrisation, innovation phare
de la nance moderne, n’a pas pour rôle de faire
porter les risques par les agents supposés être les
plus aptes à les porter, comme on l’a rme souvent.
Elle tend plutôt à accroître le niveau global du risque
dans le système nancier. La crise nancière a préci-
sément résulté d’une concentration extraordinaire
des risques sur une minorité de banques et de fonds
d’investissement (notamment les hedge funds). Ce qui
s’est produit dans le système nancier international
est tout simplement le contraire d’une gestion e -
cace des risques, qui aurait dû être fondée sur les
principes d’évaluation, de maîtrise et de diversi ca-
tion des risques.
Une crise de nature systémique
La phase de profonde instabilité qui a secoué l’éco-
nomie mondiale à partir de 2007 ne peut être réduite
à une crise nancière. Il est essentiel de pousser l’ana-
lyse plus loin. Car il s’agit en réalité d’une crise du
capitalisme nanciarisé et mondialisé qui s’est mis
en place, il y a trois décennies, sous l’impulsion des
politiques néolibérales [9]. Cette crise est systé-
mique pour plusieurs séries de raisons. En premier
lieu, celle-ci frappe d’abord les pays qui constituent
le centre du capitalisme mondial, à commencer par
les États-Unis, à la di érence des crises récurrentes
des années1990 qui s’étaient abattues sur les pays
émergents de la périphérie. Cette crise peut être
interprétée comme le résultat d’un épuisement
du régime de croissance nanciarisé et mondialisé,
“ Ce qui s’est produit dans le système fi nancier
international est le contraire d’une gestion
effi cace des risques, qui aurait dû être fondée
sur les principes d’évaluation, de maîtrise
et de diversifi cation des risques ”
5 C. Ramaux, L’État social.
Pour sortir du chaos néolibéral,
Mille et une nuits, 2012.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP

Crise et régulation nancière I DOSSIER
9
décembre 2013 I n° 174 I idées économiques et sociales
constaté que l’empreinte écologique de l’homme –
qui mesure le degré d’utilisation de la nature par les
activités humaines de production et de consomma-
tion6 – est supérieure à 100% depuis les années 1970.
En d’autres termes, le système économique actuel
conduit depuis quatre décennies à une réduction
du capital naturel à la disposition de l’humanité. La
recherche de rendements nanciers élevés a été satis-
faite en grande partie par une surexploitation, non
seulement du travail, mais également de la planète
et de son écosystème. Ce modèle de développement
productiviste et extractiviste a atteint ses limites,
comme le montrent notamment les perspectives
prochaines d’épuisement des ressources naturelles
non renouvelables7. La notion de développement
durable, qui «répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs» et avait été proposée dans les
années1980 par un rapport des Nations unies, est
d’une grande actualité8. La question posée en ce début
de esiècle est celle de la transition vers un nouveau
mode de développement, respectueux de l’environ-
nement9. Cette évolution s’impose d’une manière
critique pour faire face à l’augmentation prévue de
50% de la population mondiale à l’horizon 2050.
L’Union européenne, maillon faible
de l’économie mondiale
L’Union européenne, et singulièrement la zone
euro, a moins bien résisté que les autres régions du
monde face au choc de la crise de 2007, ce qui est
illustré par une récession plus durable et des taux de
chômage record, dépassant 50% pour la population
active jeune dans les pays les plus touchés par la crise.
Cette vulnérabilité provient de l’incomplétude de
la construction européenne et de l’incohérence des
politiques économiques. La construction européenne
repose sur deux piliers, l’Acte unique (1986) et le traité
de Maastricht (1992). L’Acte unique, qui a conduit à
l’édi cation du marché unique – avec la libre circula-
tion des biens, des capitaux et des personnes –, consacre
la suprématie de la logique du marché et de la concur-
rence comme vecteur d’intégration dans l’espace
européen. De son côté, le traité de Maastricht institue
la monnaie unique et fait de la politique monétaire le
seul instrument commun de politique économique
dans la zone. La construction monétaire européenne
repose sur une conception étroite et donc erronée de
la monnaie, appelée monétarisme [14]. La monnaie
protection des ménages face au surendettement; et
d’autre part, les innovations nancières telles que
les crédits rechargeables à taux variables qui ont
augmenté la capacité d’endettement des ménages.
C’est ainsi que les ménages américains, dont la
dépense est passée de 60% à 70% du PIB, ont joué
le rôle de «consommateurs en dernier ressort» de
l’économie mondiale [13]. La progression soutenue
de la consommation américaine a en e et tiré la crois-
sance mondiale au début des années 2000, ce dont ont
largement pro té les pays émergents, Chine en tête.
Or, cette évolution a entraîné une montée vertigi-
neuse de la dette interne et externe des États-Unis.
Le déclenchement de la crise aux États-Unis vient de
ce que le recours massif à l’endettement des ménages,
destiné à pallier l’insu sance du pouvoir d’achat de
leurs revenus, a atteint ses limites. Ce régime de crois-
sance mondial, fondé sur la dette, a pu fonctionner
durablement tant que les États-Unis ont béné cié
d’un « nancement sans pleurs» de leur balance des
paiements, selon l’expression de J.Rue , grâce au
rôle de devise-clé du dollar mis en place par les accords
de Bretton Woods (1944). Or la crise des subprimes a
a aibli les pays les plus avancés, à commencer par les
États-Unis. Les rapports de force entre les principales
puissances économiques de la planète se sont modi-
és en faveur des grands pays émergents, souvent
dénommés les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine).
On doit s’attendre à une remise en cause progressive
de l’ordre économique et monétaire institué sous la
domination états-unienne au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Cette crise est donc également
géopolitique.
Un modèle de développement
non soutenable
On ne peut comprendre la crise en cours, et
son caractère systémique, sans prendre en compte
sa dimension écologique. Même si leurs tempo-
ralités sont di érentes (la question écologique est
ancienne et liée à la société industrielle née à la n du
esiècle), les di érentes dimensions – nancière,
économique, sociale, écologique – de la crise actuelle
sont étroitement imbriquées. Ainsi, l’accélération
récente du processus de réchau ement climatique,
mise en lumière par les travaux du GIEC (Groupe
international d’experts sur le climat), est concomi-
tante à l’émergence du capitalisme nancier à la n
des années1970. Les scienti ques ont également
6 La défi nition exacte de
l’empreinte écologique est
« la surface terrestre et
aquatique biologiquement
productive nécessaire à la
production des ressources
consommées et à l’assimilation
des déchets produits par cette
population, indépendamment
de la localisation de cette
surface ».
7 G. Azam, Le Temps du
monde fi ni. Vers l’après-
capitalisme, Les liens qui
libèrent, 2010.
8 « Notre avenir à tous »,
rapport Bruntland, Nations
unies, 1987.
9 Pour une réfl exion sur
un nouveau mode de
développement, voir
Tim Jackson, Prospérité sans
croissance. La transition vers
une économie durable,
De Boeck, 2010. Tim Jackson
a été membre de la Commission
du développement durable
au Royaume-Uni.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Lycée Carnot - - 37.18.172.88 - 08/01/2014 15h51. © CNDP
 6
6
 7
7
1
/
7
100%