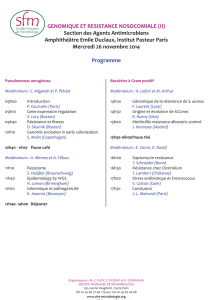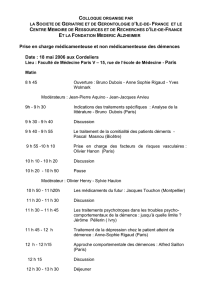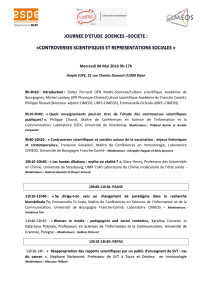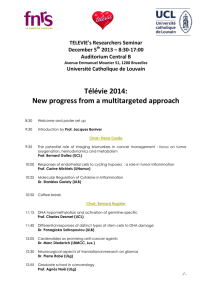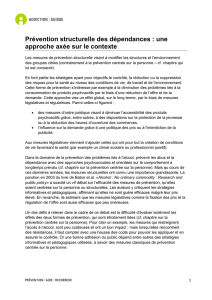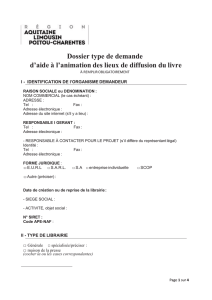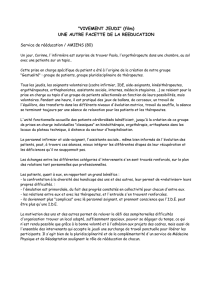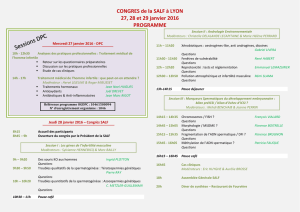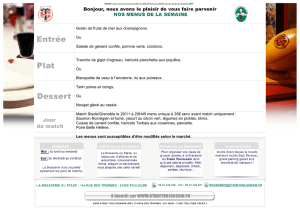Évaluation des traitements en alcoologie, études anglo

Le Courrier des addictions (12) – n ° 3 – juillet-août-septembre 2010 12
MéDIATEURS ET MODéRATEURS
Selon Finney (1995), les "médiateurs" (2) sont
définis comme des variables actives qui trans-
mettent les effets d’une première variable à une
autre. Par exemple : les modalités du traitement,
la participation du patient, les caractéristiques
d’une thérapie sont toutes considérées comme
des médiateurs variables. Quant aux "modéra-
teurs", il les définit comme des variables qui af-
fectent la relation thérapeutique, la compliance
et les résultats du traitement : le sexe du patient,
la sévérité de la dépendance et la capacité à sur-
monter des moments difficiles.
L’intérêt de l’étude de ces deux variables est
qu’elle contribue à répondre aux deux questions
essentielles : comment et pourquoi un traite-
ment fonctionne-t-il (les effets des médiateurs)
; quels traitements sont-ils efficaces pour cer-
taines personnes en particulier (modérateurs)
? Elle permet un meilleur appariement entre
patients et pratiques thérapeutiques.
Le projet “match"
dans neuf sites américains
La première étude, le projet Matching alcohol
treatment to client heterogeneity (MATCH)
a été la plus grande étude clinique de traite-
ment d’alcool jamais menée aux États-Unis.
Achevée dans les années 1990, MATCH a
évalué les bénéfices potentiels du regroupe-
ment de certains patients avec un traitement
spécifique. L’étude a été sponsorisée par l’Ins-
titut national américain sur l’abus d’alcool et
l’alcoolisme. Neuf sites de traitement et 1 726
* Coordinatrice clinique Liberté, 10, rue de la Liberté,
92220 Bagneux.
Évaluation des traitements
en alcoologie, études anglo-saxonnes
Anglo-saxon studies for the evaluation of treatments in
addictology
M.L. Raynal*
patients y ont participé. Le projet était divisé
en deux études cliniques indépendantes et
concernait deux groupes de patients : ceux qui
étaient pris en charge en ambulatoire et ceux
qui étaient en post-cure et avaient été jusqu’au
bout d’un traitement lourd en milieu hospita-
lier. Les données obtenues par les interviews
étaient utilisées pour mesurer les modérateurs
variables : la dépendance à l’alcool, les caracté-
ristiques de la personnalité, le statut psycholo-
gique, le support social et le désir de changer.
Et les médiateurs : les caractéristiques des thé-
rapies, la participation à l’organisation Alcoo-
liques Anonymes, etc. Les deux catégories de
patients étaient choisis au hasard et assignés
à l’une de ces trois modalités de traitement :
"La facilitation 12 étapes" (Twelve-Step
Facilitation, TSF ou F12) qui consiste à suivre
12 sessions hebdomadaires, au cours des-
quelles les thérapeutes encourageaient les pa-
tients à participer activement au programme
de soutien des Alcooliques Anonymes.
La thérapie cognitivo-comportementale
(Cognitive-Behavioral erapy [CBT]) qui
consiste à suivre 12 sessions hebdomadaires,
au cours desquelles les thérapeutes appre-
naient aux patients à se confronter aux situa-
tions à risque pour éviter la rechute.
La thérapie motivationnelle (Motivatio-
nal Enhancement erapy [MET]) qui consiste
à suivre 4 sessions sur une période de 12 se-
maines, au cours desquelles les thérapeutes
encourageaient les patients à examiner les ef-
fets de l’alcool sur leur vie et à développer un
plan personnel pour cesser de boire.
Les résultats montrent que les trois traite-
ments ont une efficacité équivalente : les pa-
tients réduisent leur consommation d’alcool
– de 25 à 6 jours par mois en moyenne – et ces
améliorations continuent pendant les 12 mois
qui suivent le traitement. Les progrès ont per-
duré pendant 12 mois à 3 ans.
Parmi 21 variables de modérateurs testés, seuls 4
étaient signifiants : les troubles psychiatriques, la
colère, l’environnement social poussant ou non
à boire et la dépendance alcoolique. De plus, les
résultats de l’étude (3) ont montré également que
le traitement F12 apporte davantage de bénéfices
pour les patients en ambulatoire sans problème
psychologique et ceux qui ont une dépendance
importante à l’alcool. Le traitement MET est
particulièrement efficace pour les patients qui
montrent un niveau élevé d’agressivité. Enfin, le
traitement CBT est mieux adapté aux patients
avec une dépendance faible.
Dans l’ensemble, les résultats de cette étude
ont montré que corréler un patient et un type
de traitement n’était pas aussi pertinent qu’on
aurait pu le croire. Toutefois, l’étude a indiqué
que le groupe de soutien Alcooliques Ano-
nymes aidait bien les patients à gérer les pres-
sions sociales poussant à boire.
L’éTUDE “AVA" PARMI LES “VETS"
La seconde étude, US Department of Veterans
Affairs Effectiveness Study, pour l’American
Veterans Affairs (AVA), le département amé-
ricain des vétérans, a été conduite durant la
même période. Cette étude multicentrique
compare les traitements TSF et CBT pour
1 873 patients recrutés dans 10 programmes
du système de santé national pour les vétérans
de l’armée américaine. Il s’agissait pour cette
étude de mesurer l’efficacité du système.
On pensait que le traitement TSF, avec l’absti-
nence comme objectif, donnerait de meilleurs
résultats parmi les patients qui avaient de
faibles capacités cognitives, une religiosité in-
trinsèque et une dépendance alcoolique sévère.
Par opposition, il était établi que le traitement
CBT "marcherait" mieux parmi les patients qui
avaient peu de compétences pour réagir à des
événements donnés et présentaient davantage
de symptômes psychologiques.
Les interprétations données par les auteurs des
recherches confirment, d’une part, que les mé-
canismes d’un changement durable à l’œuvre
dans les modèles TSF et CBT n’ont pas encore
été identifiées et, d’autre part, que les variables
environnementales post-cure, telles les res-
sources sociales, ont une forte influence sur les
événements qui dépassent les autres variables.
L’ESSAI UKATT AU ROYAUME-UNI
La troisième étude, United Kingdom Alcohol
Treatment Trial (UKATT), est la plus grande
étude menée vers la fin des années 1990 au
Royaume-Uni concernant les traitements pour
l’alcoolisme. Elle a concerné 720 patients (4).
Elle a consisté aussi à comparer les résultats ob-
tenus par deux types de traitement et les effets
Lors du 25e anniversaire de l’Unité pour la recherche et les soins en alcoologie à Saint-
Cloud (Hauts-de-Seine) en mai dernier, le Pr Thomas Babor, expert international en
addictologie, a présenté trois grandes études anglo-saxonnes (MATCH, AVA et UKATT)
réalisées dans les années 1990 (1), concernant les médiateurs et les modérateurs du
changement de comportement vis-à-vis de l’alcool après traitement. À cette occasion,
il n’a pas hésité à en montrer la faiblesse. En effet, malgré les financements déployés,
elles n’ont pas trouvé de résultats probants, mais démontrent que d’autres facteurs in-
terviennent dans la réussite du traitement, comme la facilité de l'accès aux soins, l’offre
des outils thérapeutiques et la modification des conditions de vie.

Le Courrier des addictions (12) – n ° 3 – juillet-août-septembre 2010
13
de l’appariement thérapeutique. Elle a inclus une
autre modalité de traitement que n’avait pas pris
en compte le projet MATCH: le traitement de
liaison et de comportement social (Social beha-
vior and network therapy [SBNT]) dans lequel
les thérapeutes utilisent différentes approches
cognitives comportementales pour construire
un réseau social d’aide au changement pour le
patient et son entourage. Le deuxième, le trai-
tement motivationnel (MET) est fondé sur les
principes d’entretiens motivationnels.
Les hypothèses de l’étude étaient les sui-
vantes: le traitement fondé sur la motivation
(MET), moins intensif, est aussi efficace que
les traitements plus "serrés", fondés sur les
déterminants sociaux (SBNT) ; un traitement
social, SBNT, est aussi efficace économique-
ment qu’un traitement moins intensif comme
le MET fondé sur la motivation.
En fait, les patients disposant d’un faible réseau
social lors de l’évaluation initiale ont rencontré
les mêmes difficultés avec le MET et le SBNT.
Ceux qui étaient peu enclins à modifier leurs
comportements de consommation d’alcool
lors de l’évaluation initiale n’ont pas obtenu de
meilleurs résultats avec le SBNT qu’avec le MET.
On na pas noté de relation entre la sévérité de
la morbidité psychiatrique des patients, pas plus
qu’entre leur niveau de dépendance au départ et
l’efficacité relative de l’une ou l’autre de ces mo-
dalités de traitement. Même les spécificités des
thérapeutes dans l’une ou l’autre d’entre elles
n’ont pas débouché sur des résultats différents.
L’analyse statistique est fondée sur trois prin-
cipes: un essai pragmatique dont l’analyse porte-
ra sur l’intention de soigner. Les données de tous
les clients seront analysées par le groupe auquel
ils ont été orientés et auront reçu un traitement.
L’analyse sera focalisée sur les changements des
résultats de mesures entre les prétraitements et
les traitements suivants après 3 et 12 mois. La
recherche portera sur les déséquilibres entre les
traitements de groupe au départ.
LES RéSULTATS
Aucune des hypothèses d’appariement théra-
peutique n’a pu être confirmée faute de résultats
significativement probants. Trois explications
peuvent être avancées. La première est l’erreur
théorique. La deuxième ressort de la particula-
rité de la méthodologie de recherche : prise en
charge multiple, suivi intense de l’expérimen-
tation, différences entre les sites. La troisième
concerne l’appariement qui fonctionne "en
dehors" de la thérapie et non "à l’intérieur". Ce
constat apparaît très clairement dans le projet
MATCH pour les patients qui ont un accompa-
gnement ou non par les Alcooliques Anonymes.
Les implications cliniques qui en découlent :
la décision de commencer un traitement est
associée à une réduction de la consommation
d’alcool et il est essentiel de convaincre les pa-
tients que le traitement va les aider.
Pour conclure, le traitement a porté sur des
théories spécifiques telles que MET et CBT,
mais les changements ne sont pas corrélés
avec la durée de l’abstinence ou l’importance
Paris récompense les lauréats du
concours “Trop boire, c’est le cauchemar"
vLa ville de Paris a lancé en novembre dernier une campagne
originale de santé publique sur le phénomène du "binge drin-
king". Avec, point d’orgue, un concours de minifilms réalisés par
des Parisiens âgés de 15 à 25 ans, mis en ligne sur le site Internet www.
thebinge-lefilm.com, qui a remporté un vif succès : plus 100 films ont
été réalisés, environ 1 000 jeunes ont pris part de façon active au sein
des équipes de tournages, plus de 100 000 visiteurs se sont rendus sur le
site depuis le début de la campagne. Six films ont été primés par un jury
présidé par Chantal Lauby, comédienne et marraine de l’opération, et
composé de Jean-Marie Le Guen, adjoint chargé de la santé publique et
des relations avec l’AP-HP, de Bruno Julliard, adjoint à la Jeunesse, d’ex-
perts de la prévention, et de jeunes des Conseils de la jeunesse parisiens.
Résultats : Grand prix du jury : Twist in the night; 2e prix : Et si t'avais
le choix ? 3e prix : Doppelganger ; Prix du public: Écart de conduite ;
Prix des associations : Fête foraine ; Prix Coup de cœur du jury: Jean-
Michel le vampire ; Prix mention spéciale du jury: Cauchemar au col-
lège. Comme l’a expérimenté depuis longtemps le CRIPS avec ces divers
concours de films sur le sida, l’usage de drogues ou l’homosexualité,
ces films deviendront les supports de communication pour des futures
campagnes de prévention. Ils seront diffusés sur le site Paris.fr, dans
les équipements municipaux, dispositifs dédiés aux jeunes et à l’occa-
sion d’événements festifs (festivals, concerts, etc.). Ils seront bien sûr
utilisés dans le cadre d’actions de sensibilisation et de prévention sur la
consommation excessive d’alcool et ses conséquences.
La méphédrone au tableau des stups
vLe ministère de la Santé a décidé de classer la 4-methylmethca-
thinone (la méphédrone) comme stupéfiant, suivant en cela les
recommandations de l’OMS et la décision d’un certain nombre
de pays européens (J.O. du 11 juin 2010). Cette drogue de synthèse sti-
mulante et euphorisante, dérivée du principe actif du khat, était vendue
dans toute l’Europe sur le Net comme "engrais végétal", "sels de bains",
"produit utilisé pour la recherche", voire "alternative légale à la cocaïne,
aux amphétamines, à l’ecstasy". En France, elle a été identifiée pour la
première fois à la fin de l’année 2009 dans le cadre du dispositif Système
d’identification nationale des toxiques et des substances (SINTES).
Depuis, 6 autres échantillons ont été collectés auprès des consomma-
teurs et le réseau des Centres d’évaluation et d’information sur la phar-
macovigilane et l’addictovigilance (CEIP) ont reçu, au début de cette
année, les premiers signalements d’effets liés à sa consommation. Elle
provoque "une descente" violente, avec maux de tête, crises d’angoisse et
de paranoïa. Elle provoque aussi des nausées et des vomissements, des
hallucinations, une irritation nasale, une obstruction des vaisseaux pé-
riphériques et du bruxisme. Elle est soupçonnée d'être impliquée dans
une bonne vingtaine de décès survenus outre-Manche. DGS/Afssaps.
P. de P.
de la baisse de consommation d’alcool. Les
meilleurs résultats obtenus l’ont été lorsqu’il
y avait une alliance thérapeutique, un désir de
changement du patient et des possibilités pour
lui de trouver dans son environnement des
ressources d’auto-support.
Ces études donnent une forte évaluation des mé-
diateurs et des modérateurs, et de l’efficacité des
traitements. L’échec de la recherche sur l’appa-
riement thérapeutique fondé sur le modèle tech-
nologique du changement psychothérapeutique
peut nous conduire à une recherche plus fruc-
tueuse des moyens d’améliorer l’accès aux traite-
ments au travers de la distribution des ressources,
ainsi que par des approches individuelles. Selon
omas Babor, les recherches doivent s’orienter
désormais dans d’autres directions, comme l’ap-
pariement des traitements pharmacologiques,
l’auto-appariement du patient au traitement.
v
Références bibliographiques
1. Babor T. Traitement des personnes présentant
des troubles liés à l’usage de substances psychoac-
tives: nécessité d’une nouvelle approche pour la re-
cherche. Conférence de la journée du 20 mai 2010
célébrant les 25 ans de l’URSA, Saint-Cloud (92).
2. Babor T. Treatment for persons with substance
use disorders: mediators, moderators, and the need
for a new research approach. Int J Methods Psy-
chiatr Res 2008;17(Suppl.1):S45-9.
3. Babor T, Del Boca F. Treatment matching in al-
coholism. Cambridge University Press, 2003.
4. UKATT Research Team. United Kingdom Alco-
hol Treatment Trial (UKATT): hypotheses, design
and methods. Alcohol Alcohol. 2001;36(1):11-21.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
1
/
2
100%