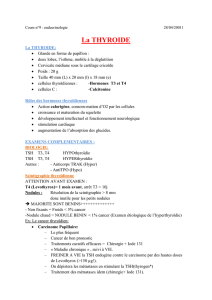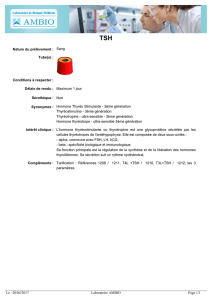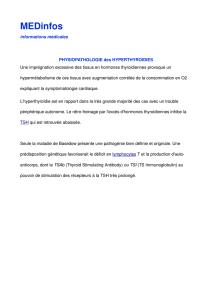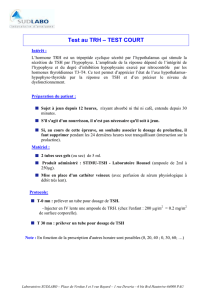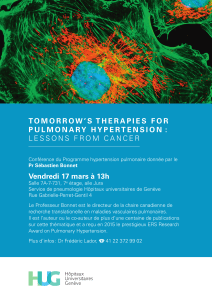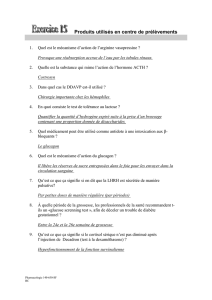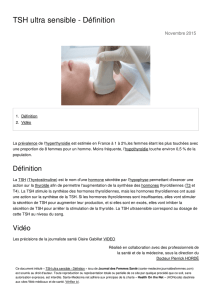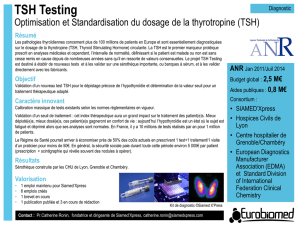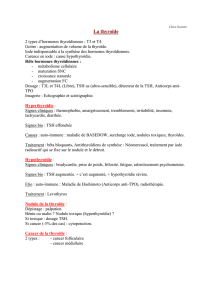Maladies endocrinologiques : du laboratoire à la prise en charge

4
Maladies endocrinologiques : du laboratoire à la prise en charge
PD Dr Christoph A. Meier, Unité d’endocrinologie, Hôpitaux Universitaires de Genève
INTRODUCTION
L’hypertonie, l’hypercholestérolémie et
les troubles thyroïdiens sont des situa-
tions fréquentes dans le cabinet du pra-
ticien. Le point commun à ces trois
situations est le défi de demander des
analyses complémentaires de manière
ciblée et de les intégrer dans la prise en
charge du patient.
HYPERTENSION
L’origine précise de l’hypertension arté-
rielle ne peut être établie chez 95 % des
patients. Cependant, il est important de
trouver des éléments qui induisent à
des investigations approfondies afin de
déceler les 5 % des patients souffrant
d’hypertension secondaire. Ces élé-
ments sont le jeune âge du patient, une
hypertension mal contrôlée malgré une
poly-pharmacothérapie ou une hyper-
tension bien contrôlée mais qui échappe
soudainement au traitement . A ceci
s’ajoutent les patients qui montrent une
péjoration rapide de leur fonction
rénale. Chez ces patients, il faut envisa-
ger la possibilité d’une hyper-tension
réno-vasculaire. Cependant, une sté-
nose des artères rénales est présente
chez 30 à 50 % des patients poly-
vasculaires et sa découverte ne modifie
fréquemment pas la prise en charge du
patient car l’impact sur l’hypertension
est minime.
Pour cette raison, il convient de réser-
ver l’angio-IRM, l’examen le plus fiable
dans la détection des sténoses des artè-
res rénales, aux patients qui présentent
une hypertension mal contrôlée ou une
insuffisance rénale progressive.
Les causes endocrines d’une hyper-
tension sont encore plus rares avec des
prévalences inférieures à 1 ‰ dans le
cadre d’un syndrome de Cushing ou
d’un phéochromocytome. Le dépistage
de ces deux dernières maladies dépend
surtout d’une anamnèse et d’un examen
clinique soignés afin d’identifier les élé-
ments spécifiques de ces deux endo-
crinopathies. Les tests biochimiques ne
seront utiles que dans une situation où
la probabilité d’une maladie est élevée.
L’HYPERALDOSTERONISME
Il reste l’hyperaldostéronisme primaire
qui n’est pas rare mais très souvent
maîtrisé avec une mono- ou bithérapie
ne nécessitant donc pas, la plupart du
temps, d’intervention chirurgicale, celle-
ci étant surtout conseillée aux patients
jeunes ou à ceux présentant une hypo-
kaliémie. Il est donc raisonnable de
réserver la recherche biochimique d’un
hyperaldostéronisme primaire par un
dosage de l’aldostérone sérique et de
l’activité de la rénine aux patients hypo-
kaliémiques ou aux patients jeunes avec
une tension mal contrôlée.
HYPERCHOLESTEROLEMIE
Les enjeux concernant le traitement de
l’hypercholestérolémie en prévention
primaire (c’est-à-dire chez des patients
non coronariens et non diabétiques)
sont importants car, selon certaines
guidelines, jusqu’à 20 % de la popula-
tion en général pourrait bénéficier d’un
traitement médicamenteux à des coûts
importants qui sont inverses au risque
cardio-vasculaire que l’on décide de
traiter (cf figure 1).
Cependant, la Société Européenne de
Cardiologie (www.escardio.org) a émis
un outil très utile et adapté à l’Europe
permettant d’estimer la mortalité
cardio-vasculaire à 10 ans en fonction
du sexe, de l’âge, de la tension arté-
rielle, du cholestérol et de la présence
d’un éventuel tabagisme (cf figure 2).
Cet outil d’utilisation très simple nous
permet d’estimer le risque cardio-
vasculaire pour un patient donné et
donc de réserver un traitement par
statine aux patients à plus haut risque
(par exemple une mortalité cardio-
vasculaire supérieure à 5 % à 10 ans).
MALADIES THYROÏDIENNES
Bien que les gros goitres aient
quasiment disparu, les nodules
thyroïdiens restent un problème
fréquent avec une prévalence d’à peu
près 10 % de nodules par décennie ou,
autrement dit, la moitié d’une popula-
tion de 50 ans présente un ou plusieurs
nodules thyroïdiens (cf figure 3).
Cependant, le risque cancéreux est
extrêmement faible avec une mortalité
attribuable inférieure à 5 patients par
million d’habitants. Se pose donc le
problème du bilan de ces nodules qui
doit également tenir compte du fait que
les micro-cancers papillaires de la
thyroïde ne sont pas rares (10 à 30 %
de la population) mais que ces lésions
posent rarement des problèmes
cliniques. Une approche raisonnable est
donc de réserver la cytoponction à des
nodules isolés de plus de 1 cm, voire de
plus de 1,5 cm en cas de goitre multino-
dulaire. L’aspiration à l’aiguille fine a
remplacé largement la scintigraphie
thyroïdienne qui n’a qu’une place margi-
nale dans le bilan des nodules thyroï-
diens chez les patients euthyroïdiens.
Restent les problèmes de dysthyroïdie
qui sont fréquents, notamment l’hypo-
thyroïdie infraclinique chez la femme
post-ménopausée.
En cas de suspicion clinique, il convient
de doser une valeur de TSH et
l’éventualité d’une substitution en T4
doit être nuancée en fonction de cette
valeur et de la présentation clinique (cf
figure 4). Bien qu’un traitement
Etiologies d’une hypertension
• essentielle 95%
• médicamenteuse
• rénale <5%
• endocrine 1%
hyperaldostéronisme 0.5–10%
syndrome de Cushing 0.1%
phéochromocytome 0.1%
autres causes 0.1%
Options thérapeutiques pour
l'hyperaldostéronisme primaire
Opération
mais normotension post OP sans
médicaments seulement chez 33 %
des patients!
Traitement médicamenteux
• bonne option si TAH et potassium
contrôlés
• la taille de la tumeur est stable
(> 5 ans)
Bilan seulement si :
• Patient jeune
• Hypertension ou hypokaliémie mal
contrôlée Ann Int Med 131: 105f
Ann Int Med 135: 258f
Hypothyroïdie infraclinique
• Déf. : TSH >4 mU/L, T4 libre >9 pM/L
• Prévalence : >10 20% des personnes >60 ans
• Recommandations (CAM) :
TSH <6 mU/l TSH à 3, 9, 18 mois
TSH 6-1010 mU/l si < 3-6 mois, ad ttt
TSH >10 mU/l substitution
• Traitement : commencer avec 0.05 - (0.1) mg/j,
adaptation après 6 semaines (selon TSH)
• Contrôles: clinique et TSH 1x/an

5
Figure 2 :
Hypercholestérolémie — coûts en fonction du
risque cardio-vasculaire.
Figure 3 :
Investigations des nodules thyroïdiens.
Figure 1 :
Estimation de mortalité cardio-vasculaire
à 10 ans, en fonction des principaux
facteurs de risque.
substitutif soit généralement indiqué si
la TSH dépasse 10 mU/l, il n’existe pas
de consensus pour des valeurs moins
élevées. L’approche la plus raisonnable
est le traitement d’épreuve chez les
patients symptomatiques ainsi qu’un
suivi clinique avec un nouveau dosage
de la TSH pour les patients asymptoma-
tiques. A noter que le dosage des
anticorps anti-thyroïdiens (anti-thyroïde
peroxydase et anti-thyroglobuline) est
rarement utile car il n’intervient dans la
décision thérapeutique que dans des cas
bien spécifiques.
1
/
2
100%