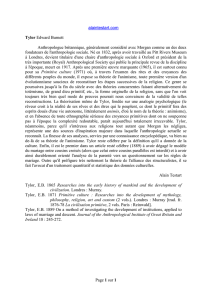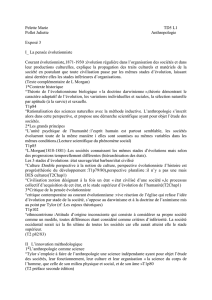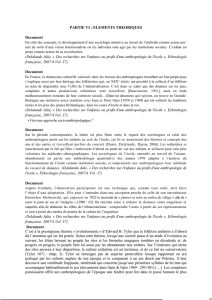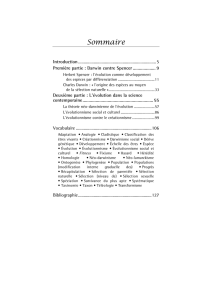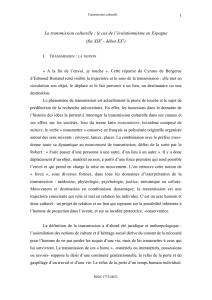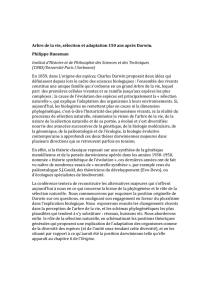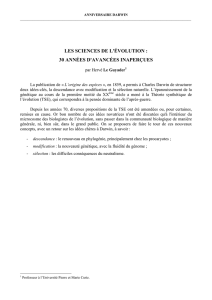METH 22F - La Faculté des Sciences Sociales de l`Université de

1
LES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE L’ETHNOLOGIE
Roger SOMÉ

2
INTRODUCTION
La réflexion autour des fondements philosophiques de l’ethnologie s’entend en
termes d’histoire de la discipline anthropologique. Il s’agit d’indiquer les principales
étapes conceptuelles de la constitution de l’anthropologie, une discipline somme toute
relativement récente. Définir les grandes étapes de l’anthropologie c’est, en effet,
établir son histoire qui, en l’occurrence passe par la définition de l’objectif de la
discipline ou plus exactement de ses motivations.
En effet, l’anthropologie sociale et culturelle, dans la mesure où cette science a
l’Homme pour objet d’étude, s’ouvre avec la détermination des chercheurs, de
reconstituer les différents stades du développement humain, c’est-à-dire de restituer
l’histoire humaine à partir de l’étude des hommes contemporains. Il s’agit donc
d’étudier la diversité humaine, diversité qui s’entend non seulement sur le plan culturel
mais encore sur celui des degrés de développement. Cette perspective suppose une
référence au modèle paléontologique en ce sens que l’objectif est de déterminer
l’origine des hommes contemporains.
En cette orientation, l’anthropologie commence selon une dimension historique
fondée sur l’idée du progrès. Il s’agit donc de déterminer l’évolution des hommes.
Ainsi, le premier fondement de l’ethnologie fut une philosophie naturaliste, une pensée
dominante au XVIIIème siècle. Cette même pensée qui fut nommée évolutionnisme et
qui touche à divers domaine, sera appliquée à l’homme, initiant ainsi la science
ethnologique.
PLAN DU COURS
I Les origines de l’évolutionnisme
A. Darwin et la théorie de la sélection naturelle
B. Les précurseurs de Darwin
II L’évolutionnisme
A. Objet et méthode
B. Les auteurs

3
a. Lewis Henry Morgan
b. Edward Burnett Tylor
III Le diffusionnisme
A. Théories et méthode
B. Les auteurs
a. F. BOAS et l’anthropologie culturelle américaine
b. H. Baumann et D. Westermann
c. Leo Frobenius
I Les origines de l’évolutionnisme
Amorcé dès le XVII
ème
siècle, le thème du progrès s’impose au XVIIIème siècle
comme étant le thème majeur de la réflexion philosophique. Marqués par leur emblème,
Les lumières, les philosophes pensent l’humanité sur le mode du mouvement. Celle-ci
évolue de manière constante d’un état moindre vers un état meilleur, d’un stade
inférieur vers un stade supérieur. Partant de cette philosophie générale de son temps,
Turgot (1727-1781) en vient à établir une théorie des stades du développement
clairement fondée sur la succession des étapes. Ainsi, le premier stade est celui de la
chasse et de la cueillette, le second l’élevage et le troisième l’agriculture.
Remarque
Ce découpage de l’évolution de l’histoire humaine n’est pas sans rapport au mythe
d’origine de la culture judéo-chrétienne selon laquelle l’acquisition des moyens
d’existence de l’homme est allée du simple au complexe de l’absence d’effort à la
condition d’un effort. On le sait : ce mythe comporte bien évidemment l’argument de la
faute originelle commise par Adam et Eve. Cependant, grâce ou à cause de cette faute,
il y a dans le processus de l’existence humaine l’idée du progrès.
Pour revenir à Turgot, il est à noter qu’il soutient l’existence d’une inégalité dans le
principe du progrès qui est général en toute humanité. Si tout « esprit humain renferme

4
le principe des mêmes progrès, la nature a donné à certains une abondance de talent
qu’elle a refusée à d’autres ». En outres « les circonstances développent ces talents ou
les laissent enfouis dans l’obscurité ». De là viendrait l’inégalité entre les nations (Cf.
« Le progrès de l’esprit humain », in Écrits économiques). Cette position de Turgot
manifeste un mélange de deux philosophies : celle de Descartes (1596-1650) et celle de
Montesquieu (1689-1755) son contemporain.
En effet, Descartes affirmait comme principe de la bonne conduite du raisonnement
en vue de l’accession à la vérité que le « bon sens » ou raison est la chose la mieux
partagée. Chaque sujet en a reçu en part égale. Toutefois, ce qui introduit la différence,
voire l’inégalité entre les sujets vient de ce que certains en font bon usage et d’autres un
mauvais usage. Les uns l’appliquent bien et les autres mal. Mais on notera que pour
Turgot l’inégalité n’est pas le fait unique de la nature qui dispense les talents à certains
hommes et en refuse à d’autres. L’inégalité vint aussi des circonstances qu’il faut
entendre comme étant aussi bien sociales que physiques. Et, en cette dernière
occurrence, sa pensée est proche de celle de Montesquieu, en particulier le
Montesquieu de la théorie des climats. Pour lui, en effet, les mœurs, les coutumes, les
lois et les caractères des peuples sont déterminés par la nature des climats. Ainsi en
Chine « des causes tirés de la plupart du physique du climat ont pu forcer les causes
morales dans ce pays, et faire des espèces prodiges. Le climat de la Chine est tel qu’il
favorise prodigieusement la propagation de l’espèce humaine » (cf. De l’esprit des lois
L. VIII, chap. 21, Œuvres Complètes, Gallimard p. 366-367, Pléiade).
De même « les Indiens sont naturellement sans courage : les enfants même des
Européens nés aux Indes perdent celui de leur climat » Ibid., p. 478. Mais en quoi le
climat des Indes ne serait-il pas le leur ? Pourrait-on rétorquer à Montesquieu.
Conformément à la pensée naturaliste, l’histoire humaine est le fait d’un déterminisme
naturel. Aussi, ces thèses qui soutiennent l’idée d’une influence de la nature, du milieu,
sur le devenir de l’homme trouvent un appui du côté de la biologie et notamment dans
le transformisme lamarckien (1744-1829).
Pour Lamarck, l’action du milieu sur les êtres vivants, contraint ceux-ci à s’adapter.
En s’adaptant à l’environnement, ils résistent à une perturbation exogène grâce à une
modification de leur structure biologique. D’où cette loi selon laquelle « rien ne se perd
rien ne se crée ; tout se transforme ». Le transformisme induit ceci que l’existence des
différents êtres vivants résulte d’un processus de transformation provoqué par

5
l’interaction entre le milieu et le vivant. Mais cette interaction est inéluctable et
nécessaire ; c’est le principe-même du déterminisme.
Le modèle biologique qui sera déterminant pour la formation des sciences sociales,
en particulier la sociologie avec Herbert Spencer, trouve son accomplissement dans la
pensée de Darwin qui devient la référence inévitable.
A. Darwin et la théorie de la sélection naturelle
Avant-dernier fils d’une fratrie de six, Charles Darwin est né à Shrewsbury en 1809.
Il étudia à Edinburgh puis à Cambridge où il obtient ses grades universitaires en 1831.
Il avait alors 22 ans. Âge auquel il embarqua sur le Beagle du Capitaine Fitzroy partit
explorer l’Amérique du Sud et les Îles du Pacifique. Dans cette expédition qui dura 5
ans (1831-1836), Darwin avait la qualité de naturaliste. C’est ce qui justifia sa
participation à l’expédition. Au cours de ce voyage, il fit de nombreuses observations
notamment aux Îles Galápagos où il découvre des animaux vivants qui ressemblent à
des fossiles trouvés ailleurs dans le monde. Il envisagea alors l’hypothèse d’une
mutation des espèces animales s’opposant ainsi à la thèse de la « fixité » et de la
« création séparée » soutenue par l’Église. Bien qu’ayant commencé la rédaction des
notes de son voyage en 1837, soit un an après le retour, il ne réalisa aucune publication
majeure touchant la théorie de l’évolution. Et pour cause, Darwin voulait vérifier toutes
les hypothèses, rassembler toutes les preuves avant de porter son œuvre à la
connaissance du public. Il était un savant d’une grande méticulosité.
Cependant, un événement non négligeable viendra mettre en cause son humilité. En
effet, le 18 juin1858 il reçut d’Alfred Wallace un bref essai qui contenait l’essentiel de
sa propre théorie, celle de l’origine des espèces. Darwin. Ce dernier devait soumettre le
manuscrit à l’appréciation de son maître devenu son ami et dénommé Lyell qui avait
lui-même proposé une interprétation naturaliste de l’origine des espèces dans ses
Principes de géologie. Darwin qui raconte cet épisode dans l’introduction à l’origine
des espèces, affirme avoir communiqué l’essai à Lyell ainsi qu’à Hooker, ses amis qui
avaient connaissance des travaux de Darwin pour les avoir lus en manuscrit et pour en
avoir demandé sans succès la publication.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%