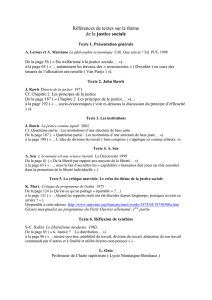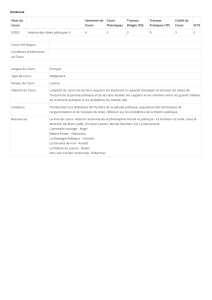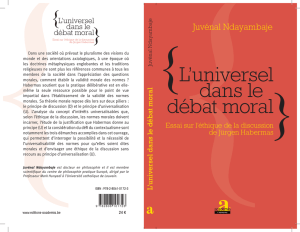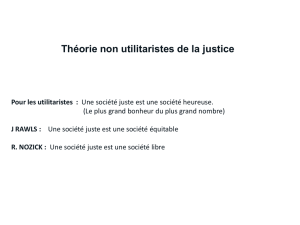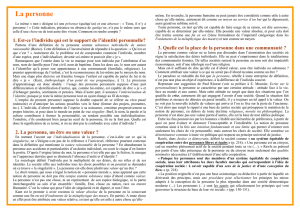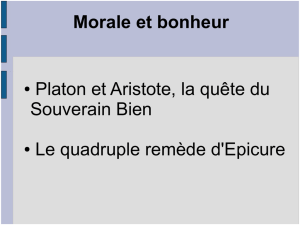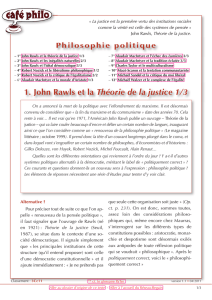Rawls et Habermas : le primat du Juste sur le Bien

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
A Numéro 39 • Décembre 2005 a
Rawls et Habermas :
le primat
du Juste sur le Bien
Christophe Cervellon
Agré de philosophie, ancien élève de l’École Normale Supérieure (Ulm).
Culture Générale
L’américain John Rawls (né
en 1921) et l’allemand
Jürgen Habermas sont au-
jourd’hui considérés comme deux
des philosophes contemporains les
plus importants. Depuis sa Théorie
de la justice (1971), Rawls est de-
venu une référence incontournable
de la philosophie politique dans le
monde anglo-saxon, si bien qu’on
ne peut guère parler de justice sans
faire la critique, ou à tout le moins
l’examen, des conceptions
rawliennes (Cf. Will Kymlicka, Les
Théories de la justice, une introduc-
tion, 1990). De même, la tentative
de “fonder une éthique de la dis-
cussion” que mène explicitement
Habermas depuis Morale et com-
munication, conscience morale et
activité communicationnelle
(1983), a suscité de vastes débats
(comme en témoigne le récent De
l’éthique de la discussion et la
question de la vérité, 2003), et re-
posé à nouveau frais le problème
de la validité des normes éthiques.
En un sens, ces deux auteurs sont
très différents : Rawls est l’héritier
du libéralisme, philosophique et po-
litique (Cf. Libéralisme politique,
PUF, 1997), et son discours est es-
sentiellement une critique des po-
sitions utilitaristes chers aux pen-
seurs américains. Habermas, quant
à lui, est issu d’une tradition
marxiste profondément réformée,
et situe plus volontiers ses problé-
matiques dans l’histoire de la
grande tradition philosophique, qui
a pris acte de l’existence des scien-
ces humaines, de la sociologie, de
la psychologie, ou de la linguisti-
que. Mais si leurs positions théori-
ques ne sont manifestement pas
toujours convergentes (comme en
témoigne leur livre commun Débat
sur la justice politique – Cerf,
1997 –) et qu’ils s’opposent notam-
ment sur la compréhension et la ré-
solution des conflits dans l’espace
public, reste que leurs approches de
la notion de justice se rejoignent
suffisamment, pour que Habermas
puisse par exemple défendre les
positions rawlienne et les siennes
contre les mêmes objections ou les
mêmes critiques (Cf. De l’Ethique
de la discussion, 1991, p. 116). De
fait, ils apparaissent tous deux
comme des théoriciens d’une dé-
mocratie constitutionnelle fondée
sur l’intersubjectivité, c’est-à-dire
sur la capacité que nous avons
d’adopter la perspective d’autrui
pour constituer des normes ration-
nelles communes. Et, au delà de
toutes leurs différences, la thèse
qu’ils partagent du primat du juste
sur le bien, à tout le moins de leur
indépendance relative, confèrent à
leurs philosophies comme “un air
de famille”, qui les différencie net-
tement de théoriciens héritiers de
la conception la plus “classique”,
“néo-aristotélicienne”, selon la-
quelle le juste ne peut être pensé
qu’en fonction du bien, qu’il soit
celui d’un individu ou d’une com-
munauté (Cf. A. MacIntyre, Whose
Justice ? Which rationality ?
1988).
Position du
problème
■
Cette thèse de la séparation
de la question du juste
d’avec celle du bien est
chez nos deux auteurs sans la moin-
dre ambiguïté. Comme l’écrit Ha-
bermas dans De L’éthique de la dis-
cussion (1991) : “On prend une
décision initiale, celle de s’interdire
la possibilité de concevoir la mo-
rale comme représentant un aspect
particulier d’une éthique englo-

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
A Numéro 39 • Décembre 2005 a
bante du bien (p. 158)”. Et rien de
plus clair que cette autre déclara-
tion de Morale et communication
(1983) : sa conception du traite-
ment des questions morales “fonc-
tionne, affirme Habermas, comme
un couteau qui tranche entre le
“bien et le juste”, entre les énoncés
évaluatifs et les énoncés strictement
normatifs (p. 125)”. Semblable-
ment, la thèse du primat du juste
sur le bien était affirmée par Rawls
au dernier chapitre “la justice
comme bien” de Théorie de la Jus-
tice (1971), puis reprise et clarifiée
dans l’article “la priorité du juste
et les conceptions du bien” (re-
cueilli dans Justice et démocratie,
1988), où il affirmait d’emblée que
“la thèse de la priorité du juste [sur
le Bien] était un élément essentiel
de ce qu’[il] avait appelé libéra-
lisme politique”. Cette volonté de
ne pas confondre la question du
juste et celle du bien n’a rien
d’anecdotique : elle définit au con-
traire, nous l’avons dit, une rupture
profonde avec la conception clas-
sique de l’éthique et de la politi-
que, et elle mérite sans doute qu’on
l’examine de plus près afin de
mieux comprendre la conception de
la justice que se font nos deux
auteurs.
Classiquement, c’est-à-dire selon
les philosophies morale et politique
inspirées d’Aristote, le juste était
défini selon une certaine idée du
Bien : ce qu’il était juste de faire
pour un individu, ne faisait pas
nombre avec sa recherche du bon-
heur bien compris, et ce qui était
juste dans une Cité était ce qui con-
tribuait au bien de cette Cité. Me-
ner “une vie bonne”, au sens éthi-
que, n’avait de sens que dans la
perspective d’une “bonne vie”, et
l’homme juste, s’il n’était pas tou-
jours heureux (car la bonne ou mau-
vaise chance ne pouvaient être en-
tièrement écartées de l’existence
pour Aristote), était cependant ce-
lui qui tentait de “s’ajuster” au
mieux à un idéal de vie aussi har-
monieux et stable que possible.
C’est en fonction de la vie bonne,
d’une philosophie compréhensive
du bien ou d’un concept clair de
bonheur, que les règles à suivre
avaient un intérêt et un sens. Ins-
piré d’Aristote, saint Thomas
d’Aquin voyait encore dans l’obéis-
sance à la loi divine le moyen de
parvenir au bonheur, et non pas la
soumission à des règles arbitraires
n’ayant aucun rapport avec notre
bien propre : “Dieu n’est offensé
par nous que du fait que nous agis-
sons contre notre propre bien”.
L’injustice, la désobéissance mo-
rale, était d’abord injustice contre
nous, une manière de s’éloigner du
bonheur véritable, tout de même
que chez Aristote, Platon ou les
Stoïciens, l’homme mauvais était
avant tout un homme malheureux
et stupide : plus intelligent, le mé-
chant aurait compris que son inté-
rêt dépendait d’une conduite éthi-
quement réglée – “une bonne vie”.
La vie de l’homme avait pour fin le
bonheur, et la justice de l’homme
juste n’était au final que le chemin
pour y parvenir, le plus “ajusté” à
notre désir rationnel du bien. Le
juste était défini par rapport au bien,
et tout ce qui permettait d’attein-
dre le bien véritable était juste (et
“injuste” ce qui ne conduisait qu’à
un faux bien, ou à un semblant de
bonheur).
Il en allait semblablement en poli-
tique. C’était en fonction du bien
propre à une communauté donnée
que la loi était “juste” ou “injuste” :
la loi n’était pas juste en fonction
d’un simple critère formel (le fait
qu’elle soit applicable à tous de la
même manière), mais dans la me-
sure où elle servait l’intérêt com-
mun. Dans la République de Pla-
ton, comme dans celle de Cicéron,
les plus grandes inégalités sont jus-
tifiées dès lors qu’elles tournent au
bonheur non pas de tel ou tel indi-
vidu (qui mériterait plus qu’un
autre d’être heureux), mais au bon-
heur de tous (quitte à ce que cer-
tains, du plus haut au plus bas de
l’échelle sociale, soient contraints
de renoncer à une part de bonheur
possible qui risquerait de nuire aux
autres). Le juste en politique était
là encore fonction du bien collec-
tif, et ne se comprenait que dans la
perspective de cet intérêt véritable.
Il aurait été aussi absurde de con-
cevoir une loi juste qui fût nuisible
à la Cité, que de concevoir une con-
duite juste qui pût réellement nuire
au bonheur de l’homme juste : l’in-
térêt général fonctionnait en somme
pour le groupe, dans son identité
singulière, comme la recherche du
bonheur pour l’individu concret. Le
fondement du juste était le bien, et
tout le problème de la sagesse pra-
tique du législateur ou du philoso-
phe était de déterminer précisé-
ment, sans erreur, la nature de ce
bien, ce qui était le plus utile (l’un
des sens en grec de to agathon) à
tous.
Mais, comme le remarquent Rawls
et Habermas, il est devenu impos-
sible aujourd’hui, dans le contexte
des démocraties modernes, de fon-
der une morale sur une conception
philosophique ou religieuse du
bien. Nous ne supporterions plus
que quelqu’un nous dise ce que
nous avons à faire parce qu’il con-
naîtrait mieux que nous, au nom
d’une théorie philosophique ou
d’une révélation divine, ce qui est
bien pour nous. Pour une perspec-
tive classique, notre attitude de pen-
sée consiste à demander le droit à
l’erreur sur notre bien, et donc le
droit à l’injustice à travers l’aven-
ture du bonheur subjectivement re-
cherché. Mais, dans une perspec-
tive moderne, nous ne faisons que
prendre acte de la difficulté qu’il y
a à déterminer correctement, selon
un concept universel, ce qu’est le
bonheur promis à l’homme. En ef-
fet, depuis Kant, il nous semble
impossible de définir le bonheur
comme on définit mathématique-
ment une figure géométrique : nous
aurions tous notre représentation
plus ou moins vague de ce que le
bonheur peut être, et le bonheur
serait devenu une interrogation per-
sonnelle, c’est-à-dire affaire de sub-
jectivité, et non plus un problème
rationnel. Le bonheur, comme le dit
Kant dans une formule célèbre, ne
serait “qu’un idéal de l’imagina-
tion”, ce que nous ne pouvons pas

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
A Numéro 39 • Décembre 2005 a
ne pas poursuivre, mais ce sur quoi
nous ne pouvons pas non plus nous
accorder rationnellement. Nous
avons seulement le droit naturel d’y
tendre comme nous l’entendons, en
espérant que l’État confirme par le
doit positif la liberté de le chercher
où bon nous semble. Dans ces con-
ditions, fonder la morale sur ce
qu’il y a de plus intime à l’homme
–la recherche du bonheur – est de-
venu une entreprise impossible, et
définir la justice comme l’ajuste-
ment au bien véritable d’un être
doué de raison, est devenu radica-
lement absurde : le seul fondement
de la morale était, selon Kant, la
raison. Ce sont les contraintes de
la non-contradiction, l’universalisa-
tion des règles, l’attitude désinté-
ressée vis-à-vis du vrai, etc. – qui
constituaient la source de la morale
à laquelle l’homme était spontané-
ment sujet, du seul fait d’être ra-
tionnel.
Pour Rawls et Habermas,
aussi, on ne peut pas fon-
der les normes éthiques ou
politiques sur une “philosophie
compréhensive du bien” (Rawls) :
on ne peut pas appuyer la notion
de juste sur une “conception méta-
physique ou religieuse” (Haber-
mas). Il faut prendre acte du “fait
du pluralisme” (Rawls) qui carac-
térise nos sociétés, ou de l’extra-
ordinaire diversité des doctrines et
des formes de vie, comme il faut
prendre acte de la “redéfinition du
rôle de la philosophie” (Habermas)
par rapport à ses anciennes préten-
tions exorbitantes à dire dogmati-
quement le bien. En réalité, Rawls
et Habermas sont doublement en
accord avec Kant : ils sont d’accord
sur le constat que “l’éthique (de la
vie bonne)” est devenue impossi-
ble (il n’y a plus de place que pour
une “théorie rationnelle, discursive,
de la morale” susceptible de déter-
miner rationnellement le juste –
Habermas –), tout comme une po-
litique du bien ne peut être légitime
qu’à condition de respecter les
“conditions formelles de la justice”
(Rawls). Et ils sont également d’ac-
cord sur le fait que le seul fonde-
ment possible de la justice politi-
que et des normes éthiques suppo-
sent un “usage public de la raison”
(free public reason – Rawls –), ou
“la participation à une discussion
pratique sur la validité de cette
norme” (Habermas), c’est-à-dire la
reconnaissance d’une communauté
rationnelle. Pour Rawls comme
pour Habermas, si la raison, et non
le bien individuel ou collectif, est
au fondement du juste, cette raison
n’est pas en effet une faculté essen-
tiellement individuelle, comme si
un individu pouvait avoir raison
contre tous, mais le produit de re-
lations intersubjectives. Il s’agit en
somme pour le philosophe alle-
mand et américain de reformuler le
projet kantien d’une fondation ob-
jective des normes pratiques en
substituant au paradigme kantien de
la subjectivité (celle de l’homme
qui resterait doué de raison, et res-
ponsable de ses actes, sur une île
déserte), celui de la communication
(Habermas) ou de la négociation
idéale (Rawls), c’est-à-dire une rai-
son qui résulte de la participation
d’êtres humains à un dialogue sin-
cère ayant pour but l’accord de tous
avec tous, qu’il s’agisse des bases
de la société (Rawls) ou des nor-
mes éthiques valides (Habermas).
Si la “conception classique” avait
pour faiblesse de reposer sur une
détermination problématique du
bien rationnel, elle avait cependant
l’intérêt de rendre parfaitement
compréhensible “l’ancrage motiva-
tionnel (Habermas)” de chacun à
faire son devoir : nous y étions aussi
bien poussés par le système de va-
leurs de notre communauté, que
par le bien implicite promu par nos
formes de vie individuelles et col-
lectives. En revanche, la conception
moderne d’une morale non butée,
ou appuyée, sur le bien d’une com-
munauté ou d’un être, a bien le
mérite de revendiquer une morale
valable pour tous – fondée sur la
seule raison et non sur les logiques
sociales propres à une Cité ou à une
culture donnée, par exemple –, elle
s’expose cependant à deux problè-
mes d’importance : 1. Pourquoi être
juste, ou quel intérêt trouver à la
morale, si la justice n’est plus la
clarification de mon intérêt bien
compris ? 2. Comment comprendre
la raison pratique, en charge de la
morale, dès lors que, ne pouvant
plus fonder la justice sur la recher-
che du bien, ou sur l’ordre sage du
monde, il n’y a plus guère que la
capacité des hommes à raisonner
sur les normes éthiques qui puisse
décider en droit – universellement,
puisque la raison n’est pas liée à
des intérêts singuliers – du juste et
de l’injuste ?
Rawls et la théorie
de la justice
■
De fait, Rawls critique une
version particulière de la
justice comprise selon une
certaine vision du bien (le Bien
n’étant plus ici principalement
compris, comme dans les éthiques
grecques, au sens moral, mais aussi
bien au sens instrumental) dans les
théories utilitaristes anglo-saxon-
nes. Ce n’est pas l’optimisation,
marginale ou globale de l’utilité so-
ciale (l’augmentation du bonheur du
plus grand nombre, ou de chaque in-
dividu en particulier) qui permet de
juger du bien-fondé d’une loi ou
d’une mesure, mais le respect d’un
certain nombre de principes.
Pour Rawls, la raison peut déter-
miner quels sont ces principes de
la justice, que toute loi doit respec-
ter pour être juste, en réfléchissant
sur une fiction, celle d’un état de
nature où les individus ne seraient
pas encore réunis en corps social,
mais négocieraient les principes de
justice qu’ils voudraient voir appli-
quer dans la société une fois celle-
ci constituée. Quelle idée de la jus-
tice, quelle structure de base de la
société (basic structure) mettrait
tout le monde d’accord, avant
même qu’aucune loi concrète n’ait
vu le jour, avant même que la so-
ciété ne commence de s’organiser ?
C’est ce que Rawls appelle la si-
tuation originelle.
Pour décider de cette question, il
suffit de se donner les individus

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
A Numéro 39 • Décembre 2005 a
sans tout ce que la société concrète
leur apporte : richesse, honneur,
éducation... Il faudrait même que
les individus ignorent les talents et
les capacités naturels dont ils dis-
poseront dans l’État, afin que les
principes de la justice ne soient pas
choisis en fonction d’intérêts trop
personnels. C’est ce que Rawls ap-
pelle le voile d’ignorance, qui dans
la fiction de la situation originelle,
garantit que les individus se déter-
minent sur les principes de la jus-
tice au mieux de leurs intérêts in-
dividuels, mais sans pouvoir devi-
ner quelles lois seraient concrète-
ment les plus profitables pour eux
compte tenu de leurs bonnes ou
mauvaises dispositions singulières.
“Les partenaires ignorent certains
types de faits particuliers... mais ils
connaissent tous les faits généraux
qui affectent le choix des principes
de justice”.
Lorsque je choisis les principes de
la justice, dans la situation origi-
nelle de Rawls, je ne sais pas en-
core ce que la vie me réserve : je
sais seulement que je vais vivre
dans une société donnée avec son
système juridique. Tout le problème
est donc de déterminer quel serait
le meilleur régime, le plus juste, en
tout état de cause, que je sois intel-
ligent ou idiot, rusé ou maladroit,
fort ou fragile. Le choix des princi-
pes supposent enfin des individus
qui choisissent en fonction d’eux-
mêmes, et de leur intérêt, sans se
soucier des intérêts des autres (c’est
le désintéressement mutuel), mais
en sachant que les autres existent
(ce qui me force aussi à les pren-
dre en considération) : cela garan-
tit que les principes de la justice
mis au jour ne témoignent pas d’un
altruisme problématique (une mo-
rale du sacrifice par exemple), et
qu’ils pourront s’accorder concrè-
tement à la poursuite individuelle
de mon bien-propre.
“Dans la théorie de la justice
comme équité, la position
originelle d’égalité correspond à
l’état de nature dans la théorie
traditionnelle du contrat social.
Cette position originelle n’est pas
conçue, bien sûr, comme étant
une situation historique réelle...
Il faut la comprendre comme
étant une situation purement hy-
pothétique, définie d’une ma-
nière à conduire à une certaine
conception de la justice. Parmi les
traits essentiels de cette situation,
il y a le fait que personne ne con-
naît sa place dans la société, sa
position de classe ou son statut
social, pas plus que personne ne
connaît le sort qui lui est réservé
dans la répartition des capacités
et des dons naturels, par exem-
ple l’intelligence, la force, etc.
J’irais même jusqu’à supposer
que les partenaires ignorent leur
propre conception du bien ou
leurs tendances psychologiques
particulières. Les principes de la
justice sont choisis derrière un
voile d’ignorance. Ceci garantit
que personne n’est avantagé ou
désavantagé dans le choix des
principes par le hasard naturel
ou par les circonstances sociales.
Comme tous ont une situation
comparable et qu’aucun ne peut
formuler des principes favorisant
sa condition particulière, les prin-
cipes de la justice sont le résultat
d’un accord ou d’une négociation
équitable (fair)... Tout ceci nous
explique la justesse de l’expres-
sion “justice comme équité” : les
principes de la justice sont issus
d’un accord conclu dans une si-
tuation initiale elle-même équita-
ble. (Seuil Essais, trad.
C. Audard, p. 38).
Peu importe ici la solution que
Rawls en tire sur la nature même
de la justice sociale : dans la situa-
tion originelle, les individus se
mettraient d’accord sur le fait que
les avantages dont jouissent les uns
ne sont acceptables, dans une so-
ciété donnée, qu’à condition de pro-
fiter aux plus désavantagés de la
société. Ainsi, même si je suis au
bas de l’échelle sociale, je sais que
le système est juste à condition que
je profite des biens sociaux appor-
tés par ceux qui sont en haut de
l’échelle. Voilà quels sont donc les
deux principes de la justice sociale
que tout individu doit nécessaire-
ment admettre, s’il est rationnel, en
se mettant dans la fiction de la si-
tuation originelle :
Principe 1 : “Chaque personne
doit avoir un droit égal aux sys-
tème le plus étendu de libertés de
base égales pour tous qui soit
compatible avec le même système
pour les autres.” (p. 91).
Concrètement, cela signifie qu’un
individu placé dans la situation ori-
ginelle veut être certain qu’il jouira
d’une liberté aussi grande que celle
de ses concitoyens dans une société
donnée, notamment de la liberté de
réaliser ce qu’il pense être bien
pour lui, et à proportion que les li-
bertés de tous puissent coexister.
Principe 2 : “Toutes les valeurs
sociales – liberté et possibilités
offertes à l’individu, revenus et
richesse ainsi que les bases socia-
les du respect de soi-même – doi-
vent être réparties également, à
moins qu’une répartition inégale
de l’une ou de toutes ces valeurs
ne soit à l’avantage de chacun.”
(p. 93).
C’est à la condition d’admettre ce
principe de justice, que, selon
Rawls, tout individu en tant que tel,
et tout bien réfléchi, accepterait
d’entrer dans la société, car ce prin-
cipe de justice permet à chaque in-
dividu de diminuer les risques
d’être traité injustement. Et c’est au
nom de ce principe de justice que
nous pouvons juger d’un système
légal et social concret, ou que nous
pouvons juger d’un système légal
ou social injuste, qui privilégie les
uns au détriment des autres. Le
principe de justice que je choisirais
selon la fiction de la situation ori-
ginelle, et en ignorant quels sont
mes talents ou mes chances, me
permet de décider concrètement si
les lois bien réelles de ma société
(La France ou les États-Unis par
exemple) sont conformes aux exi-
gences de justice que je pose, dès
lors que je m’abstrais de cette so-
ciété. En somme le principe de jus-
tice que je choisis dans la situation

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
A Numéro 39 • Décembre 2005 a
originelle me permet de légitimer,
ou non, les lois existantes de mon
pays, c’est-à-dire de décider si el-
les sont conformes à la Justice, ou
si elles ne sont qu’une caricature
de justice derrière leur prétention à
dire le droit.
Ce qu’il importe de souligner ici,
ce ne sont pas les énonciations con-
crètes des deux principes de justice
que la fiction de la situation origi-
nelle et l’hypothèse du voile
d’ignorance permettent à Rawls de
dégager ; mais, premièrement, c’est
en fonction de ces deux principes
mis au jour par la réflexion ration-
nelle sur l’hypothèse de la situation
originelle que nous pouvons juger
justes ou injustes les lois très réel-
les de nos sociétés. Nous essayons
en somme, par la fiction de la posi-
tion originelle, de rendre raison de
nos intuitions morales fondamen-
tales, et de reconstruire les princi-
pes qui guident nos jugement. C’est
la méthode de l’équilibre réfléchi :
“Par un processus d’ajustement,
je présume que nous finirons par
trouver une description de la si-
tuation initiale qui, tout à la fois,
exprime des conditions préala-
bles raisonnables et conduisent à
des principes en accord avec nos
jugements bien pesés”.
Ce qu’il faut secondement souli-
gner, c’est la portée de cette mé-
thode. Derrière la fiction d’indivi-
dus rassemblés avant leur constitu-
tion en corps social, se dissimule
en fait une réflexion sur les condi-
tions a priori de toute société juste
concrète : c’est à certaines condi-
tions, sous certaines garanties (les
deux principes de justice), qu’un
individu qui ignore tout de ses ta-
lents ou de son capital social ou
culturel, accepterait a priori, et s’il
est rationnel, d’entrer en société. En
somme, lorsque la raison réfléchit
sur cette expérience de pensée (à
quelles conditions de justice des
individus rationnels quelconques
ont raison d’accepter le jeu social),
la raison n’a affaire qu’à elle-même
pour savoir ce qu’est la Justice, et
pour savoir donc ce que nous som-
mes légitimés (ce qu’il est juste) de
vouloir pour notre société ici et
maintenant. Comme on le voit, la
théorie de Rawls met au jours les
conditions de la justice à travers une
procédure, une construction que
l’imagination peut produire, et re-
produire si besoin est, selon la-
quelle chaque individu doit décider
du juste en ignorant sa position
dans la société, et les caractéristi-
ques les plus importantes de ce
qu’il est, notamment sa conception
du bien. La justice est ainsi ultime-
ment fondée non pas sur le bien
concret d’une société réelle, mais
sur la négociation idéale d’une
communauté d’êtres rationnels.
Mais loin d’aboutir à des règles
abstraites, la négociation idéale
aboutit au contraire à la détermina-
tion d’un système politique et so-
cial (celui d’une démocratie cons-
titutionnelle) qui permet à chacun,
sous la condition du respect des
critères formels de la justice (le res-
pect des deux principes) de pour-
suivre son bien comme il l’entend.
En 1985, Rawls a jugé bon de pré-
senter sa théorie de la justice
comme une “théorie politique, et
non pas métaphysique” (Justice et
Démocratie, p. 203). La précision
est d’importance : Rawls n’affirme
pas ainsi que sa théorie, à titre de
doctrine, puisse faire l’unanimité
ou puisse être acceptée par tous
comme un discours qui prétend à
la Vérité. Elle prétend seulement
formuler de manière rigoureuse les
règles de base qui régissent, ou doi-
vent régir une société démocrati-
que. Dans sa Théorie de la justice,
les choses n’étaient pas en effet tou-
jours très claires : Rawls donnait
parfois le sentiment de faire une
théorie pure de la justice, suscepti-
ble de prendre une vue globale des
sociétés et de la vie humaine,
comme si sa philosophie pouvait
entrer par exemple en concurrence
avec la philosophie chrétienne de
la justice politique ou morale. La
justice politique dont il faisait la
théorie n’aurait été qu’un cas par-
ticulier d’une théorie plus large de
la justice définie comme équité. La
situation aurait été étrange : la théo-
rie de la justice qui prétendait jus-
tifier le pluralisme des formes de
vie et des doctrines aurait revendi-
qué pour elle seule la vérité, et
aurait prétendu imposer cette vérité
aux autres ! En fait, Rawls tente
seulement de mettre au jour les con-
ditions de possibilité d’une société
démocratique stable, c’est-à-dire
les réquisits indiscutables que tous
doivent admettre, indépendamment
de leur conception du bien ou de
leurs philosophies, pour coexister,
pour pouvoir discuter, et pour re-
chercher leur bien propre. Quelle
que soit ma philosophie ou ma re-
ligion – ma conception “supé-
rieure” du juste ou de la morale –,
il y a un certain nombre de valeurs
ou de principes que je dois néces-
sairement admettre pour vivre dans
une république justement ordonnée
(well-ordered society). Certes, les
doctrines morales ou spirituelles
peuvent s’opposer – et dans nos so-
ciétés libres, elles ne peuvent pas
ne pas être très diverses, tant nos
conceptions du bien diffèrent d’un
individu à l’autre –, mais si ces doc-
trines coexistent, on peut espérer
qu’elles ne le font pas par la force
des choses (selon un statu quo hos-
tile, en attendant chacune pour de-
main la victoire sur toutes les
autres), mais que leur présence dans
l’espace public suppose un consen-
sus par recoupement (overlapping
consensus), sur des valeurs politi-
ques et non pas morales ou philo-
sophiques :
“Un consensus par recoupement
existe dans une société quand la
conception politique de la justice
qui gouverne ses institutions de
base est acceptée par chacune des
doctrines compréhensives, mora-
les, philosophiques et religieuses
qui durent dans cette société à
travers les générations.”
Le libéralisme politique de Rawls
envisage ainsi l’unité de la société
comme résultant d’un consensus
par recoupement sur une concep-
tion politique de la justice. Dans un
tel consensus, les principes de la
justice sont adoptés par des ci-
toyens qui, par ailleurs, embrassent
des conceptions du bien différen-
tes, voire conflictuelles.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%