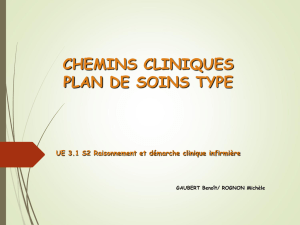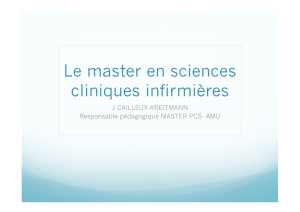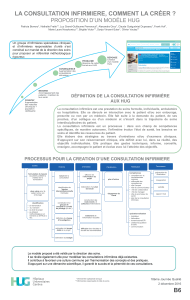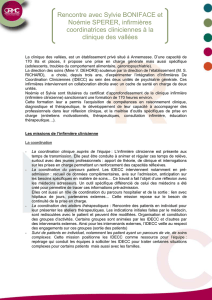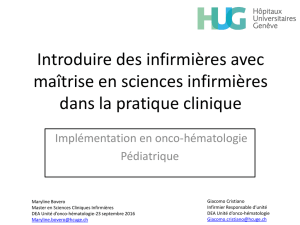Collaboration infirmière

La communication médecin généraliste – infirmière :
une expérience en maison médicale.
Marie-Louise Fisette
Infirmière à la Maison Médicale de et à Ransart
Dr Patrick Jadoulle
Médecin généraliste à la Maison Médicale « La Glaise » à Marchienne-au-Pont
Présentation des Maisons Médicales (M.M.)
En ce premier semestre 2008 les régions bruxelloise et wallonne comptent environ 80 MM (alias
Associations de Santé Intégrée) dont la toute grande majorité (75) sont membres de la Fédération des
maisons médicales et collectifs de santé francophones – FMMCSF (voir www.maisonmedicale.org ).
Il s’agit d’équipes pluridisciplinaires intégrées, polyvalentes, qui s’efforcent d’offrir à la population
des soins et services de santé de proximité en privilégiant essentiellement quatre axes de travail :
- l’approche globale des problèmes de santé ;
- l’intégration au travail curatif de démarches de prévention et de promotion de la santé, tant au
point de vue individuel que collectif (santé communautaire) ;
- la continuité des soins via un outil centralisé, de plus en plus souvent informatisé, de support
de l’information médicale ;
- l’accessibilité qui s’entend sur le plan financier, géographique, culturel,…
Les MM membres de la FMMCSF regroupent un bon millier de travailleurs dont environ 320
médecins généralistes, 200 accueillant(e)s, une centaine de kinésithérapeutes et à peu près autant
d’infirmier(e)s, une cinquantaine de travailleurs sociaux et autant de personnel administratif,
également des psychologues, diététiciens, ergothérapeutes,…
Ces professionnels de l’aide et du soin à domicile fonctionnent en équipes autogestionnaires et non
hiérarchisées et travaillent en étroite interaction avec les autres professionnels et services du réseau
psycho-médico-social du quartier ou de la région concernée, voire avec les pouvoirs publics locaux,
avec lesquels des actions concertées de santé communautaire et/ou d’éducation permanente sont
régulièrement organisées.
Ces MM, réparties à parts à peu près égales entres les régions bruxelloise et wallonne, couvrent une
population d’environ 170.000 personnes, soir un habitant sur 25 pour ces deux régions.
Une des spécificités des MM est sans nul doute le fort degré d’intégration de l’équipe et des services
qu’elle prodigue.
Intégration ou coordination
Les relations entre différentes professions au sein d’une équipe de soins peuvent se décliner
essentiellement selon deux modes majeurs : coordination ou intégration.
Dans le mode de la coordination, chaque professionnel, ou chaque secteur professionnel, poursuit
prioritairement son objectif propre tout en s’organisant avec les autres en vue de la réalisation d’un
dénominateur commun, le plus souvent ponctuel, bien ciblé, et transitoire : c’est le cas quand un
généraliste est amené à collaborer avec un centre d’aide aux toxicomanes, un confrère spécialiste,
voire une équipe de seconde ligne en soins palliatifs.
Dans le mode de l’intégration l’équipe définit un projet commun, par rapport à son public cible, autour
duquel vont venir ensuite s’articuler les différents professionnels.
1

A priori aucune formule n’est meilleure que l’autre, tout dépend de la situation où l’on se trouve et des
objectifs que l’on poursuit. Par ailleurs les professions à caractère très polyvalents dans leur secteur
d’activité auront plus facile à fonctionner sur un mode intégré que celles qui ont un profil plus
« pointu », plus spécialisé. Les médecins généralistes et les infirmières1 sont, dans le domaine des
soins de première ligne, sans conteste les deux professions qui ont le plus haut degré de polyvalence et
il est donc assez naturel que ces deux professions collaborent de près sur un mode relativement
intégré, notamment au sein des MM.
Une communication qui ne va pas de soi.
Pourtant, la communication médecin-infirmière est un thème souvent abordé lors de nos
réunions d’équipe car ce n’est pas si simple.
Les infirmières rencontrent des difficultés de communication avec les médecins : ce
qu’elles leur apportent comme informations ne paraît pas toujours les intéresser et les
réponses des médecins aux questions qu’elles leur posent ne semblent pas toujours satisfaire
ces dernières. De leur côté les médecins attendent parfois "d'autres choses" de la part des
infirmières.
D’où pourrait venir cette impression qu’ont les infirmières de n’être pas entendues par le
corps médical ? Les causes en sont multiples : cadre de référence différent, langage
différent, apprentissage de la subordination au médecin dans la formation, …
Actuellement, dans le domaine des soins de première ligne en tout cas, les mentalités
changent. Les soignants se coordonnent davantage que par le passé et chacune des
professions est consciente de l’importance des autres professions.
Pour ce qui concerne le sujet du jour, la communication médecin – infirmière, chacune des
professions est de plus en plus consciente de leur complémentarité.
Une communication efficace entre ces deux professions améliore la collaboration, est
indispensable dans des structures de soins intégrés et, in fine, améliore la qualité des soins
au patient.
Un pré-requis pour une communication médecin-infirmière harmonieuse est une
connaissance mutuelle, connaissance des personnes elle-même, connaissance des
compétences, des cadres de référence.
Vous connaissez vos cadres de référence, nous nous attacherons donc ici aux théories et aux
compétences de l’art infirmier.
La conceptualisation de la pratique infirmière s’articule autour de deux axes principaux : la
pratique autonome ou rôle propre, associée à la reconnaissance du potentiel infirmier, et le
rôle confié, dépendant du médecin (les actes délégués). La pratique de collaboration
interdisciplinaire est évidente dans le rôle confié mais tire de nombreux enseignements dans
le rôle autonome.
Une façon plus accessible pour exprimer la réalité de ces pratiques est une description du
concept de soins. Il est malaisé de rendre accessible socialement et économiquement la
nature des soins et par là même la reconnaissance de la spécificité de la fonction
d’infirmière.
« Le soin, dans son sens générique, est une fonction sociale indispensable qui recouvre de
nombreuses dimensions complémentaires les unes aux autres, en particulier la dimension
coutumière (M.-F. Collière2) et la dimension curative.
La dimension coutumière est la dimension que nous apprennent et dont s'acquittent les
soignants naturels que sont nos parents, que l'on gère soi-même quand on est autonome et
bien portant. Cette dimension du soin global couvre la réponse aux besoins biologiques,
affectivo-émotionnels, cognitifs et intellectuels, spirituels et sociaux de la personne
humaine. Cette dimension large du «prendre soin» regroupe une multitude d'actes et de
pratiques. C'est une dimension qu'il est difficile de professionnaliser parce qu'il est difficile
1 Pour faciliter la lecture du texte, le mot « infirmière » sera utilisé et sous-entend : infirmier et infirmière.
2 Collière Marie-France, Promouvoir la vie, InterEditions, 1982
2

de la reconnaître en tant que soin à part entière tellement elle se confond avec la vie et
l'ordinaire du quotidien. Les infirmières l'ont appelée : "le rôle propre".
La dimension curative et réparatrice du soin est la dimension du «traiter-guérir», celle qui
devient nécessaire lorsque survient la maladie ou l'accident et que l'on a besoin de recourir à
des techniques et à des interventions particulières non habituelles. Cette dimension s'est
considérablement développée depuis la fin du siècle dernier grâce à l'essor de la médecine
scientifique.
Cette dimension s'additionne à la dimension coutumière, sans cependant se substituer à elle,
sans pouvoir rendre celle-ci secondaire ou annexe. Il faut souligner que de nombreuses
personnes avancent très tard dans leur vie sans avoir recours aux soins curatifs-réparateurs.
Mais personne ne saurait se passer longtemps des soins coutumiers.
« La pratique infirmière auprès des personnes malades … se distingue de la
pratique médicale en ceci qu'elle a la particularité d'articuler intimement ces
deux dimensions indissociables. C'est pourquoi on parle volontiers de
pratique soignante pour désigner la pratique infirmière, soulignant ainsi
l'approche à vocation unifiante et multidimensionnelle du soin et de la
personne qui caractérise cette pratique. » (3)
En partant de l’analyse de situations concrètes de travail, un groupe d’infirmière de maisons
médicales a défini une dizaine de fonctions différentes faisant partie du rôle de
l’infirmière :
1 La fonction de soins : préventifs, curatifs, de bien-être (confort), palliatifs, de
participation au diagnostic (ex : prise de sang, tension, ECG,...)
2 La fonction d’éducation
3 La fonction d’information
4 La fonction de soutien, d’accompagnement
5 La fonction de prévention : - individuelle - collective
6 La fonction de coordination, lien, collaboration
7 La fonction d'observation de la personne dans et avec son environnement
8 La fonction de surveillance
9 La fonction de gestion du matériel
10 La fonction "politique" (interpellation, actions collectives, ouverture, défense
professionnelle, réflexion sur l'évolution de la profession).
La confiance ressort comme l’autre élément fondamental qui permet l’instauration de la
collaboration interdisciplinaire.
La culture médicale repose encore trop souvent sur une hiérarchie interprofessionnelle,
véhiculée dans le cadre d’un modèle organisationnel hospitalier au sein duquel le médecin
conserve sa position d’autorité
Pour que la collaboration, et plus encore l’intégration, puissent réussir pleinement, il doit
exister un lien de confiance entre les partenaires, un partage de pouvoir de responsabilités
vécu dans le respect mutuel et une relation d’égalité. (4)
Le climat de confiance est possible si les rôles sont explicites et définis en commun et si les
compétences de chacun sont reconnues.
Selon les infirmières, l’importance d’être reconnue et de prendre sa place compte parmi les
composantes majeures qui les soutiennent dans leur pratique autonome.
La communication et les relations non hiérarchiques, établies dans un climat de respect et
d’ouverture aux autres, facilitent cette collaboration.
Cette collaboration prend du temps pour s’instaurer. Chacun est amené à faire un effort hors
de son domaine propre et de son propre langage technique pour s’aventurer dans un domaine
dont il n’est pas le propriétaire exclusif. L’interdisciplinarité repose sur un objectif
clairement défini dès le départ entre partenaires de soins.
3 Moreau Danielle, Ethique clinique et pratique infirmière, in Soins n° 618, septembre 1997, p44
4 Roy Danielle et Sylvain Hélène, La pratique infirmière en GMF et son contexte d’interdisciplinarité in
Perspective infirmière, septembre/octobre 2004, pp 16-25
3

Pourquoi communiquer ?
La collaboration infirmières-médecins est reconnue comme un déterminant de la qualité des
soins.
Sa raison d’être, c’est la nécessité de réunir des personnes issues de disciplines diverses
dans le but de solutionner des problèmes dont la complexité requiert l’apport collectif des
savoirs impliqués. L’efficience d’une telle pratique est plus marquée dans des situations
complexes de soins.
L’interdisciplinarité ou même transdisciplinarité est un espace commun, un facteur de
cohésion entre des savoirs différents. Elle permet d’accroître la prise en charge globale
La communication participe aussi de l’éthique. La personne étant pour tous les soignants au
centre de leurs préoccupations, le savoir et l’expertise de chacun, patient, médecin,
infirmière, kinés, assistante sociale, …est à partager pour une prise en charge judicieuse et
adaptée.
De plus, la communication donne un sens et une cohérence à nos interventions.
Mais pour que cette communication puisse se dérouler au mieux, au-delà des valeurs
communes qui président donc aux responsabilités complémentaires des médecins et des
infirmières, il importe que soit balisé le terrain commun entre ces deux professions.
Quel est notre terrain commun ?
Nous nous sommes alors posé, dans un premier temps entre infirmières, la question de ce
terrain commun : que peut apporter chaque profession dans l'exercice de l'autre profession ?
Des questions préalables se posent : sur quels terrains agissent les deux professions, les
infirmières, les médecins, et même d'autres professions.
Dans nos équipes de MM, cette réflexion a démarré entre infirmières, elle est donc issue de
leur conception de leur rôle d'abord et de celui du médecin ensuite.
La réflexion est partielle et n’a comme seule prétention que de commencer la réflexion,
pour pouvoir dans un second temps la confronter avec d'autres professionnels.
La rencontre sur un terrain commun est présente dans plusieurs pans de la pratique
infirmière. Des interactions d'importance différente et avec plus ou moins d'harmonie ont
lieu à travers la dimension curative et réparatrice, la dimension coutumière, le soutien aux
familles, la réflexion et la formulation d'objectifs, l'orientation des interventions et plus
globalement de la politique de nos associations, la prévention, la formation, …
Une des caractéristiques du contact infirmier qui nous intéresse dans ce contexte est sa
fréquence. Le contact infirmier est régulier, parfois quotidien ou biquotidien ou plus
fréquent et s'inscrit souvent dans la durée.
Par ce fait, les infirmières entrent dans une famille, parfois en font partie. Toutes les
infirmières ont ainsi vécu au moins une relation avec une personne âgée qu’elles
connaissaient mieux que leur propre grand-mère.
Elles entrent dans le quotidien des personnes, dans leur histoire, leur confort ou non-
confort, leurs habitudes, leurs odeurs, … avec parfois une importante proximité physique,
en touchant leur corps, en l'envahissant parfois. Les infirmières interfèrent dans les relations
familiales : conflits, concurrences affectives, … Le patient s'adresse donc dans certains
domaines plus facilement à l'infirmière, qu'il considère comme plus proche, plus à son
niveau.
Le patient, avec le médecin, est parfois dans un rôle social plus distant, voire dans un
système autoritaire, hiérarchique. Le patient va donc lui confier des vécus différents.
Ces deux approches ne sont pas du tout opposées, elles sont complémentaires.
Le référent dans une famille est parfois le médecin, parfois l'infirmière, parfois d'autres
professionnels.
Les demandes confiées par une personne à l’infirmière dépendent de l'investissement de
celle-ci : ce sera différent selon qu'il s'agit d'une série de six injections ou d'une
4

intervention biquotidienne pendant des mois, voire des années. Les demandes dépendent
aussi de l'ouverture du professionnel et de la relation avec une famille. Les demandes sont
ici prises dans leur sens large, incluant aussi les situations conflictuelles. Les patients se
donnent la permission d'entrer en conflit avec certains professionnels pas avec d'autres.
Les demandes, adressées aux infirmières, sont influencées par la nature des soins, la
proximité (le toucher) dans le soin, le domaine de la demande
Certaines personnes ont peur du médecin et préfèrent passer par l'infirmière, même pour des
questions d’ordre médical. D'autres ont l'impression que les plaintes exprimées à
l'infirmière ne les font pas entrer immédiatement dans la maladie, cela paraît moins grave. Il
y a aussi les petites plaintes que les personnes ne diront pas à leur médecin.
Le médecin serait davantage dans l'ordre du paternel, les infirmières dans celui du maternel.
L'infirmière est davantage dans le "prendre soin", dans le soin coutumier.
Dans la dimension curative, des interventions comme la prise de T.A., la prise de sang se
pratiquent en collaboration, nous pourrions dire en sous-traitance. L'infirmière réalise le
geste, l'interprétation est de la compétence des médecins.
Toutefois, il est légitime que les infirmières demandent des données au médecin sur le
traitement car elles ne sont pas de simples exécutantes et ont à cœur de pouvoir répondre
aux questions des patients.
La dimension coutumière est difficile à exprimer, elle est faite de détails, de sensations, de
quelques mots ou de non-dits, … Les autres professions voient difficilement à quoi elle
correspond, elle est considérée par les médecins comme anecdotique. Ils ne s'y intéressent
pas.
Cependant, nous pensons que les données récoltées lors des soins coutumiers apportent une
vision plus globale, une vision appartenant davantage à la personne.
C'est même souvent la porte d'entrée d'expression d'un problème plus existentiel.
Est-il vraiment utile de partager ce domaine propre à la profession d’infirmière avec
d'autres professions ? Qu'est-ce que cela apporte au patient ? Comment et jusqu'où le
partager ?
Dans les soins palliatifs, les soins coutumiers prennent davantage d'importance.
Les demandes des personnes en souffrance sont de plus en plus axées sur le bien-être
(soulagement douleur, confort du corps, accompagnement quotidien).
Une collaboration plus étroite est importante pour le patient. Les soignants ont un besoin
accru de communication.
Pourrions-nous avancer l'idée que le médecin a une vue plus globale de la santé, l'infirmière
une vue plus globale du quotidien ?
Une des pistes pour faciliter la communication entre soignants serait de réfléchir ensemble
au sens de nos interventions chez chaque patient et de définir des objectifs communs, ainsi
que les rôles de chacune des professions sans oublier l'aspect "prendre soin".
Les infirmières demandent souvent des informations aux médecins, et ceux-ci n’ont pas
l’habitude de les leur communiquer spontanément. Les infirmières sont plus demandeuses
de communication que les médecins.
Avant une communication avec les médecins, il est plus efficace d'y réfléchir d'abord entre
infirmières, pour pointer le problème, cerner ce qui doit être transmis et clarifier les besoins
d'information ; pour ensuite leur communiquer précisément ce que l'on attend d'eux. Les
infirmières peuvent dire uniquement l'essentiel aux médecins, et s'ils ont besoin
d'informations supplémentaires, il est de leur responsabilité de le demander.
Pour plus d'efficacité, en dehors des réunions prévues, il n’est pas toujours aisé de trouver
le bon moment pour interpeller le médecin.
Le patient considère encore trop souvent que le médecin a une autorité sur l'infirmière,
même sur son propre terrain. Cette vision est un héritage du passé et ne changera que très
lentement.
5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%