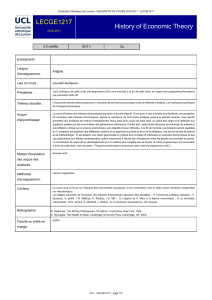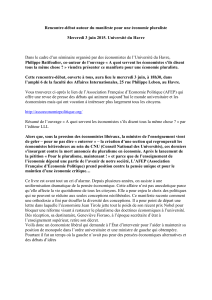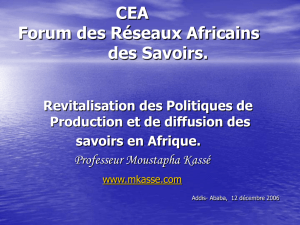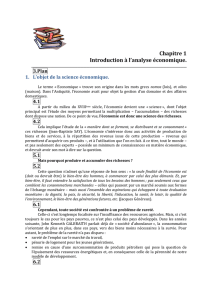partie i : produire, repartir, consommer

Dominante SCIENCE ECONOMIQUE
PARTIE I : PRODUIRE, REPARTIR, CONSOMMER
L’intérêt et toute la richesse des sciences économiques et sociales est de pouvoir analyser un même objet
d’étude en croisant les regards de différentes disciplines. Les économistes, les sociologues, les politologues,
mais aussi les ethnologues (ou anthropologues) abordent les mêmes objets d’études mais sous des angles et
avec des outils d’analyse différents. La complémentarité de ces approches offre une vision plus pertinente car
plus globale des phénomènes économiques et sociaux.
Le regard de l’économiste permet de comprendre certaines dimensions du fonctionnement d’institutions comme
les marchés, les entreprises, les services publics … en s’appuyant sur des concepts (la valeur ajoutée, la
productivité, le revenu disponible, les élasticités…), des méthodes (micro-économie , macro-économie…), des
théories (l’analyse libérale classique / néo-classique, l’analyse marxiste, keynésienne…), des modèles
théoriques (la concurrence pure et parfaite, le circuit économique…) ou des analyses de données (économétrie).
Quelques grandes questions que se posent les économistes
« Ce que l'on sait n'est pas à nous », écrivait Marcel Proust, dans A la recherche du temps perdu.
Les grands économistes qui ont marqué la discipline ont laissé en héritage des réponses provisoires, opposés
ou complémentaires, aux questions auxquelles ils ont choisi de répondre.
Les questions qu’ils se sont posées ont notamment été déterminées par le contexte économique et social ou
les grandes crises qui ont marqué la vie de ces auteurs. Leurs réponses sont aussi déterminées par
l'approche méthodologique qu'ils ont adoptée : une lecture microéconomique ou macroéconomique, une
vision à long terme ou à court terme, une approche réaliste ou modélisée de la société. Si les grandes
questions que se posent les économistes évoluent dans leurs formulations, les réponses des grands
économistes restent, en grande partie, toujours actuelles et débattues.
Quelques-unes de ces grandes questions sont abordées dans les chapitres de la partie économique du
programme de 1ère. D’autres trouveront des réponses (toujours débattues…) en terminale.
la division du travail engendre des avantages pour les pays qui doivent spécialiser leur production


« L'impulsion fondamentale qui met et maintient en
mouvement la machine capitaliste est imprimée par
les nouveaux objets de consommation, les nouvelles
méthodes de production et de transport, les
nouveaux marchés, les nouveaux types
d'organisation industrielle - tous éléments créés par
l'initiative capitaliste ».
Joseph Aloïs Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et
Démocratie, 1942.
« Les deux vices marquants du monde économique
où nous vivons sont, le premier, que le plein emploi
n'y est pas assuré, le second que la répartition de la
fortune et du revenu y est arbitraire et manque
d'équité ».
John Maynard Keynes, Théorie générale de l'emploi de
l'intérêt et de la monnaie, 1936.
Après un chapitre introductif sur la démarche des économistes,
QUE VA-T-ON ETUDIER DANS CETTE 1ère PARTIE ?
Pour finir, le chapitre 6 de cette partie abordera la production dans l’entreprise
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5

Chapitre 1 : La démarche des économistes
(Manuel p. 19-24)
Objectifs :
- Montrer que la science économique étudie le problème des choix dans une société d’un point de vue
scientifique.
- Présenter les méthodes et outils utilisés par la science économique.
- Montrer que la science économique comprend différents courants de pensée
Savoirs et savoir-faire :
- Être capable de définir l’objet d’étude de la science économique.
- Être capable de définir les notions suivantes : modèle, théorie, analyse empirique, corrélation, causalité,
microéconomie, macroéconomie, variable, économie positive, économie normative.
Problématiques :
- Qu’est - ce que la science économique ?
- Quelles sont les méthodes utilisées par les économistes ?
- En quoi la science économique est-elle une discipline traversée par de nombreux débats ?
I) Qu’est-ce que la science économique ?
L’économie ne s’est réellement constituée en science autonome, avec un objet d’étude propre, qu’après l’émergence des
sociétés « modernes ». Avec l’institutionnalisation du marché, les activités économiques se sont distinguées des autres
structures sociales, sur lesquelles elles ont exercé une influence croissante.
A) Un essai de définition
Voici plusieurs définitions de la science économique :
« La science économique est celle qui a pour objet la production, la consommation et l’échange de biens et
services rares » (J. Fourastié, Pourquoi nous travaillons, PUF, 1959).
« L’objet de l’économie politique est la connaissance des lois qui président à la formation, à la distribution et à la
consommation des richesses » (Jean Baptiste SAY, Traité d’économie politique, 1803).
« L’économie politique est la science de l’administration des ressources rares dans une société; elle étudie les
formes que prend le comportement humain dans l’aménagement onéreux du monde extérieur, en raison de la
tension qui existe entre les désirs illimités et les moyens limités des sujets économiques » (Raymond
BARRE Économie politique, PUF, 1959).
« La science économique étudie la façon dont les individus, les entreprises et les pouvoirs publics font des choix
dans nos sociétés. Ces choix et les arbitrages qu’ils impliquent sont incontournables parce que les biens, les
services et les ressources désirées sont nécessairement rares ». (Joseph Stiglitz, Carl E. Walsh, Principes
d’économie moderne, De Boeck, 2010).
► D’après ces définitions des grands économistes, on peut synthétiser et proposer la définition suivante :
La science économique étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent des ressources rares en vue
de satisfaire au mieux leurs besoins. Elle est une science sociale qui étudie la manière dont les hommes
s’organisent pour produire, répartir, distribuer et consommer les biens et les services destinés à satisfaire leurs
besoins.

Doc. 1 p. 20 : Une science des ressources rares ?
B) Il existe deux grandes approches :
micro-économie et macro-économie
Doc. 2 p. 21 : Trois dimensions de la science économique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%