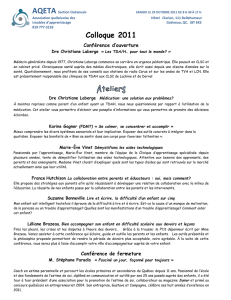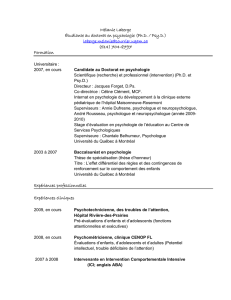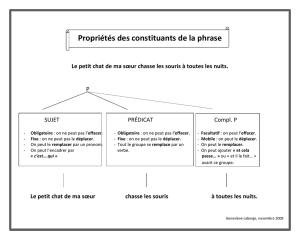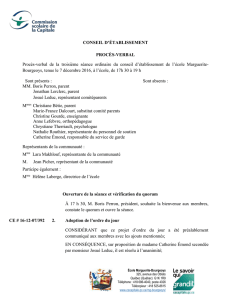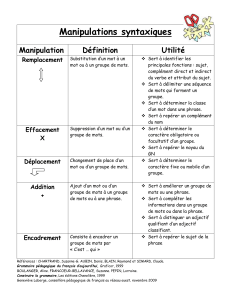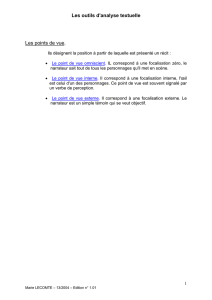Écrire la « parlure » canadienne-française : la langue oralisée dans

Écrire la « parlure » canadienne-française :
la langue oralisée dans lAlbert Laberge
Caroline Loranger
Département de langue et littérature françaises
Université McGill, Montréal
Mémoire soumis à lUniversité McGill
en vue de lobtention du diplôme de
Maîtrise ès arts littérature française
Décembre 2013
©Caroline Loranger, 2013

RÉSUMÉ
L dAlbert Laberge, écrivain canadien-français de la première
moitié du XXe siècle, a fait lobjet de nombreuses études sur le plan thématique.
Considéré comme le premier auteur naturaliste du Québec et comme un
représentant de lanti-terroir, Laberge a retenu lattention des critiques pour son
humour noir et ses histoires sordides savamment mises en scène.
Toutefois, bien que les critiques reconnaissent la valeur de l
labergienne, ils ressentent un véritable malaise par rapport à la manière dont elle
est écrite. Laberge, comme la plupart de ses contemporains, introduit une langue
oralisée dans ses textes. Cependant, contrairement aux autres écrivains de son
époque, il ne limite pas lemploi de loralité aux dialogues; il utilise la langue
oralisée dans la narration de ses textes, sans employer de guillemets ou ditalique
pour marquer lemprunt de termes de registres populaires. Cette mise en contact
de la langue normative et de la langue oralisée a été vue par les critiques comme
une faute de langue et, en conséquence, Laberge fut qualifié dauteur mineur. Il
sera perçu comme un écrivain ne sachant pas réellement maîtriser les codes
langagiers propres à son métier.
Létude de lintroduction de la langue oralisée dans La Scouine et dans les
nouvelles labergiennes indique au contraire que Laberge effectuait un travail
stylistique constant et approfondi. Lanalyse formelle de l
quelle fonctionne comme un récit oralisé (concept développé par Jérôme Meizoz)
et quelle comporte de nombreuses constructions hybrides (notion empruntée à
Mikhaïl Bakhtine).
Cette relecture de l labergienne dun point de vue formel et
linguistique permet de situer Laberge comme lun des premiers écrivains
québécois de loralité.

ABSTRACT
The work of Albert Laberge, an early 20th century French Canadian writer,
has been the subject of numerous thematic studies. Considered as the first
anti-terroir Laberge
gained critics attention with his dark sense of humor and cleverly laid out sordid
stories.
Despite the fact that critics recognize the value of Laberges work, they
feel uneasy about the way it is written. Laberge, like most of his contemporaries,
introduces oralized language in his texts. However, as opposed to other writers of
his time, he does not limit orality to dialogues; he also uses oralized language in
the narrative voice of his texts, without using quotation marks or italics to signal
the borrowing of terms from the popular register. This contact between normative
and oralized languages was seen by critics as an indication that Laberge could not
really master the language codes relevant to his profession and, as a result
Laberge was identified as a minor author.
The study of the introduction of oralized language in La Scouine and in
Laberges short stories indicates on the contrary that Laberges stylistic work was
constant and profound. The formal analysis of Laberges writing shows that it
works as a oralized narrative (a concept developed by Jérôme
Meizoz) and that it involves numerous hybrid constructions (a notion borrowed
from Mikhail Bakhtin).
This re-reading of Laberges work from a formal and linguistic point of
view places Laberge as one of the first Quebec writers of orality.

REMERCIEMENTS
Je tiens dabord à remercier chaleureusement ma directrice, Catherine
Leclerc. Ses commentaires avisés tout au long du processus de rédaction mont
été dune aide inestimable. Malgré son horaire chargé et en dépit du fait quelle ait
été en congé sabbatique, elle a toujours fait preuve dune grande disponibilité et
dune grande écoute. Je lui en suis très reconnaissante.
Merci à Mathieu Simard pour ses judicieuses remarques sur mon
intégration des concepts bakhtiniens et à Myriam Vien. Leur compagnie pendant
la rédaction aura rendu cette tâche bien plus agréable que si je lavais accomplie
seule.
Je souhaite également remercier Éliane Trottier, en compagnie de qui je
considère avoir écrit mon mémoire malgré la distance, ainsi quAshley Sévigny,
Béatrice Réa, Joëlle Shaw, Gabrielle Soucy-Girard et Ariane Perreault qui ont relu
patiemment mon texte pour débusquer les dernières coquilles. Je les remercie
aussi de leur amitié indéfectible.
Je remercie ma famille et mes proches de leur appui et de leurs
encouragements. Merci à Marco de son aide, mais surtout, de sa patience.
i aussi une pensée pour m
Jaimerais enfin souligner le soutien financier du Département de langue et
littérature françaises, de lUniversité McGill et du Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada (CRSH) qui mont octroyé de généreuses bourses.
Une version de lintroduction de ce mémoire fera lobjet dun article dans
le deuxième numéro dans la revue électronique Continents manuscrits.org.

TABLE DES MATIÈRES
INDRODUCTION ................................................................................................ 1
La machine à écrire dAlbert Laberge : contexte décriture ................................... 1
Laberge, auteur mineur : redécouverte des écrits labergiens en 1963 .................... 4
Un malaise qui perdure : la langue labergienne ...................................................... 6
CHAPITRE I - Dire l’écrit et écrire la parole .................................................. 11
1. Histoire de la scission entre la langue écrite et parlée ...................................... 11
1.1 Interpénétration des voix : la construction hybride bakhtinienne .............. 14
1.2 Décloisonner les voix : le récit oralisé meizozien ...................................... 16
2. La place de la langue orale dans le texte écrit au Québec................................. 17
2.1 Le régionalisme comme construction de la langue littéraire ...................... 20
3. Le cas particulier dAlbert Laberge ................................................................. 23
3.1. Le récit oralisé dans le texte labergien ...................................................... 28
3.2 Les traits bakhtiniens de l ............................................. 29
CHAPITRE II - La Scouine : analyse et interprétation de l’oralité ............... 32
1. Un texte réfléchi ................................................................................................ 32
2. La leçon de grammaire de la Scouine ............................................................... 35
3. Transcrire la langue parlée : particularismes morphologiques et syntaxiques des
dialogues de La Scouine ........................................................................................ 37
3.1 Déformation de la prononciation ................................................................ 38
3.2 Canadianismes et archaïsmes dans les dialogues ....................................... 41
4. Ignorance et langue oralisée .............................................................................. 42
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
1
/
97
100%