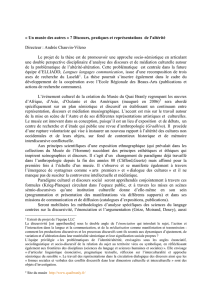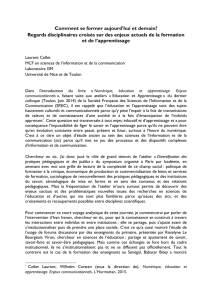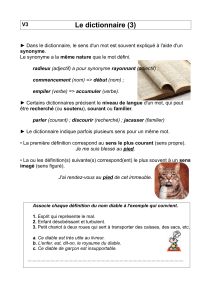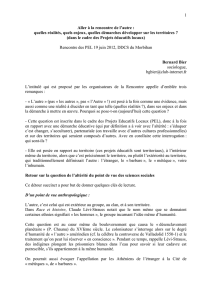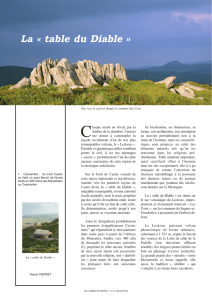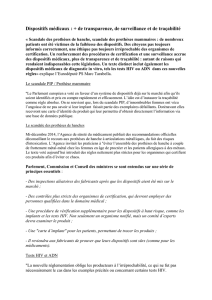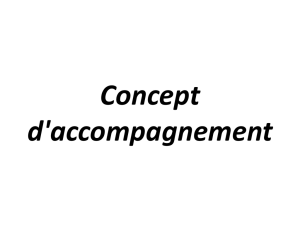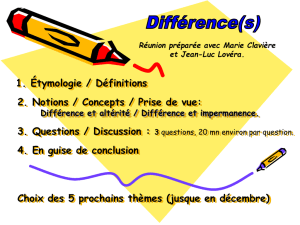François Besset, Il était une fois le mal. La fracture ontologique

1
François Besset,
Il était une fois le mal. La fracture ontologique
11/02/10
En tant que catholique pratiquant et professeur de philosophie, F. Besset s’est
confronté à la question du mal. Le mal est un enjeu considérable, une source de scandale. En
effet, pourquoi le mal, si Dieu existe ? Le problème du mal a été débattu par d’éminents
philosophes, aussi bien des penseurs de l’Antiquité que des philosophes de la modernité
comme Spinoza ou Leibniz. Il demeure néanmoins un mystère inépuisable qui touche à la foi.
La question du mal est une question qui hante. S’attaquer au problème du mal est pour F.
Besset une question de loyauté sur le plan intellectuel. Il s’agissait pour lui d’aborder la
question du mal en se gardant d’une lecture chrétienne. Il a néanmoins été amené à adopter
une perspective théologique. De fait, sur la question du mal, le discours philosophique est
impuissant. Il y a une déloyauté ou une inadaptation de la philosophie à l’égard du mal.
Le mal est-il un scandale pour le chrétien ? Plus exactement, c’est une question qui a
passé l’âge d’être un scandale puisque le mal est assumé dans le sacrifice du Christ.
L’homme n’est pas à la mesure de l’énigme du mal et du mystère de la rédemption qui
s’offre à lui. Ainsi, le mal n’est plus tout à fait un scandale. Par contre, pour un homme qui
fait usage de sa raison, le mal est le scandale absolu de la pensée, le moment où la pensée
trébuche pour ne plus se relever. Les philosophes ont tenté d’occulter ce problème.
La première partie du livre consiste en une approche du mal sur le plan ontologique.
Il s’agit d’une approche de l’être qui se veut rationnelle, intellectualisée. Le mal fait-il ou non
partie de l’être ? Est-il une réalité à part entière ? Pour Paul Claudel, le mal est ce qui ne
compose pas. Le mal est alors considéré comme ce qui ne peut entrer dans aucun système
d’intelligibilité ou de rationalité. Dès que le mal s’intègre dans un discours explicatif
signifiant, il ne fait plus scandale et ce n’est le mal à proprement parler. La tentative
philosophique pour aborder la question du mal aboutit finalement à la dissoudre. Sitôt que
j’essaie de signifier le mal, de lui donner une raison d’être, le mal n’est plus le mal puisqu’il a
sa place dans l’ordre du monde, dans la pensée de Dieu. Le mal ne peut pas être placé dans
la totalité du projet divin. Toutes les fois que la raison humaine tente de s’emparer du mal,
elle connaît un scandale aussi grand, sinon plus grand, que l’événement malheureux qui s’est
produit. Le mal rend la raison scandaleuse dans sa tentative pour l’expliquer et pour s’en
emparer. La question du mal est une déroute perpétuelle de la pensée.
L’émergence du mal est une déroute annoncée de la raison. Face à quelque chose
d’inattendu, la raison développe une rationalité qui s’efforce de faire face à cette surprise
afin de dissoudre ce que l’inattendu a d’anxiogène. Il y a ainsi une déficience de la raison
face au mal qui est comme une ombre d’anxiété jetée sur la pensée. Plus la raison cherche à
résoudre la question du mal, plus elle s’en angoisse et plus elle s’appauvrit.
Dans la perspective leibnizienne, le mal a sa place, comme une ombre qui rehausse la
lumière. Le mal revêt alors une connotation esthétisante. Leibniz inscrit ainsi le sens du mal
dans une perspective esthétique. Il opère une justification du mal en le présentant comme
ordonné au bien voulu par Dieu. Les choses rentrent ainsi dans l’ordre pour satisfaire la
raison. Il y a là un principe de raison suffisante qui affirme que tout conspire au meilleur. Le
mal est intégré dans cette perspective.

2
Dès lors qu’il n’y a pas d’objectivité du mal, il est facile de le décliner en de multiples
formes subjectives. Chez Spinoza, le mal est considéré comme une représentation de
l’imagination. Cette production de l’imagination résulte du fait que les hommes sont
insatisfaits de leur sort et passent leur temps à démoniser le réel et à insulter la nature
humaine. Cela nous conduit à nous tranquilliser sur la question du mal. Il y a aussi l’idée de
se convaincre que ce qui nous arrive de mal n’en est pas. Celui qui s’élève à un haut degré de
conscience échappe au mal. On en arrive à évacuer la question du mal.
Il y a ainsi beaucoup d’astuces rhétoriques de la raison pour se débarrasser du
problème du mal. Le mal est ramené à une réalité strictement subjective et temporelle.
Selon Spinoza, le tremblement de terre a sa place dans la nature. Les hommes ont
néanmoins une responsabilité dans la gestion des catastrophes naturelles dont il s’agit de
limiter l’impact. On peut aussi supposer que l’événement a un sens dans l’économie du
monde. Au-delà du mal physique se pose le problème du mal métaphysique. Le monde dans
lequel nous vivons est un monde imparfait. Dieu a voulu que nous vivions dans ce monde
afin d’aspirer au ciel. En effet, heureuse est la faute d’Adam qui nous a valu un tel
rédempteur !
Le véritable problème est finalement le mal moral. Comment un cœur, une âme, une
conscience peuvent délibérément vouloir le mal pour lui-même ? C’est le problème de la
damnation. Il n’y a pas de philosophie pour comprendre la damnation. Pour Leibniz, le
problème de la damnation ne se pose pas parce qu’on est tous damné. Le Christ ne viendra
d’ailleurs en sauver que quelques-uns. Leibniz joue à la fois sur un tableau théologien et sur
un tableau culturel. On rejoint ici la thèse calviniste originelle de la prédestination selon
laquelle Dieu a décidé dès le départ de qui sera sauvé et de qui sera damné. C’est l’idée
centrale du mouvement quiétiste. Il s’agit d’insister sur la nécessité de s’en remettre à la
grâce de Dieu. Cependant, on est dans le cadre d’une vision quasi fataliste du salut qui vient
nourrir un christianisme mortifère et morbide.
On voit finalement que le problème du mal est évacué dès lors qu’il est partout et
que tout le monde est perdu. Suivant la vision philosophique, le mal ne peut s’inscrire dans
aucune ontologie. Ou bien il s’ordonne à la raison mais s’il devient compréhensible, ce n’est
plus du mal. Ou alors il émarge à côté de l’être, dans le non-être ou l’imagination.
Puisque le mal n’est pas pensable dans une ontologie, comment y réfléchir ? Il
convient de ne plus rechercher une philosophie de l’être mais de penser le mal dans une
réflexion de la relation. On entre alors dans une nouvelle perspective selon laquelle le mal
caractérise la relation et on s’oriente ainsi vers une dimension théologique. L’intuition est la
suivante : deux instances x et y sont en relation. Il y a alors trois possibilités : ou bien ils sont
de concorde, ou bien ils sont indifférents l’un envers l’autre, ou bien ils sont en discorde. La
discorde est une relation qui va dans un seul sens et qui n’est pas honoré de l’autre. Dans
cette perspective, le mal est la figure d’une relation brisée. L’image la plus commune et la
plus forte pour illustrer cette idée est la relation amoureuse vécue dans un sens unique. On
est alors dans la souffrance. On peut transposer cette image à la relation de Dieu avec
l’humanité pécheresse.
Pour réfléchir sur le mal, nous pouvons nous appuyer sur le texte de Saint Anselme
De casu diaboli, c’est-à-dire De la chute du diable ou Du cas du diable. Cette réflexion est
orientée dans la direction d’une entité personnalisée. On n’est plus dans le cadre de
catégories qui peuvent faire l’objet d’une relativisation. On est passé à un mode majeur de
pensée du mal. A l’époque de la deuxième croisade au XIème siècle, Saint Anselme

3
développe l’idée que le mal se pense dans les termes de la relation. Il l’explique au moyen
d’un dialogue entre un maître et son disciple qui lui demande : si Dieu créateur est bon,
comme expliquer, non pas qu’il y ait du mal, mais qu’il y ait un diabolus, c’est-à-dire une
créature qui s’est détournée de Dieu alors même qu’elle a tout reçu de Dieu ? D’où vient le
diable dès lors qu’aucun mal ne l’a précédé ? Comment le diable a-t-il fait l’expérience du
mal ? D’où lui vient sa volonté perverse, alors que la volonté de chaque créature est
fondamentalement bonne ?
Lucifer, porteur de la lumière de Dieu, est avisé de la gloire de Dieu. Dans une
perspective chrétienne, on ne peut pas douter un instant qu’il s’agit d’une entité
personnalisée. L’enjeu est très fort. En effet, à ne tenir le mal que comme une image, on ne
rejoint plus le mystère de la relation de l’homme à Dieu. Le mal nous éveille au problème de
l’altérité. Le mal est le signe que Dieu n’a pas plaisanté avec l’altérité. En quoi est-il décisif de
faire du mal une entité personnalisée et non une entité générique ? Comment expliquer
l’émergence du mal à partir de rien qui ne le préfigure ?
Dieu est créateur de créatures qu’Il veut élever à sa dignité. Toutes les créatures sont
invitées à rejoindre la grandeur de Dieu. Il y a alors deux temps : celui où l’on donne la vie,
l’existence, l’être, et celui où l’on attend que le créé naisse à la relation, vienne à la relation,
s’empare de la relation ou la désire. La création de Dieu ne cesse d’appeler la créature à
dépasser son rang de créature et à s’élever à la relation avec le Créateur. La création divine
se double d’une dimension de pédagogie. L’image de l’enfant est à cet égard très éclairante.
En effet, les parents attendent que l’enfant s’empare de la relation qui a préfiguré sa venue
au monde, qu’il aime l’amour dont il est aimé. C’est là que la possibilité est donnée à la
créature de s’en détourner.
Prenons l’exemple d’une scène de catéchisme. Le catéchiste cherche à intéresser les
enfants, à les faire entrer dans la relation. Il choisit de leur donner un bonbon qui doit faire
le lien entre les enfants et la personne qui leur donne des bonbons. Les enfants sont ainsi
invités à partager l’intention du catéchiste qui est de les éveiller au message dont il est
porteur. Dans les Evangiles, le Christ commence par faire des miracles mais le miracle n’est
qu’un signe. Celui qui se laisse conduire par l’intention pédagogique et charitable reconnaît
que le miracle n’est pas important, bien plus c’est la promesse qui l’est. A l’inverse, la
réaction peut aussi être de redemander des bonbons. Le vrai sens du bien, c’est d’entrer
dans la relation avec celui qui donne.
Satan n’a pas pu haïr Dieu puisque la haine n’existait pas. Il y a cependant deux types
de mouvement d’amour : un mouvement spontané et un mouvement lent, où le merci est
donné à contre cœur. C’est dans ce décrochage que le mal commence à se produire, comme
une ardeur amoureuse qui s’est refusée au don, à la relation. Le mal devient alors une entité
en personne et non pas une généralité. Il est très important de porter un regard de loyauté
sur le mal en posant la question de son origine comme la question du mal en personne. Le
mal porté en personne est aussi le mal qui se double d’un pouvoir incroyable, celui de la
parole qui l’amène à nier ou mentir. On en arrive à blesser la relation en la faisant mentir. Le
mensonge apparaît en effet comme la possibilité en parole de détruire un monde et d’en
faire naître un autre. Satan s’est proposé un univers nouveau par la parole. Cela s’appelle se
mentir à soi-même. Le vertige naît lorsqu’on en arrive à se persuader de la vérité de son
mensonge.
Notre Dieu n’est pas un Dieu solitaire mais un Dieu qui veut l’altérité. La figure
trinitaire de Dieu l’annonce. Mais l’altérité se joue dans l’espace de la parole. Quand la

4
parole peut faire l’objet d’un mensonge, la relation est pervertie et l’agent du mal a sa place,
en regard de Dieu. Le personnage de Satan éveille deux modalités du discours humain : une
modalité logique, le logos, qui consiste à expliquer et à comprendre, et une modalité
narrative, le mythos, qui raconte une histoire. La question du mal confronte ces deux
modalités discursives de l’homme. De fait, on a toujours un discours double et il ne s’agit pas
de dissoudre l’un par l’autre. Le problème est que le discours de Satan cesse d’être explicatif
pour être narratif. Le mal nous renvoie ainsi à deux fonctions irréconciliables de la pensée. Il
nous permet de balayer l’étendue de ce dont notre pensée est capable dans ces deux
modalités discursives irréductibles. L’homme est à la fois rationalité et narration. Il faut
également bien voir que la dimension de l’histoire, du temps est une dimension humaine
fondamentale à travers laquelle Dieu nous parle.
L’évocation du mal dans la pensée chrétienne est la démonstration que Dieu ne
plaisante pas avec l’altérité, en lui permettant de se détourner de Lui. Le mal est une sorte
de démonstration par l’absurde que l’altérité est voulue par Dieu. Dieu nous a créé libre,
d’une liberté scellée dans une relation, relation que l’homme peut refuser. Dieu a pris le
risque d’être rejeté par l’homme. Il nous invite à une dignité qui n’est à vivre que dans la
relation qu’Il nous propose.
F. Besset considère qu’il ne peut pas penser le mal sans Dieu. Sinon, on développe
une vision relativisée qui donne lieu à toutes les postures possibles et imaginables. On en
arrive à une époque qui a nié Dieu et le mal mais qui apparaît comme le siècle des
génocides. Qu’adviendrait-il de l’homme s’il n’existait pas un diable pour en justifier ou en
comprendre le mal ? Si le diable est évacué, l’homme est responsabilisé par le mal, alors que
l’homme n’est que blessé par le mal à l’origine. La présence d’une origine satanique, même
symbolique, sauve l’homme de l’angoisse et de la névrose. L’homme n’est plus le juge de son
frère qui n’est pas l’auteur du mal qu’il commet. Certes, l’homme fait un choix mais sa
décision est toujours prise de façon plus ou moins passionnelle, jamais en pleine conscience.
Parler du mal sans parler de Dieu, c’est se heurter à une lecture relativisée du mal.
La réflexion de Hannah Arendt à propos du procès Eichmann met en évidence une
stratégie du mal, en opposition à la découverte de l’altérité qui est d’abord la découverte
d’un visage. Levinas affirme en effet que le visage de l’autre correspond à l’espace éthique
infini. La stratégie du mal, c’est alors de parvenir à un mode de réalisation anonyme,
organisationnel où l’homme n’est plus qu’un fonctionnaire déresponsabilisé qui fait ce qu’il
a à faire sans se préoccuper du reste. C’est faire preuve d’inconscience. En effet, on ne doit
obéissance que dans la mesure où cela ne heurte pas notre conscience. H. Arendt a mis en
avant l’idée de barbarie ordinaire. De fait, on a civilisé la barbarie, on l’a anonymée,
banalisée et ainsi presque autorisée. Eichmann s’est revendiqué d’un droit de conscience. En
tant que fonctionnaire nazi, il a affirmé n’avoir fait que son devoir. Il considère ne pas avoir
seulement assumé une fonction mais avoir précisément accompli son devoir jusqu’au bout,
en son âme et conscience. Il s’est en outre réclamé de l’impératif catégorique kantien selon
lequel il faut agir de telle sorte que la maxime de l’action valle comme loi universelle. Mais
dans le cas d’Eichmann, le principe de l’universalité de la maxime est incompatible avec la
Shoah.
On ne sort pas indemne à la fois du rejet de Dieu et de la relativisation du mal qui
nous blessent en profondeur. De fait, nous avons besoin de Dieu pour mettre un frein au

5
mal. Le fait de rejeter Dieu rend perméable et vulnérable au mal. L’expérience la plus
immédiate de cette idée est celle de l’offense subie et de la réponse en pardon à lui
opposer. On est tous blessé par le mal et on se blesse sans le savoir et souvent sans le
vouloir. Comment réagir au mal ? Par le devoir du pardon qui n’est possible qu’en regard de
Dieu, j’arrête la contagion du mal. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Nous
devons jouer une croyance sur un autre mode qui est celui de Dieu. Pour Hume, les vérités
dans le domaine de la pensée humaine font leurs preuves, c’est-à-dire qu’elles délivrent de
la névrose. La pratique du pardon libère de la névrose de l’offense. Sans Dieu, je ne peux pas
pardonner à mon frère qui m’a blessé.
Le mal ne vient pas de l’homme alors quel est le poids de sa responsabilité ?
L’homme est dans le temps. La responsabilité de l’ange est immédiate car il a tout vu et tout
voulu en un instant. Pour l’homme, le péché a occulté son intelligence. Il faut du temps à
l’homme pour cheminer dans son vouloir. Celui qui dit non et qui finit par faire ce qui est
juste fait la volonté de Dieu. Nous éprouvons des situations de révolte, de faiblesse, de
péché mais cela ne veut pas dire que nous en avons l’entière responsabilité. La vie nous
rattrape dans notre responsabilité. La responsabilité s’apprend d’elle-même, elle apprend à
se vouloir elle-même, à se déclarer dans le temps. Il y a plein de facteurs que nous ne
maîtrisons pas sur le moment. L’homme fait cette expérience unique de l’espérance, tandis
que les anges sont d’ores et déjà dans l’amour.
La question du péché originel pose le principe d’une humanité solidaire, dans le bien
comme dans le mal. Dieu a créé mais il n’a pas achevé sa Création. Il laisse l’humanité
l’achever. L’humanité est marquée par la solidarité entre les individus d’une même
génération et entre les générations. Le péché originel, c’est la remise en cause de la
confiance qui entoure la relation. L’homme est en lui-même porteur de ce doute à l’égard de
toute relation. Nous doutons de notre rapport à Dieu, à ceux qui nous entourent, à notre vie.
Nous doutons que notre existence soit associée à un bonheur que Dieu veut pour nous. Il
nous est finalement difficile de faire confiance à ce que nous ne voyons pas.
1
/
5
100%