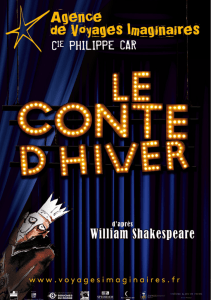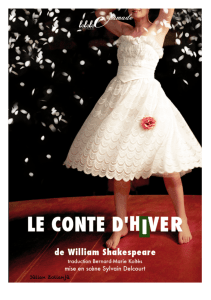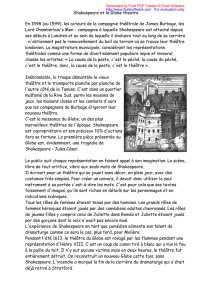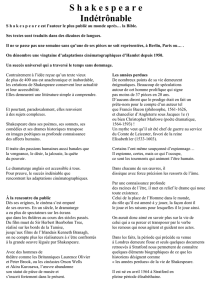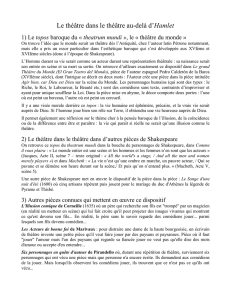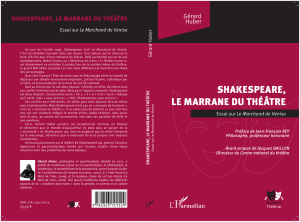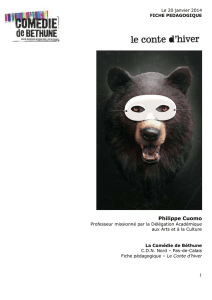Voir le dossier de présentation

1
Mise en scène Frédéric Polier
Théâtre du Grütli
Jan.-Fév. 2016
Dossier de présentation
Le Conte d’Hiver
William Shakespeare
Atelier Sphinx

2
Le Conte d’Hiver
Création janvier-février 2016 au Théâtre du Grütli
Auteur William Shakespeare
Metteur
en scène Frédéric Polier
Assistants Charlotte Chabbey
mise en scène Nicola Dotti
Dramaturge Lionel Chiuch
Avec Jean-Alexandre Blanchet
Cédric Dorier
Adrian Filip
François Florey
Camille Giacobino
Stella Giuliani
Barbara Tobola
David Marchetto
Pietro Musillo
Diego Todeschini
Julien Tsongas
Scénographe Pietro Musillo
Compositeur Philippe Koller
Maquilleur Arnaud Buchs
Costumière Florence Magni
Créateur son Graham Broomeld
Régisseur plateau Loïc Rivoalan
Sommaire
Le Conte d’Hiver dans la trajectoire d’Atelier Sphinx p.3
Une œuvre de maturité p.3
Synopsis p.4
Les artices shakespeariens p.6
Notes de mise en scène p.8
Perdita et Florizel p.19
La présence de la musique p.21
Scénographie p.22
Jalousie, j’écris ton nom ! p.24

3
Le Conte d’Hiver dans la trajectoire de l’Atelier Sphinx
En 1994 et 1995 je monte une version intégrale du Roi Lear, successivement à l’ancien palais des expo-
sitions (actuelle UNI Mail) puis au Théâtre Pitoe dans le cadre du Festival de la Bâtie. Plus tard en
2007 au théâtre de l’Orangerie ce furent Le Songe d’une Nuit d’Eté, Cymbeline et Falsta d’après Henry
IV 1ère et 2ème partie dans la célèbre « Tour Vagabonde ».
Entre temps je joue comme acteur et musicien dans près d’une dizaines de productions Shakespea-
riennes me permettant à travers diverses esthétiques et points de vue d’approfondir ma connaissance
du Barde de Stratford. Que ce soit dans la confrontation avec la langue serbo-croate dans le projet
sur Troïlus et Cressida mis en scène par Laurence Calame, La Nuit des Rois plus régional et truculent
mis en scène par Séverine Bujard et le superbe Comme il vous plaira mis en scène par Camille Giacobi-
no cette année 2015 au Théâtre du Grütli.
Après deux confrontations aux œuvres complexes et inspirées de l’auteur argentin Rafael Spregel-
burd (L’Entêtement en 2014 et La Paranoïa en 2015) Je souhaite avec ma compagnie-troupe réaliser
Le Conte d’Hiver à l’occasion du 400ème anniversaire de la mort de l’éternellement contemporain
William Shakespeare.
Frédéric Polier
Une œuvre de maturité
Le Conte d’Hiver appartient à la période nale de la carrière de Shakespeare,
suivant Cymbeline et précédant La Tempête et un Henri VIII généralement négligé.
Drame, comédie, chronique historique, la période peut paraître disparate. Une
grande unité relie toutefois ces quatre œuvres qui baignent dans une sorte de sé-
rénité lumineuse. La logique des intrigues, familiales, sentimentales ou politiques,
devrait conduire aux bains de sang spectaculaires sur lesquels se terminaient
Hamlet, Macbeth ou Henri VI. Shakespeare choisit pourtant de donner à
ses dernières œuvres une issue pacique. Pour ce faire, il ne procède pas
en homme de théâtre qui chercherait à assurer une nécessaire happy
end par le biais d’un hasard. Il opère par un changement complet du
climat moral et psychologique, comme si une certaine sagesse,
entrée en possession du théâtre, imposait aux héros une forme
de réconciliation. Ce Shakespeare vieillissant se détourne
des violences de la réalité quotidienne et se laisse glisser
dans la lumière tendre d’un jour radieux.

4
Acte 1
Léontes, roi de Sicile, et Polixènes, roi de Bohême, étaient les meilleurs amis. Ils s’aimaient ainsi
depuis l’âge le plus tendre. Un jour, bien des années après que Léontes se fut marié avec la belle reine
Hermione, Polixènes rend visite à son ami. Ils passent ensemble neuf mois délicieux, neuf mois du-
rant lesquels Hermione attend un heureux événement.
Vient le jour où le roi de Bohême doit retourner chez lui et veut faire au roi de Sicile ses adieux : mais
Léontes ne veut pas que son ami parte, il tient trop à lui, il l’aime comme un frère ; il le supplie de
rester. Polixènes ne peut accepter, il craint que, dans son pays, son absence ne se fasse sentir, il craint
d’y trouver à son retour un autre roi. L’ami insiste, l’autre refuse encore. Léontes, alors, se tourne vers
sa femme et lui demande d’essayer, elle, de retenir son ami. En peu de temps, Hermione y parvient.
Et Léontes dit: « A moi, il a dit non ... C’est étrange »
Soudain comme la foudre, un sentiment d’innie jalousie le transperce, change son regard sur l’ami
et sur sa femme : il est persuadé qu’Hermione est la maîtresse de Polixènes, que l’enfant qu’elle porte
est de lui. La cour va vivre des heures de cauchemar. Léontes ne peut plus entendre raison. À Ca-
millo, seigneur de la cour, il commande la mort de Polixènes : les deux fuient en Bohême la folie de
Léontes, qui ne connaît alors plus de limite.
Acte II
Léontes soustrait à l’inuence de la reine son jeune ls Mamilius, l’héritier au trône. Séparé de sa
mère, l’enfant tombe malade : Léontes est sûr que c’est à cause d’Hermione, qu’il jette au cachot. Elle
y met au monde une petite lle. Paulina, sa suivante, vient la présenter à Léontes, lui montrer comme
elle lui ressemble, lui faire voir qu’elle est bien de lui. Mais lui ne voit rien, ne veut rien voir, ordonne
que l’on brûle l’enfant ! Sur les supplications des courtisans, il charge Antigonus, l’époux de Paulina,
d’aller bien loin l’exposer en un lieu désert et la coner en nourrice au Destin.
Le roi fait à sa femme un procès public. Faible, exsangue, elle essaie de se défendre, ce qui le rend
plus fou encore. Quand tout à coup l’Oracle - car on avait consulté l’Oracle - fait entendre sa sen-
tence : « Hermione est innocente, sa lle est bien l’enfant de Léontes », il proclame que l’Oracle
ment.
Cependant on apprend que Mamilius est mort. Hermione s’eondre, on emporte son corps, sa
suivante vient annoncer que la Reine a cessé de vivre. Comme foudroyé à nouveau, Léontes prend
conscience de sa folie.
Actes III & IV
Le temps s’est écoulé : nous voici sur les côtes de Bohême où Antigonus, avant qu’un ours le dévore,
a laissé la lle de Léontes. Elle a maintenant seize ans, les terreurs de sa prime enfance lui ont ôté la
voix, elle ignore, comme tous, ses origines - on l’appelle Perdita. Perdita est aimée de Florizel, prince
de Bohême, et elle l’aime aussi, mais leur amour a pour cadre le monde de joyeux détrousseurs que
connaît Perdita, cour peu convenable pour un ls de roi ...
Et justement, Polixènes, inquiet, aidé d’un Camillo tout nostalgique de sa chère Sicile, cherche son
ls. Les deux hommes déguisés s’introduisent dans une cour de pickpockets en pleine eervescence :
c’est la fête, chacun apporte le fruit de son larcin en tribut pour le mariage de Perdita et Florizel.
Synopsis

5
Polixènes nit par se démasquer, montre une colère épouvantable, ordonne que Florizel rompe
immédiatement cette idylle avec une enfant trouvée, et appuie cette exigence de menaces terribles.
Resté seul avec les jeunes gens, Camillo leur conseille de se rendre en Sicile, où le roi devrait faire
bon accueil au ls du roi de Bohême - en Sicile où il rêve secrètement d’avoir à les suivre ...
Acte V
En Sicile, où Léontes pleure depuis seize ans ses fautes en résistant - aidé de l’inexible Paulina -
aux courtisans qui lui suggèrent de se refaire une descendance, on annonce l’arrivée du prince de
Bohême, accompagné de la lle d’un roi muet de Lybie. Troublé, Léontes accueille Perdita et Flori-
zel. mais un soldat de Bohême essoué accourt bientôt, demandant l’arrestation du prince. Le roi de
Bohême vient d’apparaître à son tour quand Paulina, à la chaîne qu’elle porte, reconnaît en Perdita la
lle de Léontes: Polixènes se repent de sa violence et appelle de ses vœux le mariage de Florizel avec
la lle du roi de Sicile.
Suivie de tous, Paulina conduit Perdita vers la statue qu’elle a fait sculpter par Giulio Romano à la
mémoire d’Hermione. Elle a tant l’apparence de la vie que sa vue frappe chacun de stupeur; Perdita
voudrait la toucher, Léontes l’embrasser, mais Paulina les retient: l’ œuvre n’est pas encore sèche.
Cependant elle déclare pouvoir faire bouger la statue ... À la demande de Léontes, elle ordonne à la
musique de l’éveiller. La statue se met en marche: c’est Hermione. Elle vit depuis seize ans, cachée
par Paulina, elle attendait de revoir sa lle, dont l’oracle laissait espérer qu’elle vivait. Léontes de-
mande pardon. Il donne à Paulina la main de Camillo puis lui demande de les emmener ailleurs, en
un lieu où ils puissent s’interroger et s’entendre sur les rôles qu’ils ont joués chacun durant ce grand
arc-de-temps.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%