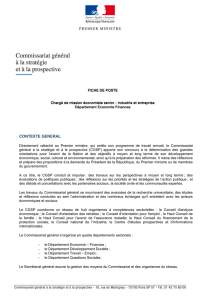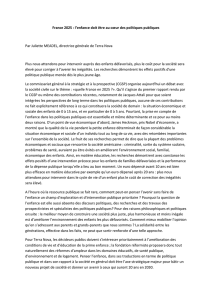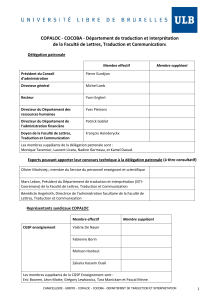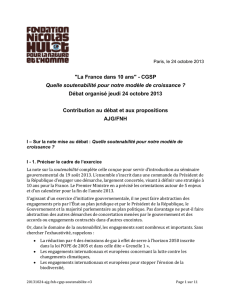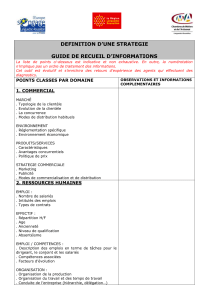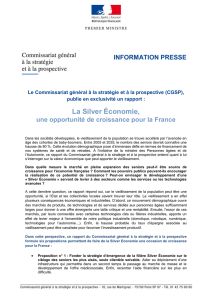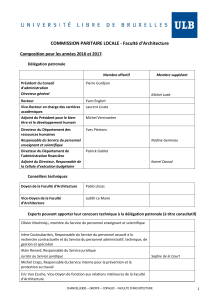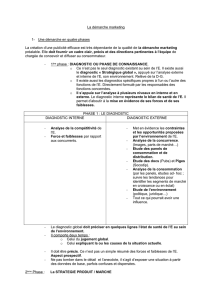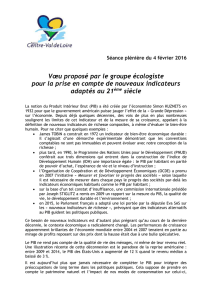Quelle France dans dix ans

QuelleFrancedansdixans?
Contributionauséminairegouvernemental
Paris,19août2013
16août2013


CGSP Août2013
www.strategie.gouv.fr3
Sommaire
Avant‐propos.......................................................................................................................5
Introduction.........................................................................................................................8
1.Certitudesetquestions....................................................................................................7
1.1.Lemondedansdixans...................................................................................................9
1.2.L’Europedansdixans...................................................................................................13
1.3.LaFrancedansdixans..................................................................................................15
2.Troischoixcollectifs.......................................................................................................21
2.1.Quelleinsertiondanslamondialisation?....................................................................21
2.2.Quelmodèlepourl’égalité?........................................................................................25
2.3.Quellevisionduprogrès?............................................................................................27
3.Élémentspourconstruireunestratégie.........................................................................31
3.1.Méthode.......................................................................................................................31
3.2.Coordonnées................................................................................................................33
Annexe
Décenniegagnanteoudécennieperdue:laSuèdeetleJapondanslesannées1990..........35


CGSP Août2013
www.strategie.gouv.fr5
Avant‐propos
Préparéeenjuillet‐août2013parungrouped’expertsduCGSP,cettenoteaétéconçuepourservir
d’introductionauséminairegouvernementaldu19août2013.Elleproposedesélémentsdeconstat
etdespistesderéflexionsurlesperspectivesàhorizondedixansetesquisseuneapprochepour
l’élaborationd’unestratégieàmoyenterme,maisneprétendnifaireuninventairedesquestions,ni
fixerlestermesd’uneréponse.Sonobjectifprincipalestd’ouvrirunediscussion.
OntprincipalementcontribuéàcetravailBlandineBarreau,MahdiBenJelloul,ThomasBrand,
NicolasCharles,DelphineChauffaut,QuentinDelpech,GéraldineDucos,HélèneGarner,Virginie
Gimbert,CléliaGodot,CamilleGuézennec,MohamedHarfi,NoémieHouard,CécileJolly,Frédéric
Lainé,RémiLallement,GuillaumeMalochet,DavidMarguerit,Jean‐PaulNicolaï,AudeRigard‐Cerison,
SarahSauneronetAudeTeillant.
Ledocumentaégalementbénéficiédesapportsdesparticipantsauséminairedu18juillet2013,et
enparticulierdeceuxd’AgnèsBénassy‐Quéré,PhilippeBouyoux,GilbertCette,SandrineDuchêne,
ÉtienneGernelle,ÉricHazan,SébastienJean,AlainQuinet,KarimTadjeddineetClaireWaysand.
Qu’ilsensoienttousremerciés.
JeanPisani‐Ferry
Commissairegénéralàlastratégieetàlaprospective
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%