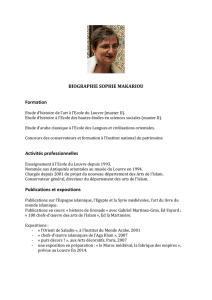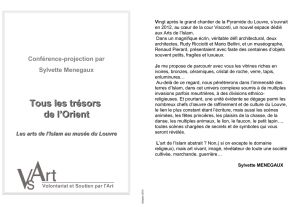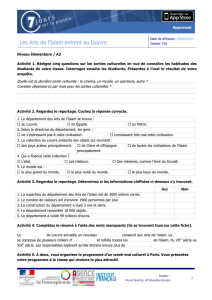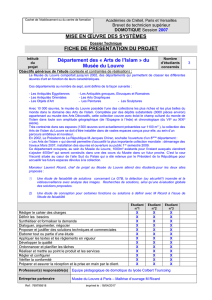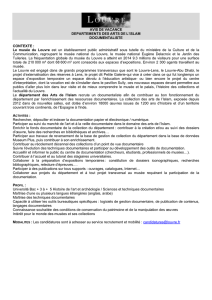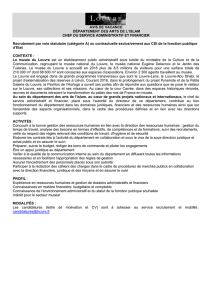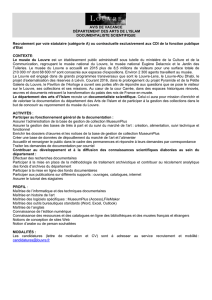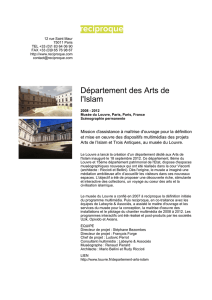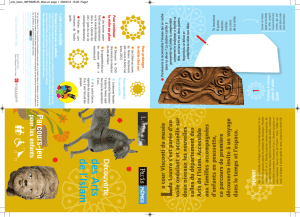L`ouverture des nouveaux espaces du

Dossier de presse
Inauguration
22 septembre 2012
Le département
des Arts de l’Islam
Ouverture des nouveaux espaces
Mini-site
http://www.louvre.fr/departement-arts-islam
Direction de la communication Contacts presse
Anne-Laure Béatrix Sophie Grange Marie-Cécile Lamoureux
Adel Ziane sophie.grange@louvre.fr marie-cecile.lamoureux@louvre.fr
Tél. 01 40 20 53 14 Tél. 01 40 20 53 22
Port. 06 72 54 74 53 Port. 06 88 42 52 62

2

3
Sommaire
Préface par Henri Loyrette, président-directeur du musée du Louvre Page 3
Introduction par Sophie Makariou, directeur du département des Arts de l’Islam Page 5
La collection des Arts de l’Islam Page 6
Histoire de la collection Page 7
Regard sur quelques œuvres Page 8
Le chantier des collections Page 13
La muséographie Page 16
Notice muséographique par Renaud Piérard, architecte muséographe Page 17
Panneaux didactiques Page 18
Repères chronologiques et géographiques Page 20
Un ambitieux projet de médiation culturelle Page 22
L’architecture Page 25
Le projet architectural Page 26
Notice architecturale par Mario Bellini et Rudy Ricciotti, architectes Page 28
Informations clés Page 29
Historique des grands chantiers du Louvre Page 31
Autour des collections Page 32
Une saison des arts de l’Islam au Louvre : septembre 2012 - juin 2013 Page 33
Publications Page 39
Les films du Louvre Page 41
Informations pratiques Page 44

4
Préface
Henri Loyrette, président-directeur du musée du Louvre
Vingt ans après le grand chantier de la pyramide, la création du nouveau département des Arts de l’Islam au
sein du musée du Louvre représente une étape décisive dans l’histoire architecturale du palais et du musée, un
palais en constant devenir et qui porte dans ses gènes, depuis huit siècles, la volonté d’aller de l’avant sans
cesse.
Le projet de fonder ce huitième département patrimonial est né d’une constatation que j’avais faite dès mon
arrivée au Louvre, en 2001 : notre musée possédait l’une des plus belles collections au monde dans le domaine
des arts de l’Islam, mais un dixième seulement des œuvres étaient présentées et, faute de place, nous ne
pouvions ni remonter les grands éléments d’architecture, ni déployer notre exceptionnelle collection de tapis. Il
était indispensable qu’une civilisation si importante, si intimement liée à l’ensemble des domaines couverts par
le Louvre, touchant tant de siècles et de pays, ait enfin droit à des espaces dignes en qualité et en surface.
C’est en 2003 qu’a germé cette belle idée, ce rêve aujourd’hui devenu réalité. Ce rêve, il prend ses racines dans
la vocation même du Louvre, conçu dès son origine, au XVIIIe siècle, comme un musée universel, un lieu où, par
le truchement des œuvres d’art, les époques et les civilisations dialoguent entre elles. Après le Grand Louvre
cher à François Mitterrand, ce chantier est rapidement devenu un projet présidentiel voulu et soutenu par les
différents chefs de l’État qui lui ont succédé. Dès le 1er août 2003, le président de la République Jacques Chirac
a annoncé la création de ce huitième département patrimonial du Louvre. Le 16 juillet 2008, lors de la pose de
la première pierre, le président Nicolas Sarkozy a souligné l’importance de ce projet dans le cadre du dialogue
entre les cultures et les peuples. Et c’est sous les auspices du président François Hollande que ce grand projet, à
la fois artistique et politique dans le sens le plus noble du terme, voit le jour.
Les œuvres exposées dans ces nouveaux espaces réunissent deux collections : celle issue du Louvre, à laquelle
s’ajoute celle, substantielle, de la collection du musée des Arts décoratifs. Ces deux collections réunies couvrent
avec éclat l’ensemble du champ culturel de la civilisation islamique, de l’Espagne à l’Inde, et dans toute son
envergure chronologique, du VIIe au XIXe siècle.
Une autre caractéristique de ce projet touche à son architecture. Dès le départ, notre parti pris a été de ne pas
remodeler des salles existantes, mais de construire de nouveaux espaces. Et de le faire à la fois dans l’esprit des
lieux et en nous efforçant de capter ce qui se faisait de plus beau et de plus novateur dans le domaine de
l’architecture, ce que le palais du Louvre s’est toujours attaché à faire, à chaque époque, tout au long de son
histoire presque millénaire.
La création et l’intégration de ces nouveaux espaces ont constitué un véritable défi architectural et même
technique, dans cette cour Visconti, lieu chargé d’histoire, situé au cœur même du palais du Louvre. Pour
répondre à ce défi, les architectes Mario Bellini et Rudy Ricciotti ont su trouver un subtil et élégant équilibre
entre le classicisme de la cour du XVIIIe siècle et l’évocation des arts de l’Islam à travers une verrière ondulante,
remarquablement novatrice, alliant le verre et le métal, qui prolonge l’aplomb des façades existantes de la cour
Visconti.
Ce chantier a été également l’occasion d’ajouter un nouveau chapitre au projet du Grand Louvre en
aménageant, au voisinage immédiat des Arts de l’Islam, les salles consacrées à l’Orient méditerranéen à

5
l’époque romaine. Ces œuvres de l’Antiquité tardive proviennent du bassin oriental de la Méditerranée à partir
du IIIe siècle avant J.-C., de l’Égypte romaine et copte, de Phénicie et de Palestine. Ainsi, le nouveau
département des Arts de l’Islam et les salles alentour s’inscrivent désormais dans des ensembles et des espaces
architecturaux continus, cohérents et harmonieux.
Revêtant une dimension tout à la fois architecturale, culturelle et artistique, cette immense réalisation vient
rappeler avec éclat la mission qui incombe au Louvre depuis son érection en musée universel, au cœur de la
Révolution française ; une vocation sans cesse renouvelée et mise au goût du jour pour en faire un musée ouvert
sur le monde, un « musée-monde » pour reprendre l’heureuse expression de J-M. G. Le Clézio. Le Louvre est
aujourd’hui présent sur tous les continents à travers des expositions, des chantiers de fouilles, des expertises
scientifiques et muséographiques. Et ce nouveau département des Arts de l’Islam s’impose comme un espace et
un lieu à la fois témoin et carrefour d’une compréhension mutuelle ; une passerelle entre Orient et Occident, qui
parleront de leurs différences, mais aussi de leur histoire commune, de leurs interpénétrations mutuelles tout au
long des siècles.
Le choix même du nom que nous avons attribué à ces nouveaux espaces – département des Arts de l’Islam –
s’inscrit dans une démarche que le Louvre assume pleinement. Il s’agit en effet, pour nous, de présenter la face
lumineuse d’une civilisation qui engloba en son sein une humanité infiniment variée et riche. À travers ce geste
artistique, nous avons souhaité mettre en avant une approche large et inclusive qui rassemble des mondes très
divers (andalou, mamlouk, ottoman, persan…).
Ce grand dessein n’aurait pu se réaliser sans l’appui de généreux donateurs et de mécènes venus d’horizons très
divers : Son Altesse royale le prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, qui a été le premier à nous
apporter son soutien ; Sa Majesté le roi du Maroc ; l’État du Koweït ; le Sultanat d’Oman et la République
d’Azerbaïdjan. De grandes entreprises françaises, la Fondation Total et Lafarge, ont souhaité soutenir
financièrement la construction de ces nouveaux espaces. Des donations individuelles ou d’entreprises ont
également contribué au financement du projet : Frédéric Jousset et la Fondation Orange.
Je rendrai enfin un hommage appuyé à toutes celles et tous ceux qui, par leur travail, leurs recherches ou leur
soutien actif, ont su créer les conditions rendant cette réalisation possible. Qu’il s’agisse du travail pionnier de
Marthe Bernus-Taylor, encouragée par mon prédécesseur Michel Laclotte, de l’appui précieux du musée des
Arts décoratifs ou encore, tout au long de ce grand chantier, de l’implication remarquable des équipes du
nouveau département des Arts de l’Islam, sous l’impulsion et la direction de Sophie Makariou.
En visitant le Louvre, Charles Péguy éprouvait un double sentiment : la promotion de l’être et la perception du
long et visible cheminement de l’humanité. Je forme le vœu que les publics éprouvent des sentiments
semblables en découvrant ces nouveaux espaces, ce joyau architectural et les trésors qu’il recèle.
Texte extrait de Les arts de l’Islam au musée du Louvre, sous la direction de Sophie Makariou, coéd. musée du Louvre
éditions/Hazan.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
1
/
47
100%