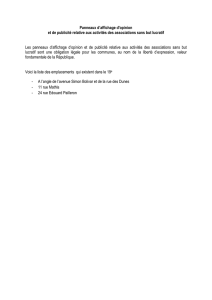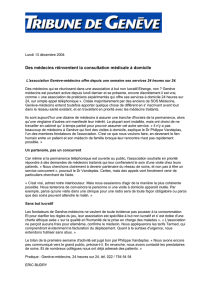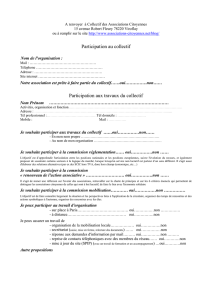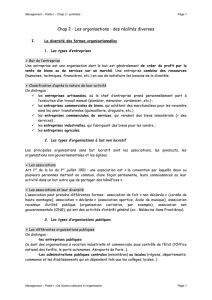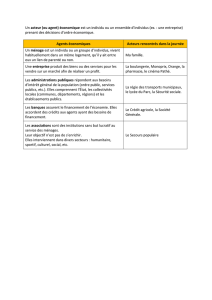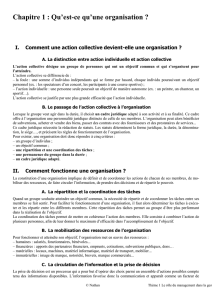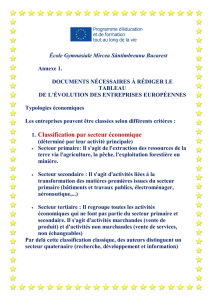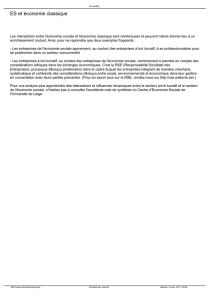Voir ce que personne ne voit – jusqu`à ce que tous le voient .

la prenaient très au sérieux, la théorie du management.
Comme la jurisprudence, elle n’est pas une science, pas
une « théorie ». Le management, c’est de l’art, du grand
art, et il lui faut, comme à l’art de gouverner et de soigner,
de la science (les découvertes les plus récentes), et du bon
sens et des méthodes de diagnostic juste et de thérapie
adaptée. « On perceptiveness » in « decision making » di-
sait-il, un bon diagnostiqueur voit ce que personne d’autre
ne voit. (Etre un bon analyste, comme son père, ne lui
suffisait pas; sensible comme sa mère, il était, déjà dans son
enfance, capable de repérer intuitivement parmi les invités
de ses parents les couples qui venaient de se disputer.)
Toute sa vie, il fut un penseur incroyablement lucide parce
qu’il ne pensait pas uniquement mais était capable de voir
ce que personne d’autre ne voyait, ou bien ce que chacun
voyait uniquement lorsque tous voyaient, ce que personne
ne voulait croire d’abord. Mais rien n’est plus difficile que
de voir les choses telles qu’elles sont réellement « seeing
things as they really are » au lieu de prendre pour vrai ce
qui est commode.
La clairvoyance est dégradée en banalité quand au bout
de quelques décennies elle cristallise en évidence : le rôle
central des managers et travailleurs de la connaissance,
du marketing et de l’innovation, du passage de l’économie
des marchandises à l’économie du savoir, le rôle de la
mission et de la stratégie pour le business, du management
par objectifs au lieu de la gestion autoritaire, la place du
secteur à but non lucratif, le pouvoir financier croissant des
fonds de pension et des investisseurs institutionnels pour
une société post-capitaliste, l’extrême importance de la
motivation des employés pour la réussite d’une entreprise,
il a tout vu à l’avance, tout ce qui nous paraît évident et
banal aujourd’hui et tout ce qui nous a été servi et resservi
sur le management, en deuxième et troisième main.
Donc : “ The one management thinker every educated
person should read“ (economist), tous les autres livres
étant superflus.
Il vit que le véritable leadership est un don décisif et très
très rare. Que les faiseurs, les managers (et pas les gros
propriétaires) décident en fin de compte du devenir de
sociétés entières. Que les bons managers sont extrême-
ment rares. Que la concurrence pour les meilleures têtes
en est d’autant plus acerbe et le prix des faiseurs d’autant
plus haut. Mais les conséquences de cette loi élémentaire
de l’offre et de la demande et la pression des marchés
boursiers, la recherche du profit trop rapide et les revenus
démesurés des managers, allaient tout simplement à
l’encontre de son bon sens autant que de son bon goût.
Il avait confié à Erhard Friedberg (2), professeur à Science
Po et directeur du Centre de Sociologie des Organisa-
tions à Paris, dans le cadre d’une entrevue de sept heures,
entre autres, qu’il trouvait tout simplement injustifiable
que le revenu du PDG d’une entreprise puisse dépasser
quinze fois le revenu de ses salariés les plus mal payés, ou
que les traders gagnent plus que les investisseurs. Pour ces
idées, et pour son engagement en faveur du secteur à but
non lucratif, le vieil homme fin, savant, le grand-bourgeois
ordo-libéral pourrait aujourd’hui être taxé par certains
petits snobs de « socialisme » (il en fut brièvement proche
dans sa jeunesse) ou de « communisme », dans le meilleur
des cas de « romantisme social » et d’« utopisme ». Mais il
était suffisamment réaliste pour voir ce que les néolibéraux
anglo-saxons sont incapables de voir, que « le spectacle
sordide » des salaires excessifs des multinationales et des
stars risque de conduire « à une explosion d’amertume et
de mépris » à la prochaine grande crise économique.
L’aventure hitlérienne en fit un sceptique doutant de la
capacité du marché à réguler tout autant que du
« big government » (capable uniquement de bien faire la
guerre et de dévaluer). A l’ère des organisations, seul un
bon management économique et politique peut sauver
l’humanité de la barbarie. La société ne peut jamais être
« parfaite, mais supportable dans le meilleur des cas ». Le
management est « l’organe qui définit toutes les institu-
tions modernes », pas seulement les entreprises mais aussi
le secteur public et les organismes à but non lucratif. C’est
pour cette raison qu’il a inspiré aussi bien des privatiseurs
néolibéraux que des adeptes, plutôt de gauche, du
« re-inventing government » que des représentants du
secteur à but non lucratif.
Pour lui, le « coma intellectuel de la gauche européenne »
à l’heure actuelle était « effrayant », et Tony Blair par
exemple, dans son « incompétence si digne », « le plus
ennuyeux » de tous, pas seulement par rapport aux grands
penseurs de la social-démocratie d’il y a 100 ans.
Il avait compris qu’un Effective Executive servait les autres
et non lui-même. Que l’efficacité était la réponse à la ques-
tion how can I best serve. Que ce ne sont ni les chaussures
sur mesure ni les airs supérieurs de Herrenmensch qui
font les leaders, mais leur aptitude à satisfaire des besoins
non identifiés. Que seul le management est capable de
transformer une « foule en organisation » et des « efforts
humains en performance économique ». Mais que les
Voir ce que personne ne voit –
jusqu’à ce que tous le voient
Celui qui en Autriche était peut-être le plus inconnu des
émigrés célèbres, respectés dans le monde entier, et défini-
tivement perdus pour la patrie, le plus important penseur
du management du XXe siècle est décédé. Mais contrai-
rement à Freud, Wittgenstein ou Hayek, les intellectuels
peuvent se permettre d’avouer qu’ils ne le connaissent pas.
Le père de nombreux principes intemporels de la gestion
moderne de l’entreprise, admiré par Churchill autant que
par Bill Gates. Un « théoricien » best-seller, lu par 35 mil-
lions de personnes dans toutes les langues, suffisamment
suspect pour être ignoré : sauf erreur de ma part, pas de
plaque commémorative ni de titre de docteur honoris
causa (1), pas de bourse, pas de poste de professeur
honoraire, pas de prix, de timbre commémoratif, pas de
nom de place ni de rue, pas de fondation ni d’académie.
Pourquoi, alors que le monde entier l’a déjà fait, sa ville na-
tale devrait-elle rendre hommage à cet «austro-hongrois»
qui garda toute sa vie un accent viennois prononcé ?
Intellectuel juif, issu d’une famille de la grande bourgeoisie,
son père était un haut fonctionnaire du gouvernement
austro-hongrois qui avait contribué à fonder en 1899
l’Académie d’Exportation impériale et royale qui devien-
drait plus tard l’Académie de Commerce international,
puis l’Université d’Economie de Vienne, Peter Ferdinand
Drucker avait gardé avec Vienne une relation plutôt
amicale, détendue, sans haine ni colère, mais sans nostalgie
non plus, ni rancœur pour des invitations au retour jamais
reçues. Peut-être parce que c’est d’Allemagne, où il avait
fait ses études et travaillait, qu’il avait été chassé et non de
son pays natal ?
Il créa une nouvelle discipline, une discipline à la fois
peu précise et difficile à réfuter donc peu respectée des
scientifiques, mais très importante, car les gens les plus
importants, ceux qu’elle-même avait rendu importants,
1) Absurde évidemment, comme ce titre honorifique de docteur proposé
par l’Université d’Economie de Vienne, qu’il avait au départ accueilli
favorablement, la seule distinction depuis 1945, tombé à l’eau pour des
motifs politiques en février 2000 : « I greatly appreciate your flattering
intention... to bestow on me the honorary doctorate... But, to my regret, I
cannot accept this honor... To do so at the present time would clearly be
understood as a POLITICAL manifesto on my part – especially in view of
the publicity which, as your Fax points out, I received in the Austrian press
on the occasion of my recent 90th birthday. I appreciate your good inten-
tions – and am deeply grateful. But I have to say NO » écrit-il au recteur,
M. Hansen, en février 2000. Maintenant, il est définitivement trop tard pour
cette distinction. 2) DVD-Rom « Decision-Making » (www.banlieues-mediacom)
.

2009
entreprises sont aussi une sorte de communauté et pas
seulement des machines à production et à profit. Qu’on ne
peut pas renoncer à faire du profit mais que la recherche
des bénéfices ne suffit pas : customers over profits. Que le
profit est important pour les actionnaires, mais aussi pour
le plein emploi. Qu’une entreprise ne peut être durable-
ment profitable que si les employés sont traités comme
des ressources précieuses. Que l’empowerment exige la
décentralisation du pouvoir de décision, le contrôle des
ouvriers sur les processus de production, et des salaires
garantis. Que les entreprises et les marchés sont des insti-
tutions avec des humains, non de simples calculs de coûts.
Que les personnes et les ouvriers d’une entreprise sont sa
vraie richesse, et non des « frais à deux jambes ». Qu’il est
important de fixer des objectifs autant que d’accorder une
certaine autonomie aux travailleurs. Qu’un bon manager
rend efficace les points forts de ses collaborateurs et
fait oublier leurs points faibles. Que le secteur à but non
lucratif a beaucoup à apprendre du secteur à but lucratif,
et inversement, que les entreprises peuvent apprendre des
églises et des organisations caritatives.
Difficile à rattacher à une école, il était probablement
plus proche de Spann ou Schumpeter que de Hayek ou
l’école autrichienne d’économie. Quelqu’un qui intégrait
à son analyse politique et économique de l’entreprise
des éléments de théorie politique, de droit international,
d’économie politique, de philosophie. Lui qui avait une
conscience et une culture historique développées situait
par exemple la globalisation après la révolution de 1848 et
pas seulement aujourd’hui. Ses prognostiques se réali-
saient presque toujours, parfois des décennies plus tard,
contrairement à ceux des spécialistes de tendances ou
autres « futurologues » à la mode. C’est ainsi qu’il a vu
longtemps à l’avance l’inflation des années 70 tout comme
la concurrence japonaise alors que personne encore n’y
prêtait garde. Il a vu venir le déclin des syndicats alors que
leur pouvoir atteignait son apogée après-guerre. Et il a su
bien avant IBM que les ordinateurs allaient révolutionner
le monde des affaires. C’est pour cette raison que même
ses livres les plus anciens gardent souvent encore tout leur
intérêt.
Il était capable d’expliquer clairement et simplement
des problématiques complexes sans jamais simplifier. Il
s’intéressait aux grandes questions de l’humanité mais
pas aux gadgets techniques. Il n’était pas un théoricien de
modèle ou de système dans sa tour d’ivoire, pas un num-
ber cruncher, mais un observateur lucide et un analyticien
profond. On peut dire qu’il a « inventé » le métier du
management. Les livres sur le management sont devenus
en vogue et ce vieil européen un peu démodé est devenu
une icône. Il était extrêmement cultivé. Certains petits
clones de sa branche le snobaient parce qu’il n’était pas
familier des statistiques à variables multiples mais de Jane
Austen, de peinture japonaise et d’histoire du dével-
oppement des villes au haut Moyen-Age par exemple. Il
était modeste, gentil, nullement affecté. Son patrimoine
considérable est allé à une fondation pour les organisations
à but non lucratif. Son objectif était de voir apprendre et
grandir des humains, de voir prospérer des entreprises,
de voir le travail devenir plus attrayant. Il connut aussi de
spectaculaires défaites : la semaine de son décès, le plus
gros fabriquant automobile du monde, dont l’analyse
l’avait rendu célèbre (et qui n’avait pas suivi ses conseils),
se retrouvait au bord de la ruine. Il fut auprès de General
Electric aussi couronné de réussite que sans succès avec
General Motors.
Il était clairvoyant, sage, amusant et plein d’humour dès sa
jeunesse. Il était multiple dans ses études comme dans ses
métiers, comme journaliste, banquier, professeur, auteur,
conférencier ou conseiller d’entreprise. Toujours actif :
« One either meets or one works ». A l’âge où d’autres
prennent leur retraite, il changea d’université, quittant
New-York pour la Californie et commençant en parallèle
une nouvelle carrière comme éditorialiste pour le Wall
Street Journal. A 88 ans, le magazine Forbes Magazin lui
dédia sa une sous le titre : „Still the Youngest Mind“. Il était
incomparable, une « force without peer » : sur 39 livres
(traduits en 30 langues), le père de la théorie du manage-
ment en a écrit seulement 15 sur le management et 16
sur l’économie et la politique, deux romans et une espèce
d’autobiographie formidable (Adventures of a Bystander,
en français « Témoin du 20e siècle »). L’« écologiste
social » Peter F. Drucker, né à Vienne, est mort il y a
quelques jours, peu avant son 96e anniversaire. Nous
pouvons donc désormais l’oublier définitivement, lui et le
« druckerisme ». Ou bien…
Bernd Marin Novembre 2005
1
/
2
100%