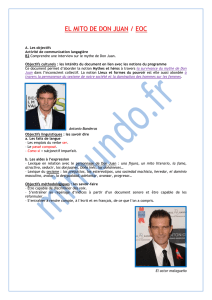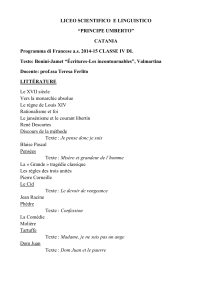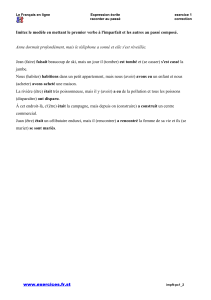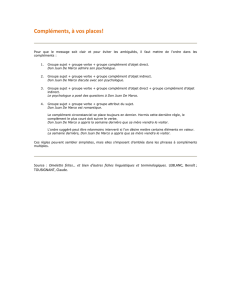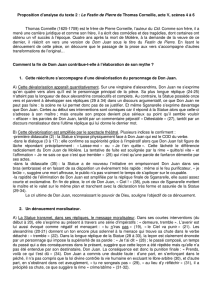studies and articles - STUDIA UNIVERSITATIS Babes-Bolyai


YEAR (LVII) 2012
MONTH OCTOBER
ISSUE 2
S T U D I A
UNIVERSITATIS BABEŞ–BOLYAI
DRAMATICA
THEATRE, FILM, MEDIA
2
Desktop Editing Office: 51st B.P. Hasdeu, Cluj-Napoca, Romania, Phone + 40 264-40.53.52
CONTENT / SOMMAIRE
Thematic issue
REWRITING, REVISITING AND ADAPTATION
OF DRAMATIC TEXTS
STUDIES AND ARTICLES
ARMELLE HESSE-WEBER, L’adaptation théâtrale d’hier à aujourd’hui, pour une
approche historique / Theatrical Adaptation of Yesterday to Today, for a
Historical Approach .......................................................................................... 3
IOAN POP-CURŞEU, Enjeux esthétiques des réécritures pour la scène au XIXe
siècle : autour du Don Juan de Baudelaire / Aesthetical Stakes of Scenic
Rewriting in 19th Century: Around Baudelaire’s Don Juan .............................. 23
ANDRÁS VISKY, Who speaks? Kaddish for an Unborn Child as Dramatic Form...... 45
DANA MONAH, Le théâtre dans le théâtre comme réécriture : les spectacles des
morts-vivants / The Play-within-the-play as Rewriting: the Theatre of the
Living Dead ..................................................................................................... 59

ŞTEFANA POP-CURŞEU, Réécriture, interprétation et distorsion monstrueuse de
l’homme, personnage du théâtre postmoderne / Rewriting, Interpretation
and Monstrous Distortion of the Human Being, Character of the Post-modern
Theatre ........................................................................................................... 75
DELPHINE KLEIN, Polarité et métamorphoses dans FaustIn and out d’Elfriede
Jelinek / Polarity and Metamorphosis in Elfriede Jelinek’s FaustIn and out.... 85
DESPOINA NIKIFORAKI, Le personnage de Phèdre chez D.-G. Gabily. La matrice
des amazones et le tournage d’Apres-Phèdre / The Character of Phaedra in
D.-G. Gabily. The Matrix of the Amazons and the Movie-shooting of Post-
Phaedra ........................................................................................................ 101
DRAGOŞ CARASEVICI, Revisiting the Classics. Friedrich Dürrenmatt as Stage
Director in Zürich.......................................................................................... 117
ANDREI SIMUŢ, The Last Day on Earth from Feu follet to Oslo, August 31st ........ 125
MATTIA SCARPULLA, Une dramaturgie des traces. L’adaptation en danse contempo-
raine / A Traces’ Dramaturgy. The Process of Adaptation in Contemporary
Dance............................................................................................................ 135
CREATION, INTERVIEWS, MISCELLANEA
Conference PATRICE PAVIS, Sur le théâtre postdramatique/ On Postdramatic
Theatre ......................................................................................................... 151
PERFORMANCE, FILM AND BOOK REVIEWS
LAURA PAVEL, Performance Review: Staging Ionesco Beyond the Absurd – the
Ambiguous Game of Innocence.................................................................... 165
ALEXANDRA DIMA, Performance Review: A Journey into the Human Mind ....... 171
IOAN POP-CURŞEU, Book Review: Une première « histoire » du TIFF/ One of the
First Histories of the TIFF .............................................................................. 175

STUDIA UBB DRAMATICA, LVII, 2, 2012, pp. 3 - 22
(RECOMMENDED CITATION)
STUDIES AND ARTICLES
L’ADAPTATION THÉÂTRALE D’HIER À AUJOURD’HUI,
POUR UNE APPROCHE HISTORIQUE
ARMELLE HESSE-WEBER*
ABSTRACT. Theatrical Adaptation of Yesterday to Today, for a Historical Approach.
Adaptation is an ancient phenomenon which is a cultural practice of a wide variety
and implementing more complex operations than the recent theoretical studies
(semiotic, psycho-Linguistics, genetic...) were used to highlight. Here, we would like
to adopt a historical perspective to understand the phenomenon of the theatrical
adaptation today through its evolution. We will show that its definition, its form, its
production issues and the motivation of its authors are variable parameters based
on the historical, social and cultural context. Long in competition with the pure
imitation, adaptation has gradually taken a distance from its source text encouraging
the creativity of the author. It has thus helped the 19th century renew theatre and
contributed to question the rules and push the boundaries of the genre. Questioning
the creative act by giving the Director the hand, it has long been held responsible for
the crisis of contemporary theatre and the author. Which takes nothing away from
its nowadays vitality.
Keywords: adaptation practices; adaptation for theater; rewriting; genres; historical.
L’adaptation correspond à une réalité culturelle d’une grande diversité
dont la complexité, l’ampleur des domaines sémiotiques d’application ainsi que le
nombre des productions n’ont pas fini d’épuiser la recherche. En effet, la pratique
de l’adaptation est à l’œuvre non seulement dans le champ de la littérature, mais
dans tous les arts et au-delà, dans de nombreux champs discursifs, qu’ils soient
fictionnels ou non. Son développement s’explique par l’apparition de nouveaux arts
narratifs (cinéma, BD, télévision, ...), souvent avides d’histoires « toutes prêtes »
* Université Paul Verlaine, Metz (France), Centre de Recherche sur les Médiations (CREM),
E-mail address : [email protected]

ARMELLE HESSE-WEBER
4
ainsi que par les canaux de diffusion modernes qui ont permis la multiplication en
grand nombre des textes et des images et du même coup élargi le champ de la
réception des œuvres, remettant en cause, comme l’écrivait Walter Benjamin, la
notion d’unicité1.
L’intérêt pour l’adaptation s’explique aussi par le fait que depuis les années
1960, le principe selon lequel l’essence de l’œuvre n’est pas à chercher dans son
originalité a gagné en importance. Qu’une œuvre soit répétition et recyclage de
matière ancienne et que l’écriture ne soit jamais qu’une réécriture ont fait l’objet
d’un travail de théorisation que l’on peut indexer par la notion d’intertextualité,
telle qu’elle a été définie par Julia Kristeva à la suite de Mikhaïl Bakhtine, puis
largement répandue dans le champ des études textuelles. C’est ainsi que Roland
Barthes peut écrire :
Nous savons maintenant qu’un texte n’est pas fait d’une ligne de mots, dégageant
un sens unique, en quelque sorte théologique (qui serait le « message » de l’Auteur-
Dieu), mais un espace à dimensions multiples, où se marient et se contestent des
écritures variées, dont aucune n’est originelle : le texte est un tissu de citations, issues
des mille foyers de la culture. Pareil à Bouvard et Pécuchet, ces éternels copistes, à la
fois sublimes et comiques, et dont le profond ridicule désigne précisément la vérité de
l’écriture, l’écrivain ne peut qu’imiter un geste toujours antérieur, jamais originel ; son
seul pouvoir est de mêler les écritures, de les contrarier les unes par les autres, de
façon à ne jamais prendre appui sur l’une d’elles ; voudrait-il s’exprimer, du moins
devrait-il savoir que la « chose » intérieure qu’il a la prétention de « traduire », n’est
elle-même qu’un dictionnaire tout composé, dont les mots ne peuvent s’expliquer
qu’à travers d’autres mots, et ceci indéfiniment […]2.
Dès lors, la théorie s’est intéressée à toutes les formes de reprises et d’imitation
et c’est dans ce contexte que l’adaptation a été décrite en tant que pratique
d’écriture spécifique (Genette ou Farcy) ou a fait l’objet de nombreux articles,
qu’ils portent sur une époque précise (les adaptations théâtrales au XIXe siècle, par
exemple)3 ou s’attachent à un auteur particulier (Zola, Duras, Ionesco…).
La perspective étant de tenter de définir les enjeux de l’adaptation aujourd’hui,
nous avons choisi d’adopter un point de vue essentiellement historique afin de poser
de manière sommaire les jalons de son évolution, de ses origines à la période moderne,
1 Nous renvoyons à l’ouvrage de Walter Benjamin (1936) L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité
technique, Gallimard, Paris, 2000. Il décrit l’influence des progrès techniques sur la diffusion des textes,
qui se traduit par la perte de l’aura des œuvres soumises à la reproductibilité technique et devenant des
objets commerciaux.
2 BARTHES Roland, « La mort de l’auteur », Essais critiques IV, Le bruissement de la langue, Seuil, Paris, 1984,
p. 65.
3 Le roman au théâtre. Les adaptations théâtrales au XIXe siècle, sous la direction d’Anne-Simone Dufief et
Jean-Louis Cabanès, RITM 33, Université Paris X, 2005.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
1
/
178
100%