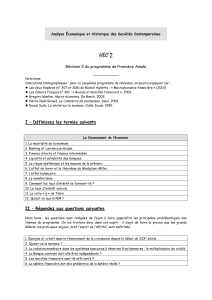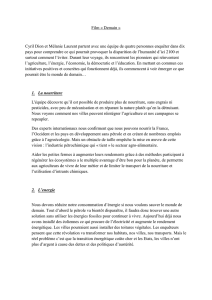CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS DE LA MONNAIE

Monnaie, Banque, Finance I Chapitre 1
1
CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS DE LA MONNAIE
La nature de la monnaie :
- Qu’est-ce que la monnaie ? (objet monétaire)
- Qu’est-ce qu’une économie monétaire ?
- Pourquoi les agents économiques accordent-ils une valeur à la monnaie ?
Il existe plusieurs façons d’aborder ces problématiques, plusieurs manières d’étudier le phénomène
monétaire car, la monnaie est une notion qui a plusieurs dimensions, plusieurs facettes qui
conduisent à différentes approches [certaines sont en opposition et certaines se complètent].
Section 1 : L
C’est l’approche la plus ancienne, elle remonte aux origines même de la pensée économique, on la
trouve notamment chez ARISTOTE. On définit la monnaie par
assure. Cette conception de la monnaie est largement répandue et acceptée par les économistes
aujourd’hui.
On distingue 3 fonctions principales à la monnaie :
- Unité de compte
- Intermédiaire des échanges [la fonction la plus importante]
- Réserve de valeur
Cette approche tend à considérer la monnaie comme un bien économique (≠ bien libre), utile pour
l’activité humaine, qui répond à un besoin des agents économiques. On dit que la monnaie rend des
services.
Ralf HAWTREY [Anglais, Cambridge] (1879-1975), La circulation monétaire et le crédit (1935) :
« La notion de monnaie comme celle de la cuillère à thé ou du parapluie mais contrairement à celle
du tremblement de terre ou du bout
avant tout par la fonction ou le but que chacun se propose ».
F. WALKER [Anglais] : « Money is that money does ».
1.1 La fonction d’unité compte
On qualifie également cette fonction de fonction de mesure de valeur ou d’étalon de valeur. Elle
permet de comparer les grandeurs économiques entre elles. Chacune des grandeurs économiques
qui sera évaluée ou exprimée avec cette unité, reçoit une valeur monétaire.
Des trois fonctions de la monnaie, celle-ci est la plus abstraite. La valeur en unité de compte
commune va faciliter l’établissement de contrats entre agents économiques et va permettre au

Monnaie, Banque, Finance I Chapitre 1
2
calcul économique de se développer et surtout de se simplifier en permettant le développement des
échanges.
On pourrait comparer l’unité de compte monétaire qu’on utilise en économie avec les unités de
mesures utilisées dans d’autres disciplines, telles que la physique (km). Il existe des différences entre
elles : en physique, ce sont des mesures stables alors qu’en économie, la valeur des biens n’est pas
stable (variante) car, l’économie est une science sociale, humaine donc, la valeur des biens y est
subjective : elle dépend en partie de l’appréciation des besoins en biens économiques (de l’utilité),
de la rareté, alors qu’en physique elle est objective (mesure poids).
[Monnaie : variation dans l’espace et dans le temps.+
L’intérêt de l’étalon des valeurs dans une économie apparait nettement si on compare un système
d’échange de biens avec cette unité, avec un système d’échange de biens sans cette unité de compte
une économie de troc : système où tous les biens peuvent s’échanger contre tous les biens.
L’existence d’un étalon de valeur dans une économie va simplifier le calcul économique et
notamment le système des prix.
Application numérique :
Soit une économie de troc avec n biens économiques :
- Indexer les biens : i = 1, …, n.
- Tous les biens s’échangent contre tous les biens.
- Les agents économiques doivent connaître les rapports d’échange entre tous
les biens pris deux à deux = les prix relatifs.
Nombre de combinaisons possibles des biens pris deux à deux parmi n biens :
S’il y a n biens, il y a
= !
!! =
=()
prix relatifs.
Exemple :
Si n=100, 100
2 = 10099
2 = 4950. Un échangeur doit connaître 4950 prix relatifs.
Si n=3, 321
211 = 3. Un échangeur doit connaître 3 prix relatifs :
Le rapport d’échange entre le bien 1 et le bien 2 (1 ; 2)
Le rapport d’échange entre le bien 1 et le bien 3 (1 ; 3)
Le rapport d’échange entre le bien 2 et le bien 3 (2 ; 3)
Désignons par P1/2, le prix du bien 1 exprimé en bien 2.
Admettons qu’une unité de bien 1 s’échange contre deux unité de bien 2, P1/2 = 2 et donc, le prix
relatif du bien 2 en bien 1 est P2/1 = 1
2 d’où 1
1/2 = P
2/1 .
Le prix relatif P2/1 est l’inverse du prix relatif P1/2.
Admettons ensuite que P1/3=3 c’est-à-dire qu’une unité de bien 1 s’échange contre 3 unités du bien
3.
Comment déterminer le prix relatif P2/3 qui soit compatible, cohérant, avec les deux autres ?
P1/3=3 donc P3/1 = 1
3
1 unité du bien 2 vaut 1/2 unité du bien 1 => 1/2 unités du bien 2 vaut 1 unité du bien 1.

Monnaie, Banque, Finance I Chapitre 1
3
1 unité du bien 1 vaut 3 unités du bien 3.
2 unité du bien 2 vaut 3 unités du bien 3 => 1 unité du bien 2 vaut 3/2 unités du bien 3
P2/3 = 3/2 et P3/2 = 2/3.
Remarque : On peut écrire d’une autre manière le prix du bien 2 exprimé en bien 3 :
P2/3 = 2/1
3/1 = 1/2
1/3 = 3/2. Autrement dit, le bien 1 sert d’unité de compte (référence dans l’évaluation
des biens).
Dans une économie où il y a n biens et dans laquelle on choisit un des biens comme unité de
comptes, les agents doivent connaître (n-1) prix (car 1 n est connu puisque c’est la base).
Ces prix exprimés en unités de comptes sont qualifiés de prix absolus (différent des prix relatifs) ou
de prix monétaire (de manière impropre). A partir de ces prix absolus, on peut déterminer les prix
relatifs (cf. remarque précédente).
Ex.: Si n=100 99 prix doivent être connus.
Economie de troc
L’introduction dans une économie d’une unité de compte permet de réduire considérablement la
quantité d’informations nécessaire aux agents économiques et donc de diminuer le coût des calculs
économiques pour chacun des agents. Et c’est cette économie informationnelle qui explique
l’apparition de l’unité de compte ou plutôt, les inconvénients du troc exigent qu’une unité de compte
soit choisie par les agents pour faciliter leurs échanges.
Remarque : Lorsque qu’une marchandise ou un bien particulier est utilisé comme unité de compte et
qu’il est choisi également parmi les n biens existants faisant partie des échanges, on dit que ce bien
est un numéraire (LEON WALRAS (1874), Eléments d’Economie Politique Pure). Le numéraire c’est
donc une unité de compte qui est utilisé comme marchandise dans les échanges entre agents. Dit
autrement, le numéraire, c’est ce qu’on appelle aussi monnaie marchandise, à double fonction :
unité de compte, et satisfaction des besoins, que ce soit pour la consommation ou la production.
Le numéraire est donc une unité de compte utilisé comme marchandise dans les échanges entre
agents = une monnaie marchandise (unité de compte et satisfaction des besoins)
1 2 3
1
2
3
1 p1/2 p1/3
P2/1 1 p2/3
P3/1 p3/2 1

Monnaie, Banque, Finance I Chapitre 1
4
*L’unité de compte est concrète mais elle peut être abstraite bien qu’elle puisse se matérialiser sous
forme concrète. Ex.: l’euro.+
Pour certains économistes, dont JOHN MAYNARD KEYNES dans le traité sur la monnaie (1930) ou
encore l’économiste français JEAN DENIZET, la fonction d’unité de compte est la fonction essentielle
de la monnaie. Cette position doit être nuancée, contredite car retenir comme seule fonction la
fonction d’unité de compte ne définit pas la monnaie, ne remédie pas aux inconvénients du troc.
Lorsqu’une unité de compte est abstraite, un changement de valeur de l’étalon de mesure ne
modifie en aucun cas les prix relatifs des biens échangés : seuls les prix absolus sont modifiés.
Ex.: franc euro.
Soit deux biens quelconques i et j.
P i/j = /
/ = /
/ =
/
6,56
/
6,56
Conclusion : Choisir une unité de compte dans une économie, c’est introduire une plus grande
efficacité dans le système des changes puisque le calcul économique des agents économiques pour
effectuer leurs échanges est sensiblement amélioré, et cela vient du gain informationnel concernant
la valeur des biens.
On peut donc franchir l’étape supplémentaire en faisant en sorte que l’unité de compte choisie par
les agents soit effectivement utilisée pour faciliter la circulation des autres biens c’est-à-dire, que
cette unité de compte devienne également un intermédiaire d’échange.
1.2 La fonction d’intermédiaire des échanges
Pour la plupart des économistes, c’est la fonction la plus importante car c’est elle qui va permettre
de remédier aux inconvénients du troc cette fonction va permettre à ce que les agents réalisent
leurs échangent à moindre coût.
Cette fonction concerne l’équilibre ex-post (réalisation) d’une économie alors que l’unité de compte
concernait l’équilibre ex-ante (intention, calcul).
IRVIN FISHER, The Purchasing Power of Money (1911) :
« peut être appelé
monnaie ».
J. TOBIN, Accumulation and Economic Activity (1978) :
«
faites autant z également. »
G. TULLOCK [école de Virginie : James Buchanan (prix Nobel) école du « public choice »]:
«
laquelle je désire de la monnaie est que je
».

Monnaie, Banque, Finance I Chapitre 1
5
Remarque : Du fait de la notion d’externalité, la monnaie s’apparente à un bien collectif.
La qualité essentielle de la fonction d’intermédiaire des échanges c’est d’être échangeable dans délai
et sans coûts contre n’importe quel bien ou service. L’intermédiaire des échanges a un droit
immédiat sur les biens.
Pour mettre en évidence que la fonction d’intermédiaire des échanges permet de briser le troc et
passer à une économie monétaire, il faut analyser plus en détail les inconvénients du système de
troc, et plus particulièrement ceux pour la réalisation des échanges.
Par nature, une économie est constituée d’échanges, de biens et services, entre agents
économiques, et si l’on admet cela, ça signifie que les agents économiques disposent d’une certaine
quantité de différents biens (dotations initiales) dont la composition ne correspond pas à ceux qu’ils
désirent pour consommer et produire.
Pour passer de dotations initiales données à des paniers de consommation désirés, il faut que les
agents puissent effectuer des transactions. Et lorsque les transactions correspondent à des échanges
de biens contre biens, le système d’échange correspond à une économie de troc.
Ce système de troc génère des coûts de fonctionnement très élevés qui correspondent à des coûts
d’information et de transactions. Ces coûts sont d’autant plus élevés que le nombre de transactions
est élevé. Ces coûts d’information (coût de transaction) correspondent à la nécessité pou un agent
économique quelconque de trouver un partenaire économique qui accepte de faire un échange
symétrique avec lui.
Ex.: Dotations initiales : l’agent 1 a du bien 2 et veut du bien 1, il faut qu’il trouve un agent 2 qui veut
du bien 2 et qui possède du bien 1.
Pour que la transaction puisse se réaliser, il faut ce qu’on appelle une double coïncidence des
volontés, des désirs sur les biens qui sont soumis à l’échange.
Ce coût d’information, c’est le coût essentiel du troc, et il s’apparente à un coût de prospection
(entente) qui consiste à trouver le bon échangiste.
Pour que la transaction puisse encore se réaliser, il faut qu’une deuxième double coïncidence des
désirs soit satisfaite : il faut que les échangistes acceptent d’échanger leurs biens au même moment.
Le système du troc pour qu’il puisse fonctionner suppose donc l’existence et la réalisation de deux
double coïncidences : la coïncidence des désirs sur l’objet des échanges (enjeux des échanges), et sur
le moment de l’échange.
A ces coûts d’informations s’ajoutent des coûts de transactions proprement dit qui sont des coûts de
transport et de stockage des marchandises qui peuvent varier selon la nature des biens et la distance
qui sépare les partenaires.
Remarque : A la différence de l’économie monétaire, ces coûts de transaction dans l’économie de
troc portent sur les biens vendus et achetés, i.e. sur la partie et la contrepartie de toute transaction.
Pour remédier à ces grands inconvénients de l’économie de troc, on pourrait imaginer que
les agents économiques puissent pratiquer des échanges indirects.
Ex.: 3 agents : A, B, C et 3 biens : 1, 2, 3. Soit W les dotations initiales et X ce que les agents désirent
consommer :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%