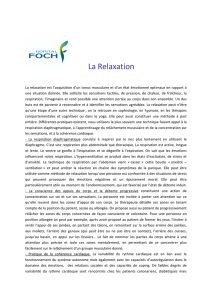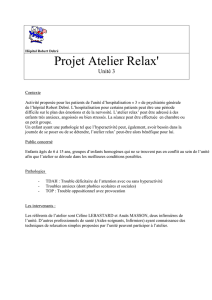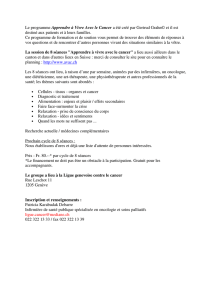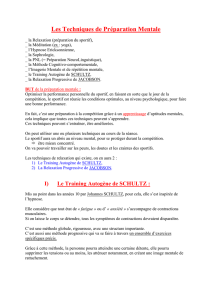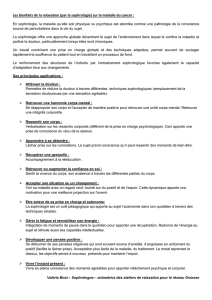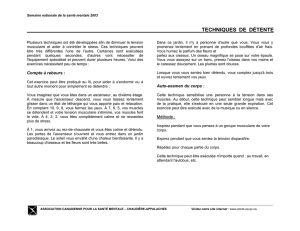Gérer stress et émotions en EPS

Sylvain BAERT, Yancy DUFOUR
Gérer stress et émotions en EPS :
intérêts et apports de la préparation mentale
Sylvain BAERT* et Yancy DUFOUR°
* Préparateur Mental, Doctorant en psychologie du sport
°AEEPS Régionale de Lille - FSSEP Lille2
Introduction
Stress et émotions font partie intégrante de notre vie. Lequel de nous, en effet, n’a
jamais été confronté à des situations stressantes ? Qui n’a jamais éprouvé les émotions
suivantes : Colère, joie, tristesse, peur, dégoût ou surprise ?
Nous le verrons, les émotions bien gérées sont utiles pour l’être humain. Elles
permettent de s’adapter à l’environnement, favorisent la raison, l’apprentissage, la
communication etc. En revanche, les émotions mal gérées et le stress, seront plutôt néfastes
pour l’individu.
Apprendre à gérer stress et émotions contribue par conséquent à notre bien-être
mental. Il est donc nécessaire d’entreprendre un tel apprentissage dès le plus jeune âge, et en
l’occurrence durant la vie scolaire, où les élèves sont confrontés à vivre à des situations plus
ou moins stressantes (dans les diverses APSA, lors des examens, à cause des exigences
scolaires…) et à vivre toutes sortes d’émotions.
Nous essaierons de montrer à travers cet article que l’enseignant d’EPS, en proposant,
des APSA et des situations d’apprentissage variées et riches en émotions (et/ou stress), en
transmettant des contenus d’enseignement, des solutions pour faire face (qui seront nommées
coping) pour mieux gérer ces situations, peut non seulement favoriser les apprentissages des
élèves et leur satisfaction d’être en cours mais surtout leur permettre de développer leur
adaptabilité face aux différentes situations plus ou moins agréables qu’ils rencontreront
fréquemment dans leur vie.
Avant de fournir divers arguments en faveur de cette problématique, il nous paraît
cependant nécessaire de répondre aux questions suivantes : -Qu’est-ce que le stress ? -
Comment le gérer ? -Qu’est-ce qu’une émotion ? -Quelles fonctions remplit-elle ? -Pourquoi
partageons-nous nos émotions ? -Et surtout, comment les maîtriser ou les vivre pleinement ?
Dans une première partie, nous aborderons donc l’aspect théorique des émotions et du
stress, puis dans un deuxième temps, nous présenterons l’utilité de la préparation mentale
dans le cadre de la gestion du stress et des émotions en milieu scolaire.
1. Emotions et Stress : théorie
1.1. Les émotions
Un peu d’histoire
La question du traitement des émotions est très ancienne puisqu’elle remonte à
l’antiquité où s’affrontaient déjà les partisans du Stoïcisme et ceux de la Catharsis (qui

Sylvain BAERT, Yancy DUFOUR
mettaient en exergue, contrairement aux stoïciens, le rôle bénéfique de l’expression des
émotions).
En 2007, nous retrouvons toujours cette opposition entre les partisans de l’ « auto-
contrôle », du « je garde tout pour moi, c’est mieux comme ça » et ceux du « lâche toi, dis ce
que tu as sur le cœur, cela te fera du bien ». Pourquoi tant d’années n’ont-elles pas abouti à
des réponses bien précises ?
Deux obstacles majeurs ont en fait contribué au faible nombre de recherches sur les
émotions :
-un obstacle idéologique. De grands penseurs comme Platon ont très tôt véhiculé l’idée d’une
émotion négative, pervertissant la raison. Le dualisme de Descartes n’a pas permis de montrer
les relations étroites entre le corps et l’esprit, il a au contraire fait persister cette idée d’une
émotion nuisant au jugement rationnel.
-un obstacle physiologique. Les chercheurs intéressés par les études sur les émotions se sont
souvent orientés sur les aspects physiologiques des émotions, sur ce qui était mesurable (la
température corporelle, la fréquence cardiaque, etc) emportés par un soucis de rationalisme,
très présent dans le monde scientifique.
Les premières recherches scientifiques modernes sur les émotions remontent
finalement à 1872 avec l’ouvrage de Darwin s’intitulant « l’expression des émotions chez les
hommes et les animaux ». Ensuite, de nombreux scientifiques ont contribué à la recherche
moderne sur les émotions tels que James (1884), Lange (1885), Cannon (1927) ou bien encore
Schachter (1964). Nous pouvons cependant considérer Damasio comme un déclencheur
majeur du regain d’intérêt pour la question du traitement des émotions. Ses deux ouvrages
aux titres révélateurs d’un changement idéologique, « l’erreur de Descartes » en 1995 puis
« Spinoza avait raison » en 2003, ont clairement contribué à l’essor des sciences affectives
(Scherer, 2006).
Définition
Actuellement, l’émotion peut se définir comme « une structure préparée de réponses
qui intervient de manière automatique dans le cours du processus adaptatif. Elle se manifeste
à la fois par des changements dans l’expression (faciale, vocale, posturale…), par une
impulsion marquée à déployer une action spécifique (bondir, frapper, rejeter fuir, s’effondrer,
s’immobiliser…), ainsi que par une coloration marquée de l’expérience subjective (le « vécu
émotionnel »). En outre, l’émotion se caractérise par des modifications majeures sur le plan
cognitif. En effet, les activités automatiques en cours sont interrompues, le contexte au sein
duquel l’émotion a émergé devient le foyer de ressources attentionnelles, ce contexte conserve
ensuite la priorité dans le processus de traitement de l’information qui tend à son évaluation
complète. Ces différentes manifestations s’appuient sur d’importantes modifications
physiologiques qui affectent particulièrement les différents organes contrôlés par le système
neurovégétatif » (Rimé, 2005).
Nous pouvons donc caractériser l’émotion à partir de trois critères :
-des réponses physiologiques : changements du rythme cardiaque, de la pression sanguine,
modifications de la réponse électrodermale, de la température corporelle, de la respiration,
etc.
-des réponses comportementales : expressions faciales (élévation des sourcils, rictus de la
bouche, etc), mains qui s’agitent, positions du corps différentes, voix qui change, etc.
-des réponses cognitives : variations dans les façons de juger, percevoir, mémoriser, etc.

Sylvain BAERT, Yancy DUFOUR
D’autre part, selon Russel (1980), les émotions prennent place dans un espace bi-
dimensionnel. La première dimension est « la valence » (« agréable » / « désagréable »). La
seconde est « l’implication émotionnelle » (« forte » / « faible »).
Enfin, il existerait un répertoire émotionnel universel (émotions « de bases » ou
« primaires ») propre à tous les êtres humains quelle que soit leur culture. Selon Ekman
(1992), ces émotions de bases seraient au nombre de six : la colère, la peur, la surprise, la
tristesse, la joie, et le dégoût.
Physiologie
Ce sont principalement les structures limbiques du cerveau qui contrôlent les émotions
et la physiologie du corps, alors que le néocortex contrôle la cognition, le langage et le
raisonnement. Comme l’illustre le docteur Servan-Schreiber (2003), il y a donc une mise en
jeu de « deux cerveaux » : le cognitif et l’émotionnel. Il peut y avoir alors soit coopération
soit compétition.
Comme l’explique Servan-Schreiber (2003), psychiatre et chercheur en neurobiologie,
si le cerveau émotionnel prend le dessus démesurément, sous l’effet du stress par exemple ou
lorsque nos émotions sont trop à vif, le cortex préfrontal n’a alors plus aucune influence et
perd sa capacité à raisonner et à guider le comportement. Il faut donc apprendre à gérer ses
émotions pour éviter ce « court-circuit émotionnel ». Á l’inverse, pour éviter d’être guidé
uniquement par nos pulsions, nos réflexes, nos instincts, le cerveau cognitif à la capacité de
réguler, tempérer, les réactions émotionnelles. Mais il est important de ne pas non plus utiliser
systématiquement ou abusivement ce contrôle cognitif des émotions. En effet, il faut aussi
parfois vivre pleinement ses émotions (rires, pleurs …). Il faut donc pouvoir trouver
l’équilibre entre les deux systèmes. Servan-Schreiber (2003) écrit : « C’est le résultat de cette
interaction (coopération ou compétition), qui détermine ce que nous ressentons, notre rapport
au monde, et notre rapport aux autres. Les différentes formes de compétition nous rendent
malheureux. Á l’inverse, lorsque le cerveau émotionnel et le cerveau cognitif se complètent,
l’un pour donner une direction à ce que nous voulons vivre (l’émotionnel), et l’autre pour
nous faire avancer dans cette voie le plus intelligemment possible (le cognitif), nous
ressentons une harmonie intérieure qui sous-tend toutes les expériences durables de bien-être.
(…) Cet état de bien-être est ce à quoi nous aspirons continuellement : la manifestation de
l’harmonie parfaite entre le cerveau émotionnel, qui donne l’énergie et la direction, et le
cerveau cognitif, qui organise l’exécution Le grand psychologue Mihali Csikszentmihalyi a
baptisé cette condition état de « flux » (« flow » en anglais) ».
Fonctions de l’émotion
Sur le plan individuel, celle-ci nous permet de nous adapter à notre environnement.
Par exemple, la peur peut provoquer une réaction de fuite devant un certain danger en activant
le pôle sympathique du système autonome. D’autre part, les émotions ont aussi une fonction
motivationnelle. En effet, « les émotions incitent l’individu à poursuivre son engagement et
atteindre le but, ou à se désengager et à opérer la transition vers d’autres buts » (Rimé, 2005).
Sur un plan « dyadique » (relation à deux) pour reprendre l’expression de Niedenthal (2005),
les émotions jouent surtout un rôle de communication. Par exemple, lors d’un match de
tennis, un joueur va user du jeu d’attaque, et de certains comportements (regards agressifs,
démarche rapide et conquérante, etc…) pour tenter d’intimider son adversaire et établir une
relation de pouvoir à son avantage. D’autre part « la communication d’une émotion, permet
également à celui qui la ressent de faire comprendre à l’autre la façon dont il a perçu la
situation et d’induire chez lui une émotion (dite complémentaire) qui a pour but de modifier
son comportement » (Niedenthal, Nugier, 2005). Enfin, sur un plan plus large, au sein d’un
groupe, les émotions vont renforcer la cohésion groupale (par exemple, la joie après une

Sylvain BAERT, Yancy DUFOUR
victoire collective), ou communiquer et maintenir une hiérarchie sociale (pour plus de
précision sur la cohésion de groupe se reporter à l’article de Nathalie CREPIN et Yancy
DUFOUR à la fin de cet ouvrage Debeyre n°2, 2007). Finalement, les émotions vont donc
nous permettre d’accroître notre motivation, de nous adapter à l’environnement et de le
maîtriser, de communiquer, de transmettre des informations non verbales a autrui, mais aussi
de renforcer la cohésion groupale, ou de définir une hiérarchie sociale entre les individus d’un
groupe (Niedenthal, Nugier 2005).
Les émotions ont des actions importantes sur nos différents processus cognitifs :
l’attention, la mémoire, etc. Pour le prouver il suffit de réfléchir à propos de nos différents
types de mémoire. Nous sommes capables d’enregistrer un grand nombre de situations à
caractère émotionnel dans notre mémoire épisodique (celle des événements de la vie) sans le
moindre effort. Qui ne se rappelle pas de son premier baiser ? Par contre, l’enregistrement des
connaissances formelles (souvent non imprégnées d’émotions) est beaucoup plus difficile.
Qui est capable de citer les auteurs déjà évoqués dans cet article en rappelant leurs apports
théoriques majeurs ? Cela demande déjà beaucoup plus d’efforts (un peu moins pour les sujets
motivés intrinsèquement par cette lecture, que nous espérons nombreux)…
Les émotions ont également une action majeure sur notre raison. Les cas célèbres
d’Elliot ou de Phinéas Gage (dont le crâne avait été transpercé par une barre à mine) relatés
par Damasio (1995) indiquent bien qu’il existe une zone du cortex frontal intégrant les valeurs
émotionnelles aux connaissances et que cette zone permet la prise de risque, la responsabilité.
Au regard de ces multiples fonctions, nous comprenons mieux alors pourquoi l’on
parle de plus en plus d’intelligence émotionnelle aujourd’hui, pourquoi l’on cherche à éviter
les personnes alexithymiques et que l’empathie devient une qualité essentielle chez l’être
humain.
Comme le rappelle Schreiber (2003), l’intelligence émotionnelle qui peut se mesurer à
l’aide du « quotient émotionnel », s’articule autour de quatre fonctions essentielles (Mayer,
Salovey et al, 2000) :
a) L’aptitude à identifier son état émotionnel et celui des autres
b) L’aptitude à comprendre le déroulement naturel des émotions
c) L’aptitude à raisonner sur ses propres émotions et celles des autres
d) L’aptitude à gérer ses émotions et celle des autres.
On comprend donc l’importance de favoriser le développement d’une telle intelligence
chez les élèves. Rusinek (2004) va même plus loin en ajoutant : « Certains la voient comme
une explication de l’échec scolaire chez des enfants ayant pourtant une autre intelligence tout
à fait convenable, voire supérieure. N’étant pas intelligents émotionnellement, étant trop
émotifs ou pas assez, ne réagissant pas convenablement aux interactions émotionnelles avec
leurs pairs, ces enfants se couperaient de la société et en subiraient les conséquences dans
leurs performances concernant d’autres domaines. Le manque d’intelligence émotionnelle
pourrait aussi pour ceux-là être traduit par un manque de curiosité, de confiance, de
coopération, de maîtrise de soi qui sont nécessaires à une bonne évolution dans le domaine
scolaire ».
Gestion des émotions
De quelle manière alors s’y prendre pour aider une personne à mieux gérer ses
émotions ? Luminet (2002), en présentant les modèles de Horowitz (1992) et Janoff-Bullman
(1992) nous montre bien que le traitement d’une émotion se réalise finalement à long terme.

Sylvain BAERT, Yancy DUFOUR
Le traitement d’une émotion se caractérise en effet par une succession de stades de
confrontation et d’évitement.
Il semblerait qu’à court terme, une période de déni, de contrôle, de distraction, c’est-à-dire
d’évitement, soit une solution intéressante avant de commencer à ruminer (pensées intrusives
d’abord puis ruminations mentales volontaires ensuite bien souvent). Il est préférable en effet
de ne pas trop subir l’impact émotionnel à court terme, cela permet notamment lors des
ruminations ultérieures de revivre la situation avec moins de difficultés (on y repense sans
avoir trop de symptômes physiologiques par exemple). Il est conseillé par exemple de choisir
un distracteur plutôt que plusieurs afin que le sujet retrouve un certain sentiment de contrôle.
Il est aussi montré que ruminer alors que l’on subit un impact émotionnel n’est pas réellement
efficace.
Une fois que l’impact émotionnel se réduit, la phase de rumination mentale peut débuter. Les
premières ruminations sont bien souvent intrusives, elles interviennent sans qu’on le souhaite
(souvent de manière répétée) et sont finalement le signe d’un traitement mental contrôlé à
réaliser. Les ruminations mentales ont comme but principal de rétablir nos croyances (sur soi,
sur l’environnement, sur la situation vécue…) qui se trouvent ébranlées par la situation à
caractère émotionnel vécue.
Partager socialement dans l’optique de résoudre les discordances entre les croyances, les
schémas antérieurs et la réalité nouvelle devient alors utile. Le partage social peut-être
considéré comme l’étape ultime du traitement de l’émotion. Le partage social est donc une
étape majeure qui ne doit pas être trop précoce. Elle est non seulement très efficace pour
permettre au sujet de s’adapter mais elle est bénéfique pour tous les sujets participant au
partage social. A titre d’exemple, si « A » partage avec « B », alors « B » enregistre une
expérience émotionnelle contribuant au développement de sa propre adaptabilité, sans avoir
vécu la situation. « A » et « B » renforcent leurs liens sociaux parce que partageant une
expérience émotionnelle, un secret… Secret que « B » risque bien de confier à « C » (on parle
de partage social secondaire), etc…
Ce cadre temporel du traitement de l’émotion paraît bien figé, c’est une sorte de succession de
stades. Il faut cependant préciser qu’il est nécessaire d’alterner entre des périodes de
confrontation (rumination mentale, partage social) et d’évitement afin de réussir le traitement
de l’émotion et que l’on peut « sauter » un stade, revenir à un stade antérieur en cas d’échec
dans le traitement de l’émotion.
1.2. Le Stress
Fonctionnement
Selye (1936) est l’un des premiers à avoir décrit ce qui correspond au stress. Il avait
mis en évidence que des événements désagréables produisent des manifestations organiques
considérables qu’il appelait alors « Syndrome Général d’Adaptation » (SGA). Nous
pouvons alors parler, avec cet auteur, de conception physiologique du stress.
C’est avec Lazarus et Folkman (1984) que le stress va prendre une dimension
beaucoup plus psychologique. En effet, selon ces auteurs, c’est l’interprétation par le sujet de
la situation dite stressante (appelée interprétation cognitive de la situation) qui est le point de
départ du stress. Face à un événement quelconque, l’être humain juge en quelques centièmes
de seconde l’impact que cet événement a pour lui-même, on parle d’évaluation cognitive
primaire. Cette évaluation dépend d’un grand nombre de facteurs comme le sexe, l’âge, la
fatigue, la motivation, l’expérience, etc. Si le sujet considère la situation comme neutre ou
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%