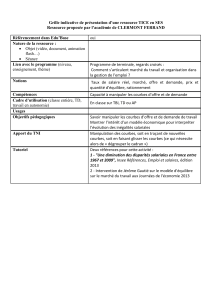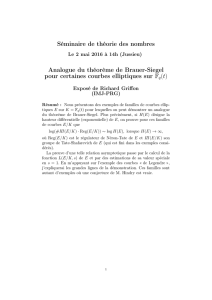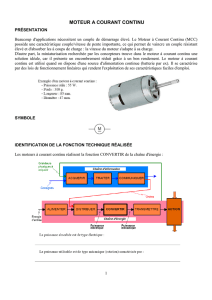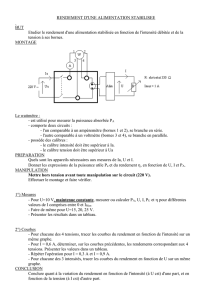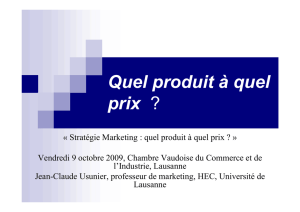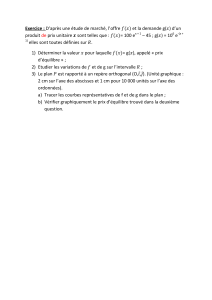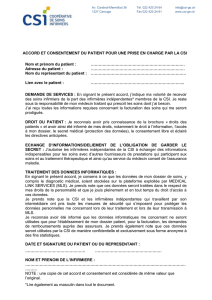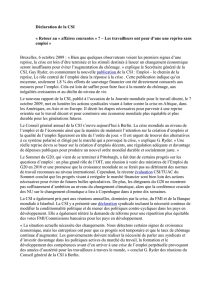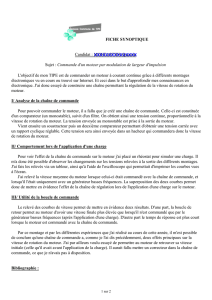synthese du chapitre : comment se forment les prix sur un marche

SECONDE – CSI – A. STRATAKIS 2013-2014
SYNTHESE DU CHAPITRE : COMMENT SE FORMENT LES PRIX SUR UN MARCHE ?
. Comment les variations de l’offre et de la demande affectent-elles le niveau des prix ?
La demande et l’offre d’un bien ou d’un service se rencontrent sur un marché, lieu réel ou virtuel, sur lesquels
ces biens et services sont échangés contre un certain montant de monnaie, le prix.
La demande est la quantité de biens ou services que les ménages et entreprises décident d’acheter à un prix
donné. L’offre est la quantité de biens ou services que les entreprises sont prêtes à vendre sur le marché à un
prix donné.
Lorsque le marché a une structure concurrentielle, les demandeurs et offreurs ne peuvent pas influencer les
prix, ils subissent le prix du marché, on dit qu’ils sont « price takers ». Comment se forment alors ces prix sur
les marchés en situation de concurrence ?
La demande est fonction décroissante du prix des biens et services : plus le prix s’élève, plus la demande
baisse. Inversement, l’offre est fonction croissante du prix, plus le prix s’élève, plus les entreprises peuvent
espérer faire du profit et donc plus l’offre augmente. C’est la loi de l’offre te de la demande.
On peut représenter l’offre et la demande par des courbes, avec en abscisses la quantité et en ordonnées le
prix (voir courbes tracées en cours). Lorsque la demande ou l’offre varient en fonction du prix, on observe un
déplacement sur la courbe de la demande ou sur la courbe de l’offre. Les courbes de demande et d’offre se
rencontrent à un point d’équilibre, qui définit le prix d’équilibre et la quantité d’équilibre.
Un changement de la quantité demandée ou offerte, indépendamment du prix, implique cette fois un
déplacement de la courbe. Pour la demande, il peut s’agir d’un changement de mode, de la mise sur le marché
d’un produit substituable, d’un changement d’habitudes de consommations liées à une campagne de publicité
ou au contraire à une campagne de dénonciation des effets nocifs d’un produit par exemple. Pour l’offre, il peut
s’agir d’un changement dans les coûts de production, lié au progrès technique ou aux conditions climatiques par
exemple.
. L’évolution des prix ne répond pas toujours à la loi de l’offre et de la demande.
Il y a de nombreuses situations où les prix ne se fixent pas selon la loi de l’offre de la demande
. Lorsque le marché n’a pas une structure concurrentielle, comme dans le cas de monopoles ou des oligopoles.
En effet, dans ce cas, les entreprises deviennent « price maker », elles peuvent fixer leurs prix et l’imposer sur
les marchés.
. Des entreprises peuvent aussi abuser de leur position dominante pour écarter les concurrents, ou encore
s’entendre sur les prix, dans les deux cas ce sont des pratiques illégales et elles sont sanctionnées par l’Autorité
de la concurrence.
. Les entreprises cherchent à échapper à la concurrence et devenir « price maker » en différenciant leur
produits ou services de ceux des concurrents (par l’image de marque, la qualité, le packaging…). Dans ce cas,
les demandeurs sont prêts en effet à payer plus cher pour un produit qui leur semble différent.
Rappels : l’élasticité-prix (c’est-à-dire la réaction de la demande par rapport aux variations des prix) est
différente selon les produits.
Ne confondez pas les taux de répartition (sous-ensemble/ensemble x 100) ; qui permettent de mesurer la part
d’un sous-ensemble dans un ensemble. Un taux de chômage par exemple est un taux de répartition par
exemple.
Et les taux de variation ((valeur d’arrivée-valeur de départ) /valeur de départ x100), qui permettent de
mesurer l’évolution d’une donnée dans le temps (baisse ou augmentation). Le taux de croissance du PIB est un
taux de variation par exemple.

SECONDE – CSI – A. STRATAKIS 2013-2014
1
/
2
100%