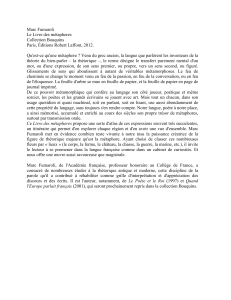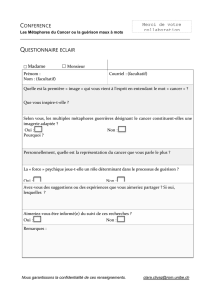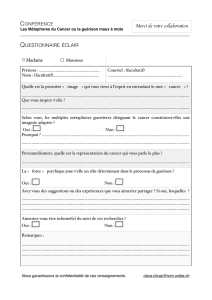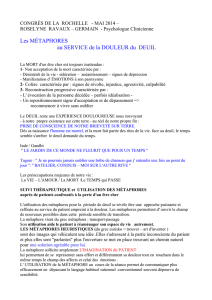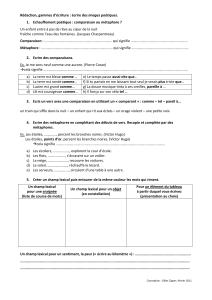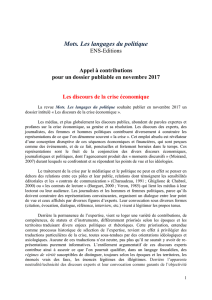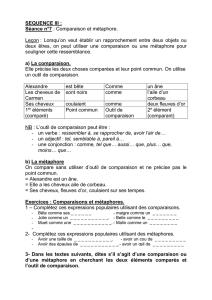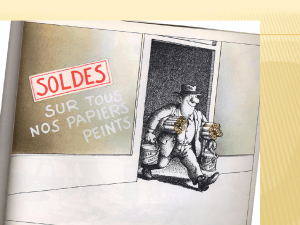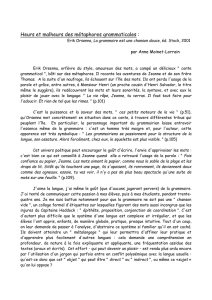La traductibilité de la métaphore coranique

La traductibilité de la métaphore coranique
George Grigore
L’étude qui suit concerne les métaphores coraniques et la possibilité de
les transposer dans un autre code linguistique, dans notre cas, la langue
française.
La base de notre recherche a été constituée, d’une part, par le
texte coranique, et d’autre part, par ses traductions publiées en fran-
çais. Nous avons prêté une attention spéciale à la traduction de D.
Masson qui nous a offert la matière nécessaire pour mettre en évi-
dence les aspects qui pourraient passer pour significatifs du point de
vue de la traductibilité de la métaphore coranique.
La préférence du Coran pour l’utilisation fréquente de la méta-
phore s’explique par le fait que celle-ci est employée pour communi-
quer des réalités d’un plan idéatique en se rapportant aux éléments
d’un autre plan, par leur traduction d’un type de langage, celui de
l’absolu, du transcendent, dans un autre, celui du relatif, du fini, du
compréhensible.
Au lieu d’aspirer à la création d’un système d’abstractions expri-
mé par une série de signes linéaires ainsi qu’il arrive dans les
sciences exactes, le Coran crée un système de mots unique, inimi-
table par l’intermédiaire des embranchements et des connexions
multiples, chaque vocable qui lui est englobé ayant un aspect neutre,
informationnel et un aspect symbolique. Ce dernier côté est rendu
d’habitude par la métaphore qui, par ses reprises obsédantes de
présentations et de représentations, devient un élément fondamental
de ce système mythique-religieux qui est le Coran. Au fond, ce sys-
tème n’est pas autre chose qu’une amplification de la métaphore jus-
qu’à la généralisation.
La métaphore est une figure de style par laquelle on transfère
ou on prête la signification d’un mot à un autre mot, à partir d’une
Caietele Institutului Catolic II (2001, 1) 88-106

La traductibilité de la métaphore coranique 89
comparaison qui se maintient au niveau mental. Ce transfert
concerne seulement certains plans des significations des mots que
l’on pourrait ranger en deux grandes catégories:
a) la signification dénotative ou référentielle, c’est à dire la signi-
fication de base, telle qu’elle se trouve consignée dans le diction-
naire;
b) la signification connotative-métaphorique, c’est à dire la signi-
fication acquise par le vocable dans un context déterminé;
Il y a des mots qui, dans des circonstances déterminées,
ajoutent à la signification dénotative (référentielle, factuelle) un ni-
veau métaphorique qui apporte au dénoté un surplus d’information
valorisatrice. La métaphore est toujours une image de l’objet reflétée
par la configuration d’un autre objet, et la connexion entre ces deux
objets est un fait de conscience, une activité de valorisation esthé-
tique et cognitive. Ainsi, l’image véritable, complète, ne peut pas être
devinée que d’après son reflet. Le déchiffrement de l’image totale,
cachée, dont parlent les commentateurs musulmans, à partir de ses
reflets evidents dans les mots du texte coranique, est un processus
continuel, parce que les valences métaphoriques de chaque mot
peuvent réverbérer au niveau de l’esprit des significations d’une
grande diversité dès que l’on sort de l’univocité des vocables pour se
rendre attentif aux diverses acceptions selon un même mot est em-
ployé dans divers sens métaphoriques. À ce niveau de la significa-
tion, le dénoté est détaché de son immédiat phénoménologique et
placé, à la limite, entre les connaissances existentes sur le monde et
les intuitions qui n’ont pas un contour précis dans le réseau d’abs-
tractions et de vérités vérifiables dans un certain moment historique.
Ce sens suit les lignes générales de la pensée humaine, ce qui faci-
lite, en grande mesure, le transcodage de la métaphore coranique
dans une autre langue.
Pour synthétiser, on peut dire que le point de départ de la méta-
phore réside dans une construction comparative du type: x est simi-
laire à y. Pour arriver à la métaphore, le terme x et, implicitement, le
relatif de comparaison seront éliminés, tandis que certains traits sé-
mantiques du terme x, telle la réflexion d’une image dont nous ve-
nons de parler, passeront sur le terme y. La comparaison peut être
reconstituée à partir de ces traits sémantiques transférables pour
conduire, finalement, au déchiffrement de la métaphore.

90 George Grigore
Dans la pensée mythique-religieuse cristallisée dans le Coran,
la métaphore ne se limite pas à indiquer une certaine chose, mais,
bien davantage, elle s’y substitue pour entrer dans une relation de
con-substantialité avec le référent, ce qui conduit à une coïncidence
entre les deux plans idéatiques, celui de l’absolu et celui du rélatif.
C’est précisément à ce point que commencent, dirait-on, les pro-
blèmes soulevés par toute traduction de la métaphore coranique.
En suivant le critère de leur traductibilité en français, nous pro-
posons la classification des métaphores coraniques en deux grandes
catégories:
a) métaphores à équivalent métaphorique du même type;
b) métaphores sans équivalent métaphorique du même type
Métaphores à équivalent métaphorique du même type
Les métaphores coraniques à équivalent métaphorique du
même type en français sont:
a) les métaphores révélatrices;
b) les métaphores artistiques universelles;
Nous avons adopté cette répartition des métaphores d’après
l’ouvrage de Lucian Blaga, “Geneza metaforei şi sensul culturii” (“La
genèse de la métaphore et le sens de la culture”) publié en 1935 à
Bucarest, en remplaçant seulement son terme “plasticisant” par “ar-
tistique”.
a. Les métaphores révélatrices
Les métaphores révélatrices prennent naissance du mode spé-
cifiquement humain d’exister dans l’horizon du mystère et de la révé-
lation. Ces métaphores se réfèrent aux dimensions fondamentales
de l’existence, aux aspects essentiels de l’existence de toute com-
munauté humaine (v. Blaga; 42). Les réalités exprimées à l’aide des
métaphores révélatrices sont toujours des zones qui attirent l’intérêt
des gens, autrement dit, elles renferment des idées obsessionnelles
de l’esprit collectif. Puisqu’elles reflètent une image chiffrée des réali-
tés absolues, elles représenteront les points de repère pour toute
œuvre religieuse (v. Marino; 185). Ce type de métaphore donne
naissance aux thèmes centraux religieux qui se répètent de manière
insistante, afin de s’imprimer dans la mémoire et, surtout, dans l’es-

La traductibilité de la métaphore coranique 91
prit des fidèles, en tant que les motifs principaux d’une symphonie,
se manifestant dans les moments importants.
Ces métaphores ont comme point de départ des éléments
concrets, généralement connus par tout le monde, et renferment des
idées abstraites, difficile à définir telles celles qui se trouvent, par
exemple, derrière des mots comme la lumière, les ténèbres, la voie
etc. Etant le résultat d’une compréhension généralement humaine de
la réalité, ces métaphores se retrouvent dans les cultures les plus di-
verses, ce qui rend assez facile leur transposition d’une langue à
l’autre. L’équivalence interlexicale des termes qui constituent les mé-
taphores révélatrices conduit implicitement à l’équivalence de leurs
champs sémantiques, du moment qu’ils ont la même auréole méta-
phorique, les mêmes significations connotatives.
Dans ce type de métaphore, le mouvement mental glisse du
concret à l’abstrait, du connu à l’inconnu. En conséquence, les
formes physiques du monde extérieur – des objets et des phéno-
mènes réels – acquièrent par l’analogie des sens métaphoriques
illustrant des notions abstraites. Plus le terme de départ de ces mé-
taphores est ancré dans la réalité immédiate, plus les sens qu’il re-
cevra par le mouvement métaphorique seront abstraits (v.Slave;
26 ).
A leur tour, les métaphores révélatrices peuvent étre réparties,
en plusieurs groupes, en fonction de la classe sémantique du terme
qui les introduit: 1) cosmogoniques; 2) cosmo-anthropomorphiques;
3) anthropomorphiques; 4) concrétives.
a-1) Les métaphores révélatrices cosmogoniques
La pensée humaine a élaboré, le long du temps, un modèle
dualiste qui incorpore un grand nombre de principes opposés et
complémentaires se trouvant à l’origine de la création du monde (le
ciel/la terre; la vie/la mort; la lumière/l’obscurité etc.). Ce modèle
dualiste suivi par les métaphores révélatrices cosmogoniques est
spécifique à toutes les cultures. Il peut être rencontré chez tous les
peuples, quel que soit leur degré de développement social ou cultu-
rel, ce qui rend plus facile le transcodage de ces métaphores d’une
langue à l’autre (v. Lévi-Strauss,164).
Dans les systèmes religieux, le monde prend naissance non
seulement des éléments ou des phénomènes antagoniques, tels le

92 George Grigore
froid/le chaud, la lumière/l’obscurité, mais encore de leurs principes
correspondants dans le plan moral par une translation métaphorique
tels le bien/le mal, croyance/l’incroyance etc. Par exemple, le terme
“lumière” se trouve en opposition avec le terme “obscurité” aussi
bien dans son sens propre, que dans son sens métaphorique: si la
lumière signifie enseignement, culture, éducation, croyance, le bien,
son antonyme signifiera ignorance, inculture, péché, incredulité, le
mal (v. Slave, 51).
Au sens du bien absolu, la lumière (ar.:“nûrun”) est – dans le Co-
ran – une métaphore qui désigne Dieu même. Cette idée est pré-
sente dans toute la mystique religieuse, ayant pour fondement
l’identification spontanée, instinctive de Dieu avec les éléments indis-
pensables à la vie: la lumière, la chaleur, l’eau etc.
allahu nûru-s-samawati wa-l-’ardi (Q 24/35)
“Dieu est la lumière des cieux et de la terre!” (M 464)
Une autre signification du mot “nûrun” (fr.: “lumière”) est celle de
“sagesse”, “raison”, “pouvoir de compréhension en tant qu’aptitude
divine:
wa man lam yað‘al allahu nûran fa-ma la-hu min nûrin (Q 24/40)
“Celui à qui Dieu ne donne pas de lumière n’a pas de lumière.”
(M 465)
La lumière en tant que métaphore de la vie en croyance s’op-
pose aux ténèbres comme métaphore de la vie en péché:
li-yuhriða al-ladina ’amanû wa ‘amilû as-salihati min az-zulumati
’ila-n-nûr (Q 65/11)
“[...] pour faire sortir des ténèbres vers la lumière ceux qui
croient et qui accomplissent des œuvres bonnes.” (M 751)
En arabe, zulumatun (“ténèbres”), est un pluriel du nom d’une
fois zulmatun - une manifestation de l’obscurité, une obscurité. Zulu-
matun signifie, par conséquent, des “manifestations de l’obscurité”, et
au sens métaphorique, du “péché”. Tandis que l’obscurité peut exis-
ter sous de nombreuses formes, la lumière – nûrun – est singulière,
parce qu’elle représente la Vérité absolue, la Croyance en Dieu dont
la manifestation est unique (Al- Muntahab, 85). A l’appui de cette
idée, on peut citer le mystique Muqatil qui réduit ces deux méta-
phores à leur signification immédiate et abstraite, en traduisant nûrun
(lumière) par ’imanun (foi monothéiste) et zulumatun (ténèbres) par šir-
kun (polythéisme; idolâtrie) (v. Nwyia; 71).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%