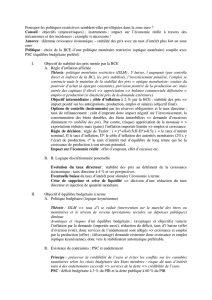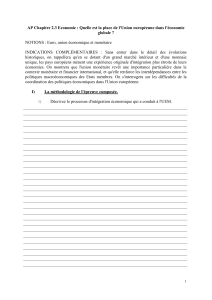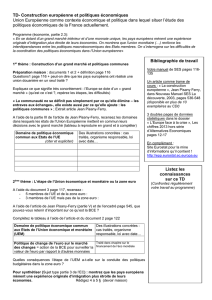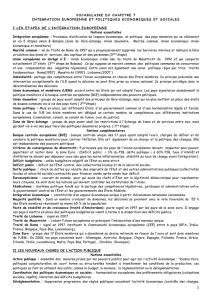SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Chapitre 4. Mondialisation, finance internationale et intégration européenne |1
Question II. Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ?
Année scolaire 2015-16 Sciences économiques Classe de Terminale
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Chapitre 4
Mondialisation, finance internationale et intégration
européenne
II. Quelle est la place de l'Union européenne dans l'économie globale ?
Introduction/sensibilisation
A. L’Union européenne, une expérience originale d’intégration
A1. Les grandes étapes de l’intégration européenne
A2. Les avantages du passage au marché unique et à l’euro
A3. Le rôle de l’union économique et monétaire dans le contexte monétaire et financier international
B. L’interdépendance au sein de l’union économique européenne : justifications et défis
B1.Les politiques conjoncturelles
B2. L’UEM renforce l’interdépendance des politiques macroéconomiques
B3. Les difficultés de coordination des politiques économiques en Europe
Objectifs
Savoirs
Savoir-faire
- En quoi l’expérience de l’UE est-elle originale ?
- L’UEM : quelle force au niveau international ?
- Pourquoi est-il si difficile de se coordonner au niveau
européen ?
- Savoir exploiter les informations contenues dans un
document
Notions à acquérir : Euro, union économique et monétaire
Notions complémentaires : Pacte de stabilité et de croissance, policy-mix, crise des dettes souveraines
Acquis de première : Banque centrale, politique budgétaire, politique monétaire, politique conjoncturelle
Que dit le programme ?
« Sans entrer dans le détail des évolutions historiques, on rappellera qu'en se dotant d'un grand marché intérieur et d'une
monnaie unique, les pays européens mènent une expérience originale d'intégration plus étroite de leurs économies. On montrera
que l'union monétaire revêt une importance particulière dans le contexte monétaire et financier international, et qu'elle renforce
les interdépendances entre les politiques macroéconomiques des États membres. On s'interrogera sur les difficultés de la
coordination des politiques économiques dans l'Union européenne. »

Chapitre 4. Mondialisation, finance internationale et intégration européenne |2
Question II. Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ?
Année scolaire 2015-16
Chapitre 4
Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
Dossier documentaire :
II. Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ?
Sensibilisation/Introduction
Document 1. PIB comparé de l’UE, des USA, du Japon et de la Chine depuis 1957
Source : Fondation Robert Schuman, Rapport 2010
La progression des échanges internationaux s'explique en partie par la régionalisation des échanges (développement des
échanges intra-régionaux). Dans toutes les régions, on constate que la part du commerce intra-régional augmente, notamment
en UE (2/3 des exportations européennes se font entre pays de l'Union européenne, moins d'un tiers des échanges de l'Europe
se fait avec le reste du monde).
Cette régionalisation des échanges a été facilitée par le processus d'intégration régionale, processus par lequel plusieurs nations
s'accordent pour faciliter les échanges entre elles, afin d'unifier progressivement leurs marchés et d'en tirer des avantages
mutuels.
A. L’Union européenne, une expérience originale d’intégration
A1. La dynamique de l’intégration
L’intégration européenne ne vise pas seulement à construire un espace économique intégré, mais aussi à construire une Europe
politique. Elle se distingue d’autres formes d’intégration régionale (ex. l’ALENA, traité de libre-échange nord-américain, qui ne
vise que la libre-circulation des biens).
Ainsi, chaque pas en avant vers une plus grande intégration économique, incite à franchir le pas suivant ; chaque crise mène à
un approfondissement, pour « sauvegarder le projet européen ».
A partir d’une simple zone de libre-échange (pas de droits de douanes entre les pays membres), on est passé à un marché
commun (libre circulation des biens, services, capitaux, personnes) et à une union économique à 27 (marché commun +
politiques communes). L’aboutissement est l’Union Economique et Monétaire (UEM), avec le passage à la monnaie unique pour
17 pays de l’UE.
Il existe donc un réel pouvoir supranational, avec des instances politiques et des politiques communes :
- Les décisions de la Commission Européenne doivent être appliquées par les Etats membres.
- Existence de politiques communes (la PAC, politique Agricole Commune, la Politique Extérieure de Sécurité Commune, les
Fonds Structurels - qui visent à aider les pays les plus en retard et certaines régions en déclin - , la Charte des Droits
fondamentaux - ensemble de normes sociales applicables dans la zone - , une politique de la concurrence - efficace dans la lutte
contre les abus de position dominante - ...).
Comment peut-on caractériser la place de l’UE par rapport à d’autres puissances économiques ?

Chapitre 4. Mondialisation, finance internationale et intégration européenne |3
Question II. Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ?
- Ces Fonds structurels ont notamment permis le rattrapage spectaculaire des pays nouvellement intégrés et la convergence des
niveaux de vie au sein de l’UE (en termes de PIB/habitant).
- Dans l’UEM, d’autres politiques communes s’ajoutent, notamment la politique monétaire menée par la BCE.
L’élargissement à 10 pays d’Europe de l’Est en 2004 (+ 2 autres en 2007) est la poursuite de ce projet européen.
Document 2. Les grandes dates de la construction européenne
Dates
Avancées dans la construction européenne
Pays membres
1957
Traité de Rome : institution de la CEE (Communauté
Economique Européenne)
- suppression des droits de douanes entre les pays
membres
- mise en place d’un tarif extérieur commun
- création de la PAC (1962)
Les 6 fondateurs : France, Allemagne, Italie,
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
1973- 1981
Europe à 9 : Danemark, Royaume-Uni, Irlande,
puis à 10 avec la Grèce
1986
Signature de l’Acte Unique Européen qui fixe la création du
Marché Unique
- Libre circulation des biens, services, capitaux et
personnes
- Transfert de compétences supplémentaires
Europe à 12 : Espagne, Portugal
1992
Le Traité de Maastricht crée l’Union Economique et
Monétaire (UEM)
- projet de création d’une monnaie unique
- projet de création d’une Banque Centrale
Européenne
- Création de la citoyenneté européenne
1995
Europe à 15 : Autriche, Finlande, Suède
2002
Mise en circulation de l’Euro
2004
Elargissement à 25 pays
Europe à 25 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque,
Slovaquie, Slovénie
2007
Elargissement à 27 pays
Europe à 27 : Bulgarie, Roumanie
2009
Traité de Lisbonne visant à renforcer les politiques communes
2010
Création du Fonds Européen de Stabilité Financière (en cas de
crise)
2013
Europe à 28 : Croatie
Une union économique et monétaire (UEM) est le regroupement de pays adoptant une monnaie unique et organisant un
espace économique intégré qui devient un marché intérieur ou marché unique
A2. Les avantages du passage au marché unique et à l’euro
i. Les atouts d’un grand marché intérieur européen
Pour les producteurs
Pour les consommateurs
Pour les Etats
- Augmentation de la taille du marché : spécialisation et économies
d’échelle
- Suppression des frontières et des réglementations différentes
transport + rapides, moins de formalités = des coûts
concurrence accrue : recherche de compétitivité-prix et hors-prix
(innovation…)
- Concurrence accrue baisse des
prix
- Suppression des droits de douanes
baisse des prix
- Plus de diversité dans les biens et
services
Augmentation du commerce
intra-européen
stimule la croissance
ii. La mise en place de l’Euro consolide l’intégration européenne : les avantages de l’Euro
- Fin de la volatilité des taux de change à l’intérieur de la zone moins d’incertitude pour les entreprises.
- Baisse des coûts (du fait de la facilité des échanges dans une même monnaie, grâce à la concurrence encore accrue,
fourniture de consommations intermédiaires au meilleur prix…).
- Plus grande transparence au niveau des prix pour les consommateurs.
- Libre circulation des capitaux (favorise le financement des entreprises et des Etats par émission de titres)
L’euro est la monnaie commune à plusieurs pays de l'Union européenne qui se substitue à leur monnaie nationale : elle devient
une monnaie unique pour tous les États qui l'adoptent.

Chapitre 4. Mondialisation, finance internationale et intégration européenne |4
Question II. Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ?
A3. Le rôle de l’UEM dans le contexte monétaire et financier international
L’UE est aujourd’hui la 1ère puissance économique mondiale (PIB de l’UE à 27) ; c’est aussi une puissance commerciale (1er
exportateur importateur mondial).
Etant donné le poids économique de l’UE, l’Euro est une monnaie globalement stable et attractive pour les investisseurs (peu de
risques de dépréciation de l’Euro, contrairement au Franc ou à la lire italienne) => attraction d’IDE et d’investissements de
portefeuille (28% des IDE mondiaux venant du reste du monde en 1980, 50% aujourd’hui).
La zone Euro est une zone de placement de l’épargne mondiale.
Lors de la crise des subprimes, l’appréciation de l’Euro a été spectaculaire (l’Euro apparut alors comme la seule alternative
crédible au dollar)
L’Euro est-elle une monnaie internationale ?
- L’Euro occupe une place importante parmi les monnaies mondiales : elle est la première monnaie en ce qui concerne les
transactions financières (le marché des obligations), et la 2ème devise des réserves de change des banques centrales, après le
dollar (30% des réserves de change des banques centrales sont libellés en Euro contre 65% en dollars).
- Toutefois, au niveau des transactions courantes, la place de l’Euro est plus limitée. Le pétrole et les matières premières sont
toujours cotés en dollars par exemple.
L’Union Européenne est un acteur majeur de la construction d’un système financier et monétaire international : elle plaide pour
un encadrement plus ferme de la finance internationale, une lutte contre les paradis fiscaux, un renforcement des règles
(néanmoins, le manque de cohésion et la concurrence fiscale entre les pays de la zone, empêche l’UE de jouer pleinement ce
rôle au niveau international).
B. L’interdépendance au sein de l’UEM : justifications et défis
B1. La difficile mise en œuvre des politiques conjoncturelles
i. Les politiques conjoncturelles
Les Etats peuvent mener des politiques structurelles, c'est-à-dire des politiques qui ont pour objectif de transformer les
structures et l’organisation de l’économie sur le long terme. Parmi celles-ci, on peut citer : la politique industrielle, de recherche,
la politique sociale, la politique de la concurrence, de formation, etc.
Mais les Etats mènent aussi des politiques conjoncturelles c'est-à-dire des politiques qui permet à l’Etat de réguler l’activité
économique selon la conjoncture : agir sur le taux de croissance, le chômage, le commerce extérieur, l’inflation, le déficit public.
Les politiques conjoncturelles sont la politique monétaire et la politique budgétaire.
La politique budgétaire est une politique économique qui utilise le budget comme levier économique : redistribution,
subventions, fiscalité, investissements publics, déficit public.
ii. L’effet des politiques conjoncturelles actives
Compléter le schéma suivant à l’aide des termes suivants : Hausse des crédits à l’économie, hausse des revenus pour les ménages et
entreprises, baisse des taux d’intérêt des banques privées, Baisse des recettes de l’Etat, résorption du déficit public, Hausse des dépenses
publiques, Hausse de la consommation et de l’investissement (x2), Baisse des taux d’intérêt de la Banque Centrale
Politique
monétaire
de relance
Hausse de la production =
croissance
Politique
budgétaire de
relance
Hausse de la
production =
croissance
Hausse des rentrées fiscales et

Chapitre 4. Mondialisation, finance internationale et intégration européenne |5
Question II. Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ?
B2. L’UEM renforce l’interdépendance des politiques macroéconomiques
i. Une politique monétaire commune
Une monnaie unique à une région du monde signifie une politique monétaire commune. En cas de divergences de taux
d’intérêt, on va assister à des guerres des taux entre Etats et l’émergence de la spéculation.
Si une Banque centrale crée de la monnaie => inflation.
Si toutes le font => inflation généralisée à toute la zone euro.
Il faut donc maîtriser la masse monétaire en circulation.
Jusqu’à la crise des dettes publiques européennes, le mandat de la BCE est uniquement la lutte contre l’inflation
L’objectif de la politique monétaire de la BCE
Le principal objectif de la BCE est de maintenir l’inflation à 2% par an dans la zone euro. Pour ce faire elle module la masse
monétaire en injectant ou prélevant des liquidités dans l’économie. La BCE va donc avoir un effet majeur sur l’activité
économique.
Pourquoi cet objectif de faible inflation ? L’inflation mine le pouvoir d’achat des ménages, si les salaires nominaux n’augmentent
pas au même rythme. L’inflation mine aussi la compétitivité des entreprises, qui peinent alors à exporter. Enfin l’inflation mine
l’attractivité des placements financiers dans la zone : un épargne placée en euro se dévalorise ce qui fait fuir les capitaux
étrangers (1 000€ placés à 5% sur un an face à une inflation de 10%, revient à une dévalorisation du rendement de l’épargne).
Depuis les années 1980, l’analyse libérale monétariste (Milton Friedman) est donc la base théorique de la politique monétaire
européenne. Si les prix sont maîtrisés, alors il y aura croissance. A l’inverse si l’on cherche à stimuler d’abord la croissance en
baissant les taux d’intérêt, alors il y aura de l’inflation, ce qui nuira finalement à la croissance.
Si l’objectif de stabilité des prix est atteint, la BCE contribue alors au soutien de l’activité en favorisant une baisse des taux
d'intérêt. Mais contrairement à la FED (La Réserve Fédérale américaine), c’est un objectif secondaire : la FED place sur un pied
d’égalité les objectifs de plein-emploi, de stabilité des prix et de taux d'intérêt faibles, elle détermine elle-même lequel est
prioritaire.
ii. Une politique budgétaire qui reste aux mains des Etats, mais qui est encadrée
Les Etats gardent l’ « arme budgétaire », c’est-à-dire qu’ils peuvent relancer l’activité économique avec le budget de l’Etat, ils
sont également maîtres de leur fiscalité. Cependant, ils n’ont pas les mains libres.
Document 3. Manuel p123 doc. 3 « Les contraintes du PSC »
Quelles sont les contraintes imposées par le PSC ?
Sans l’Euro, un Etat qui pratique un déficit excessif serait sanctionné :
Forte dépréciation => inflation
- 1er problème : perte de compétitivité et fuite des capitaux = possible crise du change
- 2ème problème : à cause de la contrainte extérieure, pas d’effet de la relance
- 3ème problème : nécessaire hausse des TI pour maîtriser l’inflation : frein à l’activité
- => Limites automatiques
Avec l’Euro, et sans garde-fous budgétaires, on aurait des comportements de passager clandestin avec effets de débordements
sur la zone.
Déficit excessif => forte dépréciation => inflation dans le pays
- mais une seule économie ne va pas créer de l’inflation dans toute la zone : donc faible inflation dans la zone
- Pas de hausse des taux d’intérêt, pas de frein à l’activité
- moins de limites
Mais si tous le font…
Milton FRIEDMAN (1912-2006)
Economiste américain, fondateur de l’ « école de Chicago » (libérale) qui s’oppose à toute intervention de l’Etat dans
l’économie, et de la théorie keynésienne de relance par la demande.
Conseiller du président Nixon à la fin des années 1980.
Il développe la théorie quantitative de la monnaie qui associe l’inflation à une trop grande quantité de monnaie dans
l’économie, et identifie le taux de chômage naturel, résultat selon entre des entreprises qui proposent des salaires trop bas
et des travailleurs demandant des salaires trop élevés.
Principaux ouvrages : Capitalisme et liberté (1962), Inflation et systèmes monétaires (1968), La monnaie et ses pièges (1992)
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%