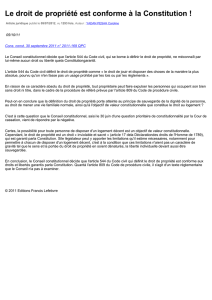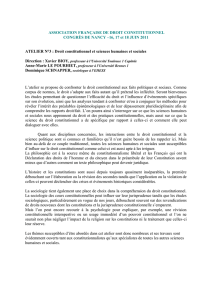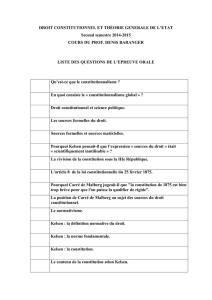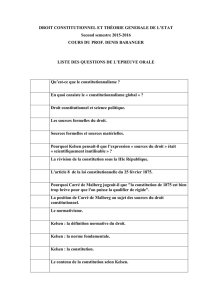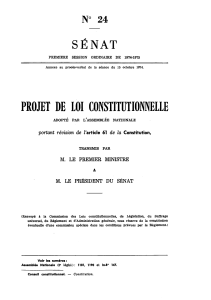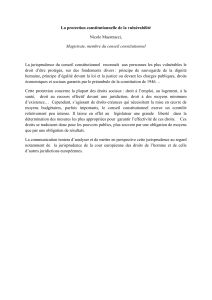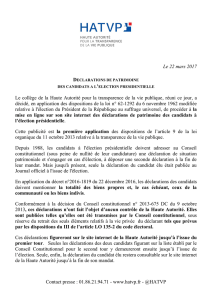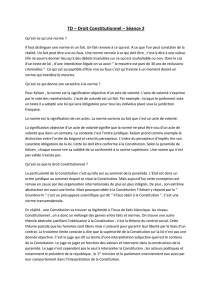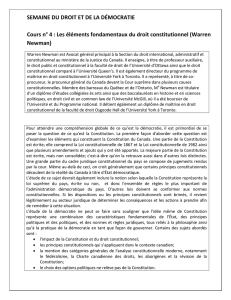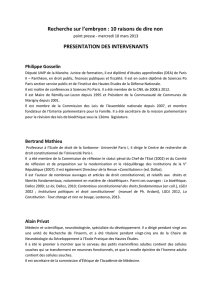Introduction au Droit constitutionnel - UFR droit

Introduction au Droit constitutionnel
Professeur : Jean-Louis Iten
TRAVAUX DIRIGES (1ER SEMESTRE)
LICENCE I (L 1)
Année universitaire 2014-2015

Université Paris 8
Introduction au Droit constitutionnel
(Semestre I)
Professeur : Jean-Louis Iten
Séance de travaux dirigés n° 1 : Présentation et méthodologie
Présentation du programme et des règles du jeu
–Séance n° 2 : La Constitution
–Séance n° 3 : La hiérarchie des normes
–Séance n° 4 : La justice constitutionnelle
–Séance n° 5 : L’État
–Séance n° 6 : La participation au pouvoir
–Séance n° 7 : Galop d'essai
–Séance n° 8 : La séparation des pouvoirs et la classification des régimes politiques
–Séance n° 9 : Les Etats-Unis d’Amérique
–Séance n° 10 : Le Royaume-Uni
–Séance n° 11 : Révisions
Explications méthodologiques :
–La préparation de la séance
–La dissertation
–Le commentaire de texte ou de jurisprudence
–Le cas pratique

Université Paris 8
Introduction au Droit constitutionnel
(Semestre I)
Professeur : Jean-Louis Iten
Séance de travaux dirigés n° 2 : La constitution
Document n° 1. Kelsen, H., Théorie pure du droit, trad. par Ch. Eisenmann,
Dalloz, 1962, pp. 299-302 (extraits).
Document n° 2. Prélot, M., Boulouis, J., Institutions politiques et droit
constitutionnel, Dalloz, 1990, pp. 28-37 (extraits).
Document n° 3. Mény, Y., « Constitutionnalisme », dans Y. Mény, O.
Duhamel, dir., Dictionnaire constitutionnel, PUF, 1992, pp. 212-213 (extraits).
Document n° 4. Rouvillois, F., Droit constitutionnel, Flammarion, coll.
« Champs Université », 2002, tome 1. Fondements et pratiques, pp. 98-102
(extraits).
Document n° 5. Beaud, O., « Constitution et constitutionnalisme », dans
P. Raynaud, S. Rials, dir., Dictionnaire de philosophie politique, PUF, 1996, pp.
117-126 (extraits).
Dissertation : La Constitution écrite (sujet 2014 session 2)

Document n° 1. Kelsen, H., Théorie pure du droit, trad. par Ch.
Eisenmann, Dalloz, 1962, pp. 299-302 (extraits).
« […]. Dans les développements précédents, on a déjà évoqué à mainte reprise cette
particularité que présente le droit de régler lui-même sa propre création. On peut
distinguer deux modalités différentes de ce règlement. Parfois, il porte uniquement sur la
procédure : des normes déterminent exclusivement la procédure selon laquelle d’autres
normes devront être créées. Parfois, il va plus loin et porte également sur le fond : des
normes déterminent – jusqu’à un certain point – le contenu, le fond d’autres normes dont
elles prévoient la création. On a déjà analysé le rapport entre les normes qui réglementent
la création d’autres normes et ces autres normes : en accord avec le caractère dynamique
de l’unité des ordres juridiques, une norme est valable si et parce qu’elle a été créée d’une
certaine façon, celle que détermine une autre norme ; cette dernière constitue ainsi le
fondement immédiat de la validité de la première. Pour exprimer la relation en question, on
peut utiliser l’image spatiale de la hiérarchie, du rapport de supériorité-subordination : la
norme qui règle la création est la norme supérieure, la norme créée conformément à ses
dispositions est la norme inférieure. L’ordre juridique n’est pas un système de normes
juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés,
une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou
couches de normes juridiques. Son unité résulte de la connexion entre éléments qui
découle du fait que la validité d’une norme qui est créée conformément à une autre norme
repose sur celle-ci ; qu’à son tour, la création de cette dernière a été elle aussi réglée par
d’autres, qui constituent à leur tour le fondement de sa validité ; et cette démarche
régressive débouche finalement sur la norme fondamentale – norme supposée. La norme
fondamentale hypothétique – en ce sens – est par conséquent le fondement de validité
suprême, qui fonde et scelle l’unité de ce système de création.
Commençons par raisonner uniquement sur les ordres juridiques étatiques. Si l’on s’en
tient aux seules normes positives, le degré suprême de ces ordres est formé par leur
Constitution. Il faut entendre ici ce terme en un sens matériel ; où il se définit : la norme
positive ou les normes positives qui règlent la création des normes juridiques générales.
La Constitution ainsi entendue peut être créée soit par la voie de coutume, soit par un acte
ayant cet objet et ayant pour auteurs un individu ou plusieurs individus, autrement dit : par
acte de législation. Dans le second cas, elle est toujours consignée dans un document ;
pour cette raison, on l’appelle une Constitution ‘écrite’ ; alors que la Constitution
coutumière est une Constitution non-écrite. Il se peut aussi qu’une Constitution au sens
matériel se compose pour partie de normes légiférées et écrites, pour partie de normes
coutumières et non-écrites. Il est également possible que les normes d’une Constitution
créée coutumièrement soient codifiées à un moment donné ; si cette codification est
l’oeuvre d’un organe de création du droit et a par suite un caractère obligatoire, la
Constitution née coutumière devient une Constitution écrite.
Le terme Constitution est pris aussi en un sens formel : la Constitution au sens formel est
un document qualifié de Constitution, qui – en tant que Constitution écrite – contient non
seulement des normes qui règlent la création des normes juridiques générales, c’est-à-
dire la législation, mais également des normes qui se rapportent à d’autres objets
politiquement importants, et, en outre, des dispositions aux termes desquelles les normes
contenues dans ce document ne peuvent pas être abrogées ou modifiées de la même
façon que les lois ordinaires, mais seulement par une procédure particulière, à des
conditions de difficulté accrue. Ces dispositions représentent la forme constitutionnelle ; en
tant que forme, cette forme constitutionnelle peut recevoir n’importe quel contenu, et elle
sert en première ligne à stabiliser les normes que l’on a appelées la Constitution
matérielle, et qui sont la base positive de l’ensemble de l’ordre juridique étatique ».

Document n° 2. Prélot, M., Boulouis, J., Institutions politiques et
droit constitutionnel, Dalloz, 1990, pp. 28-37 (extraits).
« […] Dans le langage courant, on parle de la ‘constitution’ d’un être humain ou de celle de
la matière. Si nous transposons cette notion dans le domaine des sciences sociales, nous
constaterons aisément que chaque groupe, à partir du moment où il se différencie,
possède une organisation déterminée, c’est-à-dire une certaine constitution. Celle-ci est
embryonnaire ou plus ou moins développée, mais partout elle existe. Restreindre à la
seule société politique cette notion de constitution, c’est jeter les esprits dans une
première incertitude, sinon dans une première erreur. Il y a du droit constitutionnel en deçà
et au-delà de l’Etat.
En deçà de l’Etat, il existe une constitution de la famille. L’expression est courante chez
les sociologues. Elle doit sa vogue à Le Play, mais l’idée est beaucoup plus ancienne ; elle
se trouve déjà chez Bodin. Malgré la résistance de beaucoup de juristes, dominés par les
traditions individualistes du code napoléonien, sa notion n’a pas cessé de s’imposer à
l’esprit. Il en va de même pour les sociétés commerciales, notamment pour les sociétés
anonymes. Sur ce point, les spécialistes eux-mêmes ont souligné les analogies. Par
exemple, Thaller a comparé à plusieurs reprises l’assemblée générale des sociétés
anonymes au pouvoir délibérant dans le droit constitutionnel politique ; de même, Bourcart
a insisté sur la correspondance profonde entre les différentes structures des sociétés
commerciales et les diverses constitutions des Etats. Dans le droit du travail, on constate
pareillement qu’il n’existe pas seulement, entre l’entreprise et ses membres, le lien d’un
droit contractuel, mais les obligations d’un droit constitutionnel.
Au-delà de l’Etat, l’Eglise catholique et d’autres sociétés religieuses possèdent un droit
constitutionnel dont la mise en relief est plus aisée encore. Les beaux travaux de Léo
Moulin ont montré l’influence exercée jadis par les constitutions des ordres religieux sur
les constitutions politiques. Le déroulement de Vatican II a montré le concile réinventant
peu à peu les règles de la procédure parlementaire qu’il avait d’abord cru pouvoir
dédaigner. La communauté universelle du droit des gens elle-même repose, ainsi que les
collectivités internationales plus étroitement intégrées, sur un ensemble de règles
constitutives essentielles. Georges Scelle s’est particulièrement attaché à mettre en
lumière l’existence et les caractères de ce droit constitutionnel international.
Ainsi, chaque discipline juridique connaît-elle un droit ‘constitutionnel’, produit de la
fonction organisatrice du milieu qu’elle a vocation à régir et qui se distingue d’un droit
‘relationnel’ correspondant à la fonction régulatrice des relations qui se développent dans
ce milieu ainsi organisé […]. A s’en tenir toujours à la logique des termes, le droit public
constitutionnel couvre un très vaste domaine. Il englobe l’ensemble des règles qui fondent
l’Etat dans son existence, en déterminent les formes, lui procurent ses structures et son
organisation. Or, un Etat n’est pas constitué lorsque le statut de l’autorité politique y est
seul fixé. Il ne le devient qu’à partir du moment où, par le statut des nationaux, est
circonscrite la collectivité humaine dont il est l’expression, déterminée l’organisation
administrative, établie la justice.
Cette extension du droit constitutionnel à toute la contexture de l’Etat n’est pas, comme on
l’a objecté, une vue de l’esprit ou une simple opinion. Elle correspond au contraire à une
réalité sociologique que confirme le droit positif. Sociologiquement, il existe, en effet, des
affinités étroites, des correspondances fondamentales, une solidarité institutionnelle
inévitable entre la détermination de la collectivité nationale, l’organisation politique, les
structures administratives, le statut de la justice […]. Cette conception large du droit public
constitutionnel est confirmée par le droit positif tel qu’il résulte du texte des constitutions
elles-mêmes […].
De nature contingente, la conception qui résulte […] pour le droit constitutionnel de sa
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
1
/
82
100%