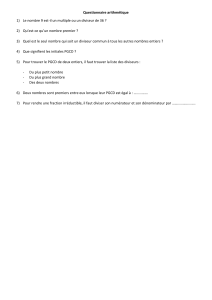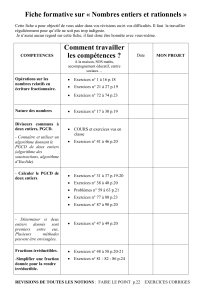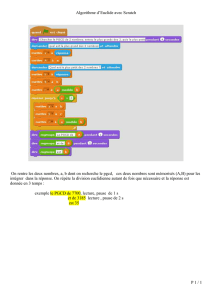Le cours de ce premier semestre est composé de deux parties

Université Paris 6, Licence FONDNATEXP, UE Maths LG308
http://www.math.jussieu.fr/~romagny/LG308
Version de Septembre 2006
Le cours de ce premier semestre est composé de deux parties principales : Arith-
métique, et Géométrie. Il est précédé de quelques notions de logique, indispensables
pour être en mesure de dépasser l’intuition et pour pouvoir faire des démonstrations.
D’ailleurs, le terme de démonstration sera l’un des maîtres mots du cours...
Ces notes doivent beaucoup au livre de Daniel Perrin intitulé Mathématiques
d’école : Nombres, mesures et géométrie, paru aux éditions Cassini. J’ai utilisé égale-
ment le livre Geometry : Euclid and beyond de Robin Hartshorne (éditions Springer).
Je remercie vivement Daniel Perrin pour m’avoir (indirectement...) procuré une ver-
sion de son texte alors qu’il était encore en préparation. Je remercie également Claire
Cazes et Frédérique Petit pour leurs relectures et commentaires.
Préliminaire : Logique et raisonnement mathématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Arithmétique ...................................................................9
Géométrie plane ...............................................................27
Annexes .......................................................................47
1

. .
Notations. Rappelons les symboles utilisés pour les ensembles de nombres usuels :
Nest l’ensemble des nombres entiers naturels,
Zest l’ensemble des nombres entiers relatifs,
Qest l’ensemble des nombres rationnels (les fractions),
Rest l’ensemble des nombres réels,
Cest l’ensemble des nombres complexes.
2

. .
Préliminaire :
Logique et raisonnement mathématique
3

4

Logique et raisonnement mathématique
La logique s’intéresse d’une part aux règles de construction des phrases mathématiques,
d’autre part à leur vérité.
Soit Xun ensemble. Un énoncé, ou une proposition, est une phrase mathématique
dépendant des éléments de X. Un énoncé peut avoir deux valeurs, dépendant des éléments
de X:vrai ou faux (1 ou 0).
On associe à chaque énoncé Pla partie de Xdes éléments tels que Pest vrai.
Exemple : pour l’énoncé « x≥3» la partie correspondante de Rest [3; +∞[.
Par définition, si cette partie est Xtout entier l’énoncé « ∀x∈X, P (x)» est vrai.
De même, si cette partie n’est pas vide, l’énoncé « ∃x∈X, P (x)» est vrai.
Correspondance entre connecteurs logiques et opérations ensemblistes :
Logique Ensemble Symbole
P
non PeP
Pou Q P ∨Q
Pet Q P ∧Q
Pimplique Q
= (eP) ou Q
P⇒Q
=(eP)∨Q
Péquivaut à Q
=(Pimplique Q)
et (Qimplique P)
P⇔Q
=...
Complétez par vous-mêmes la deuxième colonne en dessinant l’interprétation ensemb-
liste de chaque connecteur : si la partie de Xdes éléments tels que Pest vrai est notée A,
et celle associée de même à Qest notée B, alors la partie associée à Pou Qest...
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
1
/
54
100%