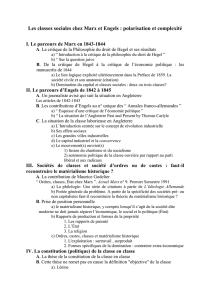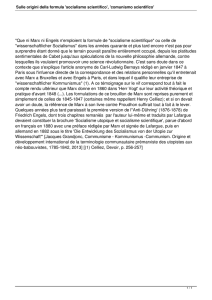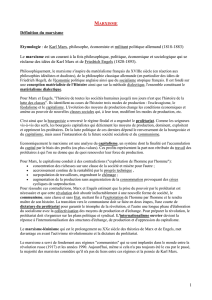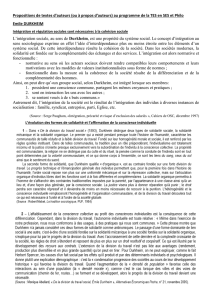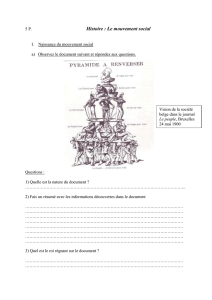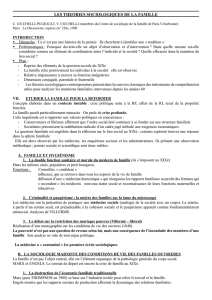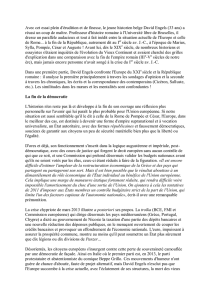« Le concept de travail chez Friedrich Engels et ses implications

« Le concept de travail chez Friedrich Engels
et ses implications éthiques et politiques »
par Ragip EGE
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA – Theme)
Université Louis Pasteur de Strasbourg
in Le travail en question : XVIIIe – XXe siècles
Textes réunis et présentés par C. LAVIALLE
Presses Universitaires François Rabelais, 2011, pp.179-194
Résumé
Dans l’œuvre d’Engels le travail jouit d’une valeur ontologique infinie ; cette exaltation du travail
conduit l’auteur jusqu’à affirmer que « le travail a créé l’homme ». Une telle conception du travail
s’inspire essentiellement de la philosophie spéculative hégélienne qui conçoit le travail comme
l’essence même de l’homme. Le présent article s’efforce d’identifier et d’analyser, dans un premier
temps, les arguments d’ordre épistémologique qui conduisent Engels à imputer une valeur aussi
élevée au concept de travail. Dans un second temps, nous nous interrogeons sur les implications
éthiques et politiques de cette vision hypertrophiée du travail. En effet, la conception du réel comme
un processus ininterrompu de transformation, comme pur mouvement, a marqué toute l’histoire du
marxisme.
Abstract
In the work of Engels labour enjoys an infinite ontological value; this glorification of labour carries
the author to the point of asserting that “labour created man himself”. Such a conception of labour
draws its inspiration essentially from Hegelian speculative philosophy which considers labour as the
essence of man. First we try to identify and analyze epistemological arguments which lead Engels to
attribute such a huge value to the concept of labour. Secondly, we examine ethical and political
implications of this overdeveloped vision of labour. In fact, the understanding of reality as an
interrupted process of transformation, as a pure movement, left its mark on the whole history of

Marxism.
Introduction
Dans Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme Friedrich Engels écrit:
« Le travail, disent les économistes, est la source de toute richesse. Il l’est
effectivement (…) Mais il est infiniment plus encore. Il est la condition fondamentale
(Grundbedingung) première de toute vie humaine, et il l’est à un point tel que, dans un
certain sens, il nous faut dire : le travail a créé l’homme lui-même (sie hat den Menschen
selbst geschaffen) » (Engels 1876, p.171 ; orig. p.444).
Ce jugement d’Engels traduit la valeur ontologique que particulièrement les penseurs du 19ème siècle
ont conférée au travail, voyant en ce dernier la dimension fondamentale, l’essence même de l’homme.
Nous savons qu’Engels comme Marx et comme beaucoup d’autres jeunes philosophes et intellectuels
de langue allemande de l’époque, a été un fervent lecteur, très attentif, de Hegel. C’est à partir de
Hegel, sur la base d’une accumulation philosophique intégrant le système dialectique de l’auteur de la
Phénoménologie de l’esprit qu’Engels pense le monde. “Intégration” ne veut évidemment pas dire
“adhésion” ou “adoption”. Mais quelles que soient les distances critiques que l’auteur est amenées à
prendre à l’égard de la philosophie hégélienne et quelles que soient les méfiances qu’il peut exprimer
à l’égard de l’idéalisme de la dialectique hégélienne, ses interventions (intellectuelles ou politiques)
dans le monde supposent fondamentalement la lecture de Hegel, c’est-à-dire l’éducation, la Bildung,
qu’il a pu acquérir au contact de l’œuvre exigeante de Hegel. Et au 19ème siècle c’est sans aucun doute
Hegel qui a le plus rigoureusement contribué à cette valorisation infinie de l’activité créatrice,
productrice et reproductrice de l’homme à travers son travail. Dans un premier temps nous nous
arrêterons sur le moment hégélien et nous nous interrogerons sur la signification de l’immense valeur
que reconnaît Hegel au travail (I). Nous retournerons ensuite aux arguments d’Engels relatifs à la
justification de cette valorisation ontologique infinie du travail (II). Les problèmes d’ordre logique
que pose cette argumentation nous donneront l’occasion de nous interroger sur les implications
éthiques et politiques d’une telle définition de l’homme (III).

1. LE TRAVAIL CHEZ HEGEL
Quelques trente deux ans avant la remarque d’Engels citée plus haut, Marx écrivait dans les
Manuscrits parisiens de 1844 :
« L’immense mérite de la Phénoménologie de Hegel et de son résultat final - la
dialectique de la négativité comme principe moteur et créateur - consiste tout d’abord
en ceci : Hegel conçoit l’homme, l’autocréation (die Selbsterzeugung des Menschen)
comme un processus, l’objectification (Vergegenständlichung) comme négation de
l’objectification (Entgegenständlichung), comme aliénation (Entäußerung) et suppression
de cette aliénation ; de la sorte il saisit la nature (Wesen) du travail, et conçoit
l’homme objectif (gegenständlich), véritable, parce que réel, comme résultat de son
propre travail (als Resultat seiner eignen Arbeit) » (Marx 1844, p.125-126, orig., p.574)
Le concept majeur de ce passage est la notion d’autocréation (Selbsterzeugung). L’homme ne se
contente pas simplement de produire des objets d’utilité en vue de satisfaire des besoins particuliers et
limités, mais se comporte à l’égard de la nature et de lui-même comme à son propre objet. Grâce à
son travail, à travers son activité productrice, l’homme sait réanimer, si l’on peut dire, la totalité de la
matière, de l’« étant », et par là il sait se reproduire comme être universel, comme « être générique »
(Gattungswesen) -pour utiliser un terme qui revient abondamment dans les Manuscrits parisiens et
qui a été popularisé dans les années 1840 par Feuerbach. La nature de l’homme, son essence (das
Wesen) ne réside point dans sa capacité à porter quelques modifications limitées et éphémères sur la
surface de la terre mais dans son pouvoir d’humaniser et d’historiciser la nature par son activité de
production : l’homme réanime et reproduit la nature à son image dans son travail. Si l’essence de
l’homme se définit par le travail, c’est parce que la vocation de l’homme est ainsi dessinée qu’il doit
soumettre la nature, intégralement, à sa volonté. C’est en établissant sa domination et son règne
absolus sur la terre qu’il se reconnaîtra comme être générique, universel, c’est-à-dire libre.
Cette vision de l’homme conçu comme un être dont l’essence se révèle dans son travail, par la
mobilisation toujours plus perfectionnée des instruments de production en vue de la maîtrise
progressive et intégrale de la nature -que Papaioannou qualifie de métaphysique « barbare »
(Papaioannou 1983, p.82)-, s’élabore dans la section « Indépendance et dépendance de la conscience
de soi : domination et servitude (Selbständigkeit und Unselbstaändigkeit des Selbstbewusstseins : Herrshaft und
Knechtschaft » de la Phénoménologie de l’esprit. Ce passage, popularisé en France essentiellement par
les soins de Kojève sous l’appellation de « Dialectique du maître et de l’esclave », constitue le
moment où la définition que nous appelons « technocratique » de l’homme (qui est également celle
d’Engels) est le plus rigoureusement formulée.

"La conscience de soi (Selbstbewusstsein) atteint sa satisfaction (Befriedigung) seulement dans une
autre conscience de soi" (Hegel 1807, p.153 ; orig. P.143). Cette satisfaction consiste à transformer la
simple certitude subjective (Gewissheit) de soi-même en vérité (Wahrheit). Ce dont la conscience fait
l'expérience, sous une forme immédiate dans la perception et dans le besoin doit être reconnu par une
autre conscience. La conscience devient consciente de soi lorsqu'elle sort d’elle-même vers une autre
conscience pour faire retour sur soi-même à partir de cet être autre. Dans le besoin et à un degré
supérieur dans la perception, la conscience ne vit ce mouvement, ce retour sur soi par l'être autre, que
sous la forme de sensation, laquelle s'évanouit immédiatement avec la disparition (la consommation)
de l'objet. La conscience de soi est par conséquent, essentiellement, un être de désir. Dans le désir le
mouvement sur soi-même de la conscience ne se médiatise plus par un objet mais par un autre être de
désir. La conscience trouve sa vérité et devient conscience de soi dans le désir de l'autre car le désir
qui porte sur un autre désir (et non plus sur un objet ou une réalité finis) conserve la médiation dans le
temps : "1’histoire humaine est l'histoire des désirs désirés" dit Kojève (1947, p.13). Le "désir
anthropogène" est toujours un désir de reconnaissance. Ce n'est que si l'être autre me reconnaît dans
mon humanité, c'est-à-dire en tant que liberté pure au-delà de toute détermination extérieure par un
être-là quelconque, que je peux transformer ma certitude subjective en vérité objective. Les deux
consciences de soi se présentent donc face à face comme pure "négation de leur manière d'être
objective (reine Negation [ihrer] gegenständlichen Weise) » ; ceci consiste à montrer qu’
« on n'est attaché à aucun être-là déterminé, pas plus qu'à la singularité universelle de
l'être-là en général (die allgemeine Einzelheit des Daseins), à montrer qu'on n'est pas
attaché à la vie" (Hegel 1807, p.159 ; orig. p.148).
La lutte pour la vie ou pour la mort s'engage : les deux opposants face à face sont prêts à aller jusqu'au
bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort tant qu'ils ne s'accordent pas mutuellement leur reconnaissance. Si les
deux consciences de soi sont absolument déterminées dans leur quête de reconnaissance la lutte
s'achève évidemment par leur destruction pure et simple. Mais il arrive que l'une d'elles éprouve la
peur, non au sujet de tel ou tel être-là mais la peur de mourir et de supprimer, précisément, avec la
mort, la vérité qui devait sortir de cette lutte. Alors elle préfère conserver la vie (servus) ; mais cette
manifestation de dépendance à l'égard de la vie, c'est-à-dire à l’égard de l`être-là en général équivaut à
la victoire de l'autre puisque celle-ci ne craint nullement l'issue de la lutte. L'une des consciences de
soi devient esclave, l'autre maître. L'esclave reconnaît bien le maître mais celui-ci ne reconnaît pas
l'esclave et cette inégalité prouve que ni l'un ni l'autre n'ont pu atteindre la satisfaction dans leur désir.
Car l'esclave a reconnu une conscience de soi qui refuse de lui accorder la sienne ; le maître a bien

obtenu une reconnaissance mais celle-ci n'est en rien l’acte d'une conscience de soi libre. L’esclave se
met à travailler au service du maître ; ayant différé sa propre jouissance, il commence à transformer
l'être-là pour la jouissance du maître :
"Le travail (…) est désir réfréné (gehemmte Begierde), disparition retardée (aufgehaltenes
Verschwinden) : le travail forme (sie bildet). Le rapport négatif à l'objet devient forme
(Form) de cet objet même, il devient quelque chose de permanent (Bleibende), puisque
justement à l'égard du travailleur, l'objet a une indépendance (Selbständigkeit)" (ibid.,
p.165 ; orig. p.153-54).
Le rapport, à l'origine purement négatif, qui s'instaure, dans le travail forcé, à l'égard de la chose,
apparaît progressivement comme le chemin même de la libération de l'esclave. En effet, en
transformant l'être-là, le monde, la nature, l'esclave lui imprime sa propre subjectivité; l'intériorité de
l'esclave acquiert ainsi "une subsistance et une permanence" (Hyppolite 1946, p.170) dans le produit
du travail :
"Cet être pour soi (Fürsichsein des Bewusstseins) dans le travail s'extériorise lui-même et
passe dans l'élément de la permanence (Element des Bleibens) ; la conscience travaillante
(arbeitende Bewusstsein) en vient ainsi à l'intuition (Anschauung) de l'être indépendant
comme intuition de soi-même" (Hegel 1807, p.165 ; orig., p.154).
L'esclave avait tremblé dans tout son être devant la mort, c'est-à-dire devant la perspective
d'une perte absolue de l'être-là, du monde. Il s'était, par conséquent, rendu esclave de la vie. Or, dans
le travail, il s'affranchit progressivement de cet esclavage en transformant l'être-là à son image.
L'indépendance de l'esclave s'obtient donc par la réanimation, la maîtrise et l'appropriation de la
totalité de l'être-là. Ceci réalisé, l'esclave n'aura nul besoin de la reconnaissance du maître puisqu'il
pourra désormais se contempler dans le produit de son travail, et reconnaître son être-pour-soi dans le
monde devenu sa propre œuvre :
"Le Maître ne peut jamais se détacher du Monde où il vit, et si ce Monde périt, il
périt avec lui. Seul l'Esclave peut transcender le Monde donné (asservi au Maître) et
ne pas périr. Seul l'Esclave peut transformer le Monde qui le forme et le fixe dans la
servitude, et créer un Monde formé par lui où il sera libre" (Kojève 1947, p.34).
Dans les Manuscrits parisiens Marx loue chez Hegel, comme nous l’avons rappelé plus haut, cette
conception du travail en tant qu'objectivation et réalisation de l'homme ; Hegel, dit Marx, « conçoit le
travail comme l'essence (Wesen), l’affirmation de sa nature (bewährende Wesen - l'essence avérée) de
l'homme » (Marx 1844, p.126 ; orig., p.574). L'homme libre est son travail ; il est le produit de son
travail ; il n'est libre que dans un monde entièrement réanimé et reproduit par son travail.
Si nous avons tenu à présenter ce récit anecdotique qui est à l’évidence fortement réducteur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%