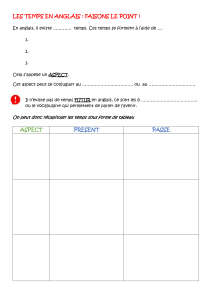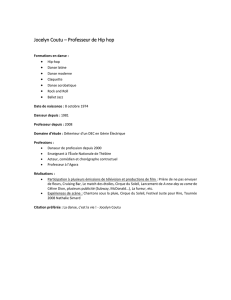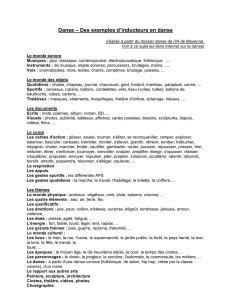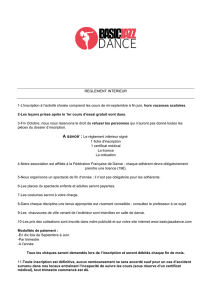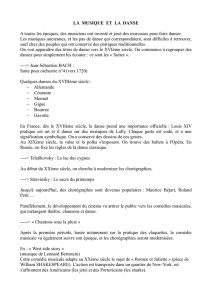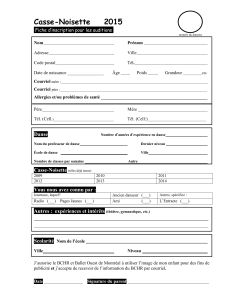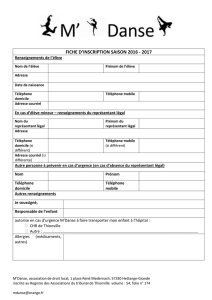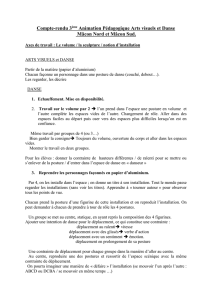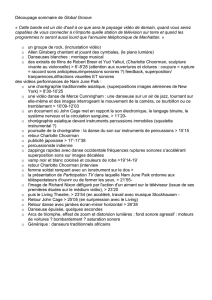La danse, art du corps engagé

La danse, art du corps engagé, et la question de son autonomie par
Catherine Kintzler le 20 août 2009
L’histoire relativement récente de la danse moderne et contemporaine peut
être présentée comme un mouvement d’émancipation de la danse qui la sort
du statut d'art subordonné auquel elle fut longtemps assujettie. On pourrait
caractériser ce mouvement comme une histoire du rapport de l’intériorité du
corps à lui-même : celle de l’avènement d’un corps réflexif. On s'attache ici à
en examiner quelques figures et à montrer que leur interprétation
philosophique, à deux belles exceptions près, débouche sur des paradoxes.
Sommaire de l'article :
1 Le paradoxe de Cahusac
2 L'autonomie enfin conquise : l'âme du corps
3 Le modèle phénoménologique
4 Le système des beaux-arts et le parti-pris cosmologique
5 Art du corps engagé et objet inouï ajouté au monde Le temps second et le
paradoxe de Hegel
6 Alain et Gilson : Aucun possible n'est beau, seul le réel est beau
7 La pulsion ontologico-cosmologique de l'artiste La poétique du corps : une leçon
de politesse que l'extérieur donne à l'intérieur
8 Notes
9 Références
1 – Le paradoxe de Cahusac
Dans son Traité historique de la danse (1) et ses articles pour l’Encyclopédie, Louis
de Cahusac expose un paradoxe qui hante la danse et dans lequel, contrairement
aux apparences, elle semble toujours prise à tel point qu'on peut se demander s'il est
constitutif.
Ce paradoxe est celui d’un art subordonné, mis sous tutelle, en l’occurrence la tutelle
du théâtre et de la musique. La question de l'autonomie de la danse se pose de
façon particulièrement virulente dans l’opéra français de l’âge classique. En effet, la
danse y figure de façon obligatoire – on ne conçoit pas un opéra sans danse - , et le
problème est de montrer que cette obligation est aussi une nécessité. La danse
n’intervient pas dans l’opéra uniquement parce que le public l’exige, ce n’est pas un
pur divertissement superflu: elle contribue de façon substantielle à l’action théâtrale
de sorte qu’on ne pourrait pas la retrancher sans dommage pour la conduite de
l’ouvrage. Ainsi la danse conquiert une place majeure dans l’opéra et grâce à lui,
mais le paradoxe est que cette conquête s’effectue sous la tutelle du théâtre. L’une
des thèses de Cahusac est que l’invention de la tragédie lyrique par Quinault et Lully
a paradoxalement révélé la danse à elle-même!: elle fait voir la puissance de la
danse, elle montre de quoi la danse est capable. Je ne reviendrai pas sur le détail de
l’argumentation (2), mais je rappellerai que l’un des points forts, au-delà de la
participation de la danse à l’action dramatique elle-même, est la présence du
merveilleux dans cet opéra. La danse ne se contente pas de contribuer à l’action,
elle donne un corps sensible au merveilleux (ce que fait aussi la musique) et elle fait
évoluer les corps dans un merveilleux de représentation auquel elle donne un monde
physique avec un haut et un bas, des appuis, une gravité.
En d’autres termes, l’art chorégraphique ne se trouve vraiment qu’en effectuant une
sortie, un « hors de soi » : c’est le détour par une forme de théâtre qui le révèle sans
pour autant le libérer puisque cette révélation reste sous la condition de son
assujettissement. J’emploie ici à dessein l’expression « art chorégraphique »,
entendant par là l’effectuation réelle de la danse sous la forme d’une œuvre destinée
à être vue par d’autres que les danseurs. Nous sommes, aujourd’hui, immédiatement

tentés de dissocier « la danse » et la notion de cet art chorégraphique, précisément
pour indiquer le chemin parcouru par la danse et pour dire que la conquête de son
autonomie a fini par s’accomplir, laissant loin derrière elle le moment où lelle restait
tributaire d’une narration, d’une dramatisation et du rôle symbolique ou expressif qui,
en la fixant au théâtre, l’éloignait d’elle-même.
Ainsi, l’histoire de la danse moderne et contemporaine délivre la danse, la rend à
elle-même et mettrait le paradoxe de Cahusac à une distance préhistorique... Je
voudrais examiner d’abord ce grand mouvement d’émancipation qu’a déployé la
danse durant tout le siècle dernier, et essayer de le traduire en termes
philosophiques : celui de l’avènement d’un corps réflexif et celui de cet avènement
comme temps second, comme re-naissance et secondarité.
C’est en réfléchissant sur cette secondarité que je m’interrogerai sur la manière dont
la philosophie classique et contemporaine s’en empare. Ce parcours nous fera
rencontrer la phénoménologie de la fin du XXe siècle, mais il ne sera pas inutile de
rappeler la réticence de Hegel à traiter la question de la danse, alors même que son
Esthétique semble particulièrement adéquate pour le faire. Je reviendrai alors au
paradoxe de Cahusac en le réinterprétant, avec un détour que je considère comme
essentiel par des philosophes qui ont consacré un développement spécifique à la
danse comme œuvre chorégraphique et comme effectuation seconde et auxquels,
peut-être pour cette raison, on ne s’intéresse que peu!lorsqu’il s’agit de penser la
danse : Alain et Etienne Gilson.
2 – L’autonomie enfin conquise. L’âme du corps.
L’histoire relativement récente de la danse moderne et contemporaine se présente
comme un mouvement remarquable d’émancipation de la danse qui semble-t-il la
place hors de portée du paradoxe de Cahusac dont on vient de faire état. Loin de
vouloir retracer les étapes et les figures de cette émancipation, je me contenterai
d’en donner quelques exemples et d’en proposer une lecture philosophique
sommaire. On pourrait la caractériser globalement comme l’histoire du rapport de
l’intériorité du corps à lui-même : celle de l’avènement d’un corps réflexif.
En libérant le geste du symbole, de la narration, de la dramatisation, de l’analogie et
même de la musicalisation, la danse moderne et contemporaine, dès les premières
années du XXe siècle, opère une profonde modification qui rend le corps à lui-même
et l’affranchit d’un rapport extérieur à ce qui n’est pas lui. L’effet décrit, quelle que
soit la technique (ou l’absence de technique), quelle que soit la tendance esthétique,
est celui d’un corps radicalisé par une sorte de réforme. J’emploie « radicalisé » au
sens strict : à la fois souligné, rehaussé, et ramené à un en-deçà de sa présentation
ordinaire – un corps débarrassé de ses oripeaux gestuels ordinaires, y compris de
ceux qu’ont déposés à sa surface les techniques traditionnelles de la danse. C’est
pourquoi le paradigme de la nudité revient si souvent s’agissant de la danse du XXe
siècle.
Dans sa Poétique de la danse contemporaine, Laurence Louppe propose plusieurs
formules cernant cette remontée vers un corps enfin dénudé, et comme réapparu à
lui-même. Elle souligne à maintes reprises que ce reflux peut aussi se dire en termes
d’autosuffisance!:
Le danseur ne dispose de rien d’extérieur ou de supplémentaire à la maîtrise de soi.
Il ne modifie rien, ne capture rien sur les objets du monde, même s’il entre avec eux
en relation. La danse moderne sera cet art essentiellement et volontairement
démuni. (Bruxelles!: Contredanse, p. 44 édition de 2004).
Elle écrivait déjà dans l’Avant-propos à l’ouvrage Que dit le corps ?(3)!:

A l'origine de la danse contemporaine dès la fin du XIXe siècle, il y a l'idée que le
corps n'est pas seulement un objet de savoir, mais qu'il pourrait devenir le sujet de
sa propre instrumentation cognitive. [....] Je dirais qu'au départ la révolution de la
danse contemporaine n'a pas été d'instaurer un nouvel art chorégraphique, mais un
corps comme lieu d'expérience et lieu de savoir. Cette révolution permit d'affirmer
que le corps peut développer sa propre énonciation par rapport à lui-même et par
rapport au monde.
Méditées et écrites avec soin, ces formulations sont philosophiquement fortes. Le
corps de la danse y apparaît (ou plutôt y réapparaît) comme une autosuffisance de
nature spéculative : n’ayant affaire qu’à lui-même, son action se pense comme
autoaffection sur le mode de la réflexivité. Le corps de la danse contemporaine est
un surcorps, ou un hypercorps « capable de développer sa propre énonciation » et
cette énonciation n’a pas d’autre objet que lui-même.
Pour parvenir à ce degré de réflexivité, le parcours est celui d’un « dénuement », une
opération de déblaiement qui ôte les obstacles par opposition à l’opération
traditionnelle de la danse qui semble plutôt accabler le corps de techniques
supplémentaires, sans parler du fardeau extérieur dont le chargeaient la musique et
le théâtre.
Dans ce périple, la danse moderne et contemporaine ne contredit pas vraiment la
danse qui la précède : elle en révèle le moment vrai, elle révèle que toute danse a
toujours voulu réinventer le corps et lui rendre son dû, que toute danse a toujours
visé le moment vrai du corps dissimulé par les couches successives de « techniques
du corps » qui sont à notre corps ce que le préjugé est à notre entendement.
Dans un article intitulé « Sensation, analyse et intuition: les techniques de
conscience du corps » (4), Benoît Lesage décrit sous le terme de « techniques de
conscience du corps » l’opposé de ce que Marcel Mauss a caractérisé comme les
techniques du corps au sens sociologique. Les techniques de conscience du corps
pratiquées par les pionniers de la danse moderne et par leurs successeurs visent à
une réappropriation du corps par lui-même, laquelle passe non pas par l’acquisition
d’une maîtrise gestuelle, mais d’abord par un nettoyage qui renvoie le corps à un
état antérieur, non perturbé par le geste acquis. Il n’est question, quelle que soit la
technique envisagée, que de « supprimer des schémas aberrants », de « réveiller »
un moment enfoui en le « conscientisant ».
Ce mouvement de renaissance du corps à lui-même consiste bien à débarrasser la
danse de tout ce qui l’entravait. La notion même de geste, comme forme a priori qui
s’échappe vers une finalité extérieure, est mise en question, ainsi que l’expose
Isabelle Launay dans un article intitulé « La danse entre geste et mouvement » (5)
où elle examine notamment la démarche de Merce Cunningham comme une
radicalisation qui, à la recherche d’un corps pur et initial, tente aussi d’évacuer toute
subjectivité et parvient à une sorte de « logique formelle » sans auteur ni sujet,
dépolarisée de l’adresse au spectateur!:
Cunningham recherche une forme de mouvement pur : ‘J’aime les mouvements
purs, complètement clairs, et je tente toujours d’amener la danse vers le plus haut
degré de ce que je considère comme la pureté. Poignets, coudes, épaules, tout doit
n’être qu’un. Le geste comme mouvement particulier d’une partie du corps est ici
refusé ; le mouvement est toujours du corps entier. Le danseur doit s’efforcer de
suivre la logique interne du mouvement sans y introduire d’intention. La danse n’est
donc pas ‘dirigée vers le spectateur ni faite pour lui. Elle lui est simplement
présentée en vue d’affiner sa perception’. Cunningham utilise pourtant nombre de
gestes quotidiens mais ils sont déconnectés de leur sens et de leur finalité ; ils sont
tous mis sur le même plan logique du mouvement. Le geste n’existe plus, il est fondu

dans le mouvement.
Une comparaison avec l’histoire de l’art moderne et contemporain s’impose alors
comme l’histoire de la quête de leur moment constituant et initial. Quête qui passe
d’abord par une sorte de surabondance d’appareillages, puis qui reflue vers la
raréfaction et le dénuement : alors que l’art classique s’empare, l’art moderne et
contemporain se désempare, mais l’objet de la quête est comparable.
Pour entendre les sons en tant qu’ils se constituent en musique, il était nécessaire
d’abord de produire des sons inouïs tels que les émettent les instruments de
musique traditionnels : solution universellement répandue, comparable à la figuration
en peinture qui ne se donne pas comme réplique du réel mais comme sa
représentation. Ensuite, une fois ces systèmes installés et émoussés, privés de leur
tranchant réformateur et troublant, il fallut en malmener l’évidence, en s’écartant par
exemple des marches harmoniques admises, en récusant le système des couleurs
comme le firent les Fauves, en « touchant au vers ». Enfin, après avoir parcouru le
champ en rupture avec l’évidence des systèmes ordinairement et universellement
admis, il restait, pour la musique, à se tourner vers l’univers délaissé du bruit, et à le
reconstituer en l’absorbant dans le monde musical. Il restait, pour la peinture, à se
tourner vers l’abolition de toute technique, de tout « métier » de tout ce qui, selon
Duchamp, « sent la térébenthine », et à exhiber, d’une part l’élémentarité des formes
atomiques du visible (ligne droite, monochrome), d’autre part à inventer le ready-
made, qui donne à voir ce qu’il y a à voir et vers les sérigraphies, qui nous mettent
devant la nullité de notre vision. Après avoir parlé en alexandrins, après avoir dit au
fruit doré « mais tu n’es qu’une poire », après avoir disloqué le vers, il restait, pour la
littérature – mais n’est-ce pas ce qu’elle a toujours fait ? – à absorber la langue
quotidienne, à récuser la linéarité du récit, à récuser tout récit.
Revenons à la danse. Après avoir organisé le mouvement militaire et celui des
rassemblements festifs et religieux en formes fixes, après avoir découvert la danse
en action comme art de théâtre et d’imitation, après avoir codifié les genres et les
pas, avoir numéroté les positions, après avoir installé le danseur dans un tranquille,
quoique pénible, exercice à la barre, après l’avoir abrité sous le bouclier de la
technique, après l’en avoir libéré, après l’avoir exposé aux ruptures et aux
dislocations, après avoir congédié le théâtre et réduit la musique à un état auxiliaire,
il restait à la danse à se retrouver comme art de la maladresse, à se tourner vers
mouvement quotidien, et finalement, pourquoi pas, ou plutôt inévitablement – le
corps étant passé par tous ses états - , à ne plus danser et à se dessaisir
complètement…
On ne peut que rester admiratif devant ce parcours de dénuement, cette espèce de
passion où la danse se défait de ses oripeaux, renonce à ses strass et à ses
virtuosités, se réforme pour se retrouver elle-même et faire du corps à la fois l’agent
et l’objet « de sa propre énonciation ». Il a même quelque chose de comique, au
sens émerveillé qu’exhibe le clown auguste entrant dans l’arène et redécouvrant le
monde comme étrange, redécouverte que nous trouvons drôle précisément parce
que nous n’osons pas l’effectuer nous-mêmes. C’est ce qui explique peut-être que la
danse contemporaine se tourne parfois, pour cette purgation, vers la caricature, le
grossissement du trait ayant la même vertu que son abolition- voir Pina Bausch.
C’est aussi peut-être ce qui explique que le spectateur sort de la salle avec un
sentiment de trouble : et si mon corps, une fois dépouillé de ce qui n’est pas lui,
n’avait pas d’âme ? Mais c'est aussi un itinéraire de déréliction qui se solde bien
souvent par une raréfaction et une désertification...

3 – Le modèle phénoménologique
Cette émergence d’un corps réflexif agent-objet de la danse est déjà en elle-même
un objet philosophique. Il n’est donc pas étonnant que le discours philosophique s’en
soit emparé tout particulièrement à la fin du XXe siècle et aujourd’hui. Mon propos
n’est pas de passer en revue tous les modèles philosophiques actuellement en
vigueur, mais d’en examiner d'abord un qui semble prédominant et de m’interroger
sur son apparente adéquation avec l’idée d’un corps réflexif. M’inspirant d’une thèse
développée par Frédéric Pouillaude (6), je me demanderai si cette adéquation,
s’accomplissant au profit du « danser » ne perd pas de ce fait la danse comme objet
chorégraphique – ou encore comme œuvre, ou encore, pour recourir aux mots
tabous, comme l’un des beaux-arts. J'évoquerai alors d'autres positions
phillosophiques.
On ne peut évoquer ces positions philosophiques sans citer d’abord l’ouvrage récent
de Véronique Fabbri Danse et philosophie. Une pensée en construction (Paris :
L’Harmattan, 2007). Le modèle qu’elle propose, tourné vers une poétique du langage
comme construction non systématique, s’intéresse surtout à l’articulation des forces
et fait de l’acte un concept central, s’inspirant, au-delà d’Aristote, de Deleuze!: en
allant vite, on pourrait dire qu’il s’agit d’une philosophie de la danse comme
dynamique. V. Fabbri s’interroge plus sur une question horizontale tendant à
dégager des appareillages communs entre danse et philosophie que sur la question
classique de genèse philosophique qui m’intéresse ici.
C’est tout naturellement, pourrait-on dire, du côté de la phénoménologie de langue
française qu’on trouve sans doute l’intérêt le plus fort et l’outillage le plus approprié
pour la question de la réflexivité sensible, ce moment critique où le corps s’élève à
sa propre dimension spéculative. Il est évident que la réflexion de Merleau-Ponty sur
la chair et le toucher, sur la dualité indissociable du « senti-sentant » ne pouvait que
convenir à un tel objet et s’offre de manière quasi inévitable à qui veut méditer sur le
dénuement et la renaissance dont j’ai parlé.
Dans ce dispositif, le grand article de Renaud Barbaras « Sentir et faire. La
phénoménologie et l’unité de l’esthétique » publié en 1998 (7) est un des textes les
plus intéressants, non seulement parce qu’il s’inscrit dans la perspective
phénoménologique issue de Merleau-Ponty et qu’il propose des vues profondes et
pertinentes sur la danse, mais aussi et surtout parce qu’il prolonge cette perspective
en la critiquant, précisément parce qu’il réfléchit sur la danse. R. Barbaras rappelle
en quoi la phénoménologie s’attache à « traiter la manière d’apparaître des choses
comme un problème autonome », ce qui la place de manière incontestablement
favorable pour réfléchir sur l’opération esthétique, laquelle suppose une
désindicialisation et une réintensification du moment perceptif que Valéry avait déjà
développées et pour lesquelles il propose l’heureuse formule : « s’attarder dans la
perception » (8), désignant par là un processus par lequel la sensation finit par se
nourrir d’elle-même.
Or c’est justement sur une relecture et une méditation de Valéry que R. Barbaras
commence par fonder la critique qu’il adresse à Merleau-Ponty. Il lui reproche de ne
pas être resté suffisamment au plus près du « profond entrelacement entre la vie
perceptive et l’activité créatrice de l’art », d’avoir court-circuité le moment
spécifiquement sensible pour décrire l’opération esthétique comme dévoilement d’un
sens : l’élément sensible n’est pas suffisamment mis en avant, ou il ne l’est que
comme un moyen de décrire l’unité de sens entre perception et activité artistique. En
reprenant les textes de Valéry, R. Barbaras s’attache à refonder cette unité dans un
« sentir » et avance la thèse d’une articulation fondamentale entre l’expérience du
« sentir » et l’expérience esthétique. Le sentir contient en lui-même le principe
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%