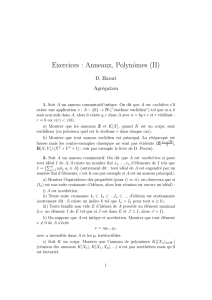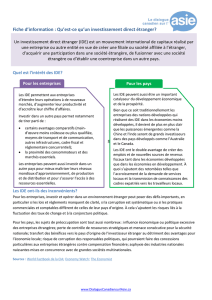Structures de base en théorie des nombres avancée. John BOXALL

Structures de base en th´eorie des nombres avanc´ee.
John BOXALL
Version du 5 janvier 2011.
Ce texte a comme origine des notes d’un cours de master M2 enseign´e `a l’Universit´e ce Caen Basse-
Normandie en 2008–2009. Il a ´et´e relu, corrig´e et l´eg`erement augment´e.
Prologue
(0.1) Traditionnellement, on entend par ´equation diophantienne une ´equation de la forme
f(x1, x2, . . . , xn) = 0, o`u fest un polynˆome en nind´etermin´ees et `a coefficients dans Z. Plus
g´en´eralement, un syst`eme diophantien est un syst`eme d’´equations
(∗)f1(x1, x2, . . . , xn) = f2(x1, x2, . . . , xn) = fN(x1, x2, . . . , xn) = 0,
avec des polynˆomes f1,f2, . . ., fNtoujours en nind´etermin´ees et `a coefficients entiers. On cherche
`a d´ecrire l’ensemble des solutions dans Zn, dans Qnou dans (Z/mZ)n(m≥1 un entier), puis
dans d’autre anneaux, tels que les corps finis, ou les corps de nombres, (qui sont, par d´efinition,
des corps qui sont des Q-espaces vectoriels de dimension finie). Cela nous am`ene parfois `a ´elargir
les notions d’´equation et de syst`eme diophantien en autorisant les polynˆomes `a coefficients dans
d’autres anneaux. (Sauf indication contraire, les anneaux seront toujours suppos´es commutatifs
et unitaires.)
Notons f= (f1, f2, . . . , fN) et Z(f, A) l’ensemble des solutions dans Andu syst`eme (∗), A
´etant un anneau, qui sera au d´ebut A=Z,Qou Z/mZ. Il est clair que Z(f, Z)⊆ Z(f, Q) et que
l’homomorphisme canonique Z→Z/mZinduit une application Z(f, Z)→ Z(f, Z/mZ).
(0.2) On peut se poser diverses questions concernant la nature et la structure de Z(f, A),
dont les r´eponses d´ependront ´evidemment de fet de A.
(0.2.1) L’ensemble Z(f, A) est-il non-vide ? Lorsque A=Z, Matsejevic a montr´e qu’il n’y a
pas d’algorithme pour d´eterminer si Z(f, Z) est vide ou non. La situation concernant Z(f, Q) est
moins claire. En ce qui concerne Z(f, Z/mZ) (ou, plus g´en´eralement, Z(f, A) lorsque Aest un
anneau fini), il suffit en principe de tester chaque ´el´ement de l’ensemble fini (Z/mZ)n(ou An).
Vu le r´esultat de Matsejevic, il est naturel d’´etudier la situation lorsque fest limit´e `a des
familles particuli`eres (par exemple la famille des polynˆomes de degr´e fix´e et dans un nombre
d’ind´etermin´ees fix´e).
(0.2.2) Notons qu’il n’y a pas forc´ement de relation logique entre les formes de l’ensemble des
solutions en entiers et celui des solutions rationnelles. Par exemple, si m∈Z,m > 0, r´esoudre
xy =men entiers ´equivaut `a factoriser m, alors que les solutions rationnelles sont de la forme
(x, m
x) avec x∈Q×. En revanche, il ´evident que l’´equation diophantienne x4+y4= 17 n’a que des
solutions en entiers (x, y) = (±1,±2) et (x, y) = (±2,±1), mais beaucoup plus difficile de montrer
que ce sont les seules solutions rationnelles.
1

(0.2.3) L’ensemble Z(f, A) est-il fini ou infini ? Il est clairement toujours fini lorsque Aest un
anneau fini. Mis `a part le fait que Z(f, Z) est fini lorsque Z(f, Q) est fini, il n’y a pas de r`egle
g´en´eral concernant Z(f, Z) et Z(f, Q).
(0.2.4) Si Z(f, A) est fini, peut-on ´enum´erer ses ´el´ements ? Lorsque A=Zou Q, les d´emon-
strations de finitude proc`edent souvent par l’absurde et, mˆeme lorsqu’il existe une d´emostration
effective, elle donne souvent de bornes tr`es ´el´ev´ees pour les solutions, ce qui exclue une recherche
par tˆatonnement.
(0.2.5) Lorsque Z(f, A) est infini, peut-on en donner une description explicite ? Ceci est parfois
possible lorsque Z(f, A) est muni d’une structure, par exemple de groupe. Si, par exemple, il s’agit
d’un groupe, on peut chercher `a le d´ecrire par un syst`eme de g´en´erateurs et de relations.
(0.3) Passons en revue quelques exemples illustrant ce que nous savons faire et ce que nous
ne savons pas faire.
(0.3.1) Soit (a, b, c)∈Z3avec ab 6= 0. Alors l’´equation ax+by =ca une solution si et seulement
si cest un multiple du pgcd dde aet de bet, lorsque c’est le cas, il y a une infinit´e de solutions.
On peut donner l’ensemble de solutions la d´escription suivante : si (x0, y0) est l’une d’elles, toute
autre solution est de la forme (x0+kb/d, y0−ka/d) avec k∈Z. On peut dire que l’ensemble des
solutions est la classe de (x0, y0) dans Z2suivant le sous-groupe {(kb/d, −ka/d)|k∈Z}. Enfin
on connaˆıt un algorithme permettant de d´eterminer une solution particuli`ere (x0, y0) (l’algorithme
d’Euclide ´etendu). Dans ce cas donc, on dispose d’une solution de tous les probl`emes soulev´es plus
haut.
L’´etude de l’ensemble des solutions rationnelles est un exercice trivial d’alg`ebre lin´eaire. Re-
marquons simplement qu’il est toujours infini, form´e d’un sous-espace affine du Q-espace vectoriel
Q2.
L’´etude des solutions dans (Z/mZ)2´equivaut `a l’´etude de la congruence ax +by ≡c(mod m).
Grˆace au th´eor`eme chinois, on se ram`ene au cas o`u mest une puissance ped’un nombre premier
p(voir le §2). On trouve que lorsque pne divise pas ab, il y a toujours des solutions. Lorsque p
divise ab, il y a des solutions ou non selon les puissances de pdivisant a,b,cet m. Cela illustre un
point que nous allons souvent rencontrer, `a savoir qu’il y a associ´e `a un syst`eme diophantien un
ensemble fini de «mauvais »nombres premiers (dits de mauvaise r´eduction), alors tous les autres
premiers sont de «bonne r´eduction ».
Des consid´erations semblables s’appliquent `a l’´equation de B´ezout g´en´eralis´ee a1x1+a2x2+
··· +anxn=c, o`u (a1, a2, . . . , an, c)∈Zn+1 et a1a2···an6= 0.
(0.3.2) Passons `a l’´equation de degr´e deux (conique) ax2+bxy +cy2+dx +ey =f, o`u
(a, b, c, d, e, f)∈Z6, (a, b, c)6= (0,0,0). L’exemple x2+y2=−1 montre que l’ensemble des solutions
rationnelles — et donc ´egalement des solutions en entiers — peut ˆetre vide. Notons que, dans ce cas,
mˆeme l’ensemble des solutions r´eelles est vide. Lorsque (x0, y0) est une solution rationnelle, on peut
chercher `a construire une autre comme point d’intersection d’une droite p(x−x0) + q(y−y0) = 0,
(p, q)∈Q2, (p, q)6= (0,0) avec la conique. Cela marche (x0, y0) est un point r´egulier de la conique
(c’est-`a-dire qu’elle y poss`ede une droite tangente). Notons qu’une droite passant par un point
singulier ne recontre pas forc´ement la conique en un second point (par exemple (x0, y0) = (0,0)
sur la conique x2+y2= 0).
La situation concernant les solutions en entiers est plus complexe. On sait que x2+y2=p(p
un nombre premier) a une solution si et seulement si soit p= 2 soit p≡1 (mod 4). On en d´eduit
que x2+y2=m(o`u m∈Z) a une solution en entiers si et seulement si m≥0 et, lorsque m > 0,
l’exposant dans mde tout nombre premier p≡3 (mod 4) divisant mest pair.
2

Lorsque p≡1 (mod 4) est premier et (x0, y0) est l’une des solutions en entiers de x2+y2=p, les
autres solutions (±x0,±y0) et (±y0,±x0). On peut, en principe, trouver une solution de x2+y2=p
par tˆatonnement (car |x|,|y| ≤ √p) mais il y a des algorithmes plus efficaces.
Lorsque D > 1 est un entier, nous ne disposons pas, sauf cas particuliers, de description aussi
simple des entiers mqui peuvent ˆetre ´ecrit sous la forme x2+Dy2avec (x, y)∈Z2. Cette question
est ´etroitement li´ee `a l’arithm´etique du corps de nombres Q[x]/(x2+D) (qui est traditionnellement
not´e Q(√−D)). Pour davantage de renseignements, on consultera le livre passionnant de D. Cox
[Co].
(0.3.3) L’´equation de Pell x2−Dy2= 1 est un exemple int´eressant d’´equation diophantienne
o`u l’ensemble des solutions peut ˆetre muni d’une structure de groupe. Ici, D > 0 est un entier qui
n’est pas un carr´e. Si f(x, y) = x2−Dy2−1, on note φDl’application de Z(f, Z) vers l’anneau
Z[√D] des r´eels de la forme a+b√Davec (a, b)∈Z2d´efinie par φD(x, y) = x+y√D. Alors φD
est injectif et son image est le groupe des ´el´ements inversibles Z[√D]×de Z[√D]. On sait que
ce groupe est engendr´e par −1 et par un ´el´ement εd’ordre infini. On peut d´emontrer ce r´esultat
`a l’aide des fractions continues, qui permettent ´egalement le calcul de l’´el´ement ε. Mais il sera
´egalement une cons´equence du th´eor`eme (9.9) de ce cours.
Remarquons que les coordonn´ees x,yde ε=x+y√Dpeuvent ˆetre grandes par rapport `a
D. Pour les tr`es petites valeurs de D, il est facile de trouver ε`a la main mais, lorsque D= 19,
on trouve d´ej`a ε= 170 + 39√19, lorsque D= 46, ε= 24335 + 3588√46, lorsque D= 94,
ε= 2143295 + 221064√94 et, lorsque D= 991, on a
ε= 379516400906811930638014896080 + 12055735790331359447442538767√991.
On constate que la taille de εvarie tr`es irr´eguli`erement avec D. Cela sugg`ere qu’il n’y a pas
de «formule simple »pour εen fonction de D. Ces exemples servent aussi `a mettre en garde
le lecteur contre l’id´ee na¨ıve que si on ne trouve pas facilement une solution d’une ´equation
diophantienne, ou si on ne trouve que quelques solutions «triviales », alors l’´equation n’a pas de
solution int´eressante.
Notons qu’on peut ´etendre φD`a une application injective de Z(f, Q) dans Q(√D)×, o`u Q(√D)
est le corps de fractions de Z[√D]. Par cons´quent, Z(f, Q) peut ´egalement ˆetre muni de la structure
d’un groupe ab´elien, sous-groupe du groupe multiplicatif Q(√D). Dans le langage de la th´eorie
des nombres alg´ebriques, d´eterminer Z(f, Q) ´equivaut `a d´eterminer les ´el´ements de Q(√D) de
norme un.
(0.3.4) Mentionnons bri`evement les courbes elliptiques. Dans leur incarnation la plus ba-
nale, il s’agit de l’´equation diophantienne y2=x3+ax +b, o`u (a, b)∈Z2est tel que le polynˆome
x3+ax +best `a racines simples. Alors f(x, y) = x3−ax −b−y2. D’apr`es un th´eor`eme de Siegel,
Z(f, Z) est un ensemble fini. Par exemple, lorsque a= 0, b= 17, on a
Z(f, Z) = {(−2,±3),(−1,±4),(2,±5),(4,±9),(8,±17),(43,±282),(52,±375),(5234,±378661)}.
La d´emonstration du th´eor`eme de Siegel donne une borne beaucoup trop grande sur la taille des
solutions pour permettre d’en d´eduire cette liste des solutions en entiers de y2=x3+ 17. Pour le
faire, on a besoin d’autres techniques.
En ce qui concerne les solutions rationnelles, on ajoute `a Z(f, Q) (qui peut ˆetre vide) un
point `a l’infini. (Cela sera rendu rigoureux lorsque on parle de coordonn´ees projectives.) Notons
comme on a l’habitude l’ensemble qui en r´esulte E(Q) (o`u Ed´esigne la courbe elliptique associ´ee
`a l’´equation y2=x3+ax +b, voir le §2). Alors E(Q) est muni d’une structure de groupe ab´elien,
dont l’´el´ement neutre est le point `a l’infini (que l’on note O), et la somme de trois points est nulle si
et seulement s’ils sont collin´eaires. En particulier, si (x0, y0)∈E(Q), la droite verticale d’´equation
3

x=x0coupe E(Q) en les deux points (x0, y0) et (x0,−y0) (qui co¨ıncident si et seulement si y0= 0)
ainsi qu’en O. Si donc P= (x0, y0), alors −P= (x0,−y0).
La figure montre la courbe elliptique y2=x3+ 1 et la droite passant par (−1,0) et (0,1) ; elle
coupe la courbe en le troisi`eme point (2,3). Par cons´equent, (2,3) + (−1,0) + (0,1) = Odans loi
de groupe, d’o`u (−1,0) + (0,1) = (2,−3).
Le th´eor`eme de Mordell affirme alors que E(Q) est un groupe ab´elien de type fini. Par exemple,
lorsque Eest la courbe y2=x3+ 17, on peut montrer que E(Q) est libre de rang 2, avec (−2,3)
et (−1,4) comme g´en´erateurs. Une g´en´eralisation (th´eor`eme de Mordell-Weil) affirme que, si K
est un corps de nombres E(K) est encore un groupe ab´elien de type fini.
Cˆot´e algorithmes, la situation ici est un peu ´etonnante. En pratique, on arrive `a d´eterminer
E(Q) (pourvu que aet bne soient pas trop grands). Toutefois, nous ne disposons pas d’algorithme
dont l’aboutissement est toujours garanti.
En ce qui concerne les courbes elliptiques sur Z/mZ, on a un d’abord un ensemble de nombres
premiers de mauvaise r´eduction qui doit ˆetre `a part. Ici, c’est l’ensemble des nombres premiers p
o`u x3+ax +b(mod p) a une racine multiple, c’est-`a-dire pdivise le discriminant −(4a3+ 27b2)
de x3+ax +b. En outre, il y a mauvaise r´eduction en 2. (Cela peut ˆetre ´evit´e en utilisant des
´equations plus g´en´erales pour d´efinir une courbe elliptique.) Tout autre nombre premier pest de
bonne r´eduction, et d´efinit une courbe elliptique Epsur le corps Z/pZet on peut d´efinir une loi
d’addition sur Ep(Z/pZ). Ces groupes ont trouv´e des applications importantes en cryptographie.
Il existe de nombreux textes introductifs concernant les courbes elliptiques. Voir par exemple
[Si], [Hu]. Des livres plus ´el´ementaires, tels [Ca1], [SiTa] et [Kn], peuvent ´egalement ˆetre consult´es
avec profit.
(0.3.5) L’´etude de l’´equation diophantienne f(x, y) = 0, o`u fest un polynˆome cubique en 2
ind´etermin´ees peut ˆetre ramen´ee `a l’´etude soit de courbes elliptiques soit de coniques. (Passons
sous silence le fait que nous ne disposons pas d’algorithme permettant de savoir si Z(f, Q) est non
vide . . ..) Lorsque fest de degr´e au moins 4, la situation «g´en´erale »est que Z(f, Q) (et donc
Z(f, Z)) est un ensemble fini. On peut formuler un ´enonc´e pr´ecis ; il implique, en particulier, que
l’´equation de Fermat xn+yn= 1 n’a qu’un nombre fini de solutions rationnelles (x, y) lorsque
n≥4 est un entier. Cette affirmation est moins pr´ecise que le dernier th´eor`eme de Fermat
(d´emontr´e par Wiles en 1994), qui a pour cons´equence que les seules solutions rationnelles de
xn+yn= 1 sont celles avec xy = 0. Ce r´esultat est valable ´egalement lorsque n= 3.
4

(0.4) Signalons enfin le tr`es joli r´esultat suivant. Rappelons qu’un polynˆome est dit ho-
mog`ene de degr´e dsi tous ses monˆomes ont le mˆeme degr´e total d. Plus pr´ecis´ement, si
xd1
1xd2
2···xdn
nest un monˆome, son degr´e total est d1+d2+··· +dn. Un polynˆome homog`ene
de degr´e total dest souvent appel´e une forme de degr´e d; on parle alors d’une forme quadra-
tique lorsque d= 2, d’une forme cubique lorsque d= 3, . . .. Voir aussi le §2.
(0.4.1) Th´eor`eme (Hasse-Minkowski, premi`ere version). Soit f(x1, x2, . . . , xn)une forme qua-
dratique en nind´etermin´ees et `a coefficients entiers. Pour que Z(f, Z)contienne un ´el´ement autre
que (0,0,...,0), il faut et il suffit que Z(f, R)et tous les ensembles Z(f, Z/mZ), ou mparcourt
les entiers m≥2, contienne un ´el´ement autre que (0,0,...,0).
L’une des implications est facile. Si (x1, x2, . . . , xn)6= (0,0,...,0) appartient `a Z(f, Z) on peut,
grˆace `a l’hypoth`ese que fsoit homog`ene, supposer que le pgcd de (x1, x2, . . . , xn) soit ´egal `a 1.
Alors (x1, x2, . . . , xn) (mod m) est non nul quelque soit l’entier m≥2 et appartient `a Z(f, Z/mZ).
En outre, il est clair que (x1, x2, . . . , xn)∈ Z(f, R).
Tout l’int´erˆet de ce th´eor`eme r´eside donc dans l’implication r´eciproque.
En outre, une fois acquise, la notion de nombre p-adique permet de formuler ce r´esultat de
fa¸con bien plus agr´eable :
(0.4.2) Th´eor`eme (Hasse-Minkovski, deuxi`eme version). Soit f(x1, x2, . . . , xn)un polynˆome
homog`ene non-nul de degr´e deux en nind´etermin´ees et `a coefficients rationnels. Pour que Z(f, Q)
contienne un ´el´ement autre que (0,0,...,0), il faut et il suffit que Z(f, R)et tous les ensembles
Z(f, Qp), ou pparcourt les nombres premiers, contienne un ´el´ement autre que (0,0,...,0).
Ici, Qpd´esigne le corps des nombres p-adiques qui sera introduit plus tard dans ce cours §4.
Si fest une forme de degr´e d`a coefficients entiers, on a f(λx1, λx2, . . . , λxn) = λdf(x1, x2, . . . , xn)
quelque soit λ∈Q. En particulier, si (x1, x2, . . . , xn)∈ Z(f, Q) est non nul, on obtient, en
multipliant par le d´enominateur commun des xi, un ´el´ement non nul de Z(f, Z). Ces remarques
facilitent le passage entre Z(f, Z) et Z(f, Q) dans les deux versions du th´eor`eme.
(0.4.3) Formul´e ainsi, le r´esultat est davantage susceptible de g´en´eralisation, ou d’attirer des
contrexemples `a des g´en´eralisations potentielles. Par exemple, une forme cubique `a coefficients
rationnels peut avoir des solutions r´eelles ainsi que des solutions dans le corps Qppour tout
nombre premier p, sans avoir des solutions rationnelles. (On ne tient pas compte de la solution
(0,0,0).) Un premier exemple a ´et´e donn´e par Selmer pendant les ann´ees 1950 : il s’agit de la
forme cubique f(x, y, z) = 3x3+ 4y4+ 5z5. De nombreux autres exemples ont ´et´e trouv´es depuis.
On dit qu’une telle forme viole le principe de Hasse. Par contre, une forme cubique en 10
variables ou plus v´erifie le principe de Hasse ; en ce qui concerne les formes cubiques lisses, 4
variables suffisent. Ici, lisse signifie sans point singulier, c’est-`a-dire que le gradient (vecteur des
d´eriv´ees partielles) ne s’annule pas (voir `a (1.2.1)).
On trouvera la d´emonstration du th´eor`eme de Hasse-Minkowski dans de nombreux textes, par
exemple [Se1], [Ca2], [BoSh].
(0.5) Voici donc un plan bref de ce texte. La §1 contient quelques rappels et compl´ement
d’alg`ebre, surtout concernant les anneaux commutatifs. La §2 ´etudie les congruences, et les
renseignements concernant des ´equations diophantiennes que l’on peut en tirer.
La suite du texte est surtout concern´ee par l’´etude des valuations, notion introduite dans la
§3. Soit Kun corps. Une valuation sur Kest une application v:K×→Γ, o`u Γ est un groupe
totalement ordonn´e, telle que, pour tout x,y∈K×
v(xy) = v(x) + v(y) et v(x+y)≥min (v(x), v(y),
la deuxi`eme propri´et´e n’ayant un sens que lorsque x+y6= 0. Il convient de poser v(0) = +∞. Dans
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
1
/
76
100%