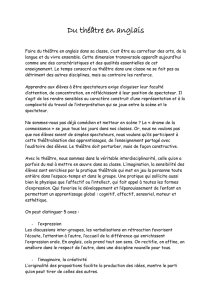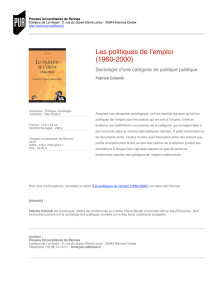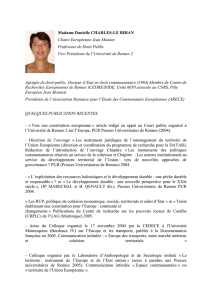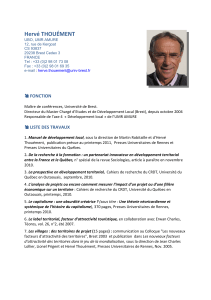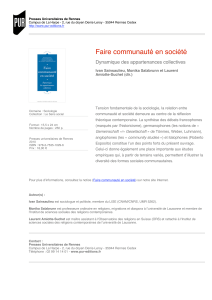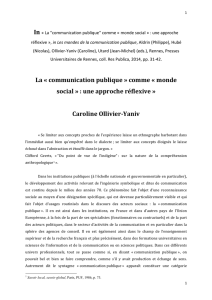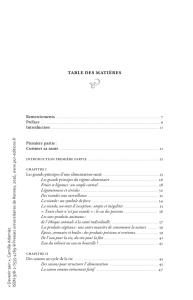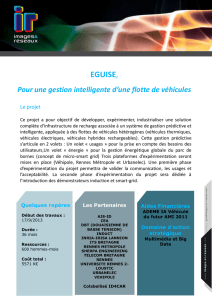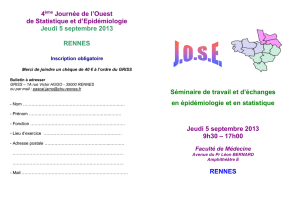Introduction - Presses Universitaires de Rennes

Introduction
Le théâtre, c’est comme pour voir une biche dans la forêt,
il faut être là au moment où ça se passe.
Philippe Dorin 1
Chaque saison, on estime que près de trois cents compagnies professionnelles
jouent devant trois millions d’enfants spectateurs, et quatre cents lieux program-
ment régulièrement des spectacles jeunesse
2. Cependant, « les réalisations artis-
tiquement les plus exemplaires ne sauraient faire oublier la survivance […] d’un
théâtre pour enfants de conception archaïque, la multiplication de propositions
aux intentions de plus en plus commerciales 3 », peut-on lire dans un Livre blanc
pour une politique de l’enfant spectateur, publié par l’Association du théâtre pour
l’enfance et la jeunesse (ATEJ) en 1995.
Le théâtre jeune public souff re d’une piètre image auprès du grand public.
Or, depuis l’entre-deux-guerres, un véritable théâtre d’art s’est développé en direc-
tion de la jeunesse. Dans les années 1990, ce mouvement s’accompagne d’une
édition foisonnante.
Cet ouvrage vise à faire découvrir les tendances et les tensions d’un nouveau
répertoire : celui des pièces de théâtre éditées destinées à être jouées par des comé-
diens adultes pour des publics d’enfants et de jeunes spectateurs.
Prenant appui sur une thèse en études théâtrales soutenue en 2004
4, il s’at-
tarde principalement sur le tournant des années 1980-1990. Le corpus initial se
• 1 – D Philippe, Itinéraire d’auteur n° 9 : Philippe Dorin, Centre national des écritures du
spectacle – La Chartreuse, 2006, p. 56.
• 2 – Source : B Rosita, « La société du pestacle », Télérama n° 2787, juin 2003, p. 86-87.
• 3 – éâtre et nouveaux publics. Livre blanc pour une politique de l’enfant spectateur, Association
du théâtre pour l’enfance et la jeunesse, 1995, p. 14.
• 4 – F Nicolas, De « jeune public » à « tout public » : analyse du répertoire théâtral francophone
pour la jeunesse, thèse de doctorat en Arts du spectacle dirigée par Jean-Pierre R, soutenue
[« Le théâtre jeune public », Nicolas Faure]
[Presses universitaires de Rennes, 2009]

Le théâtre jeune public- 8 -
composait de 119 textes jeune public, que l’on peut considérer comme représen-
tatifs. Sans doute quelques préférences, voire quelques oublis le font-ils apparaître
comme une sélection. J’espère en tout cas lancer plusieurs pistes de réfl exion,
fondées sur des analyses précises, et contribuer ainsi à la nouvelle légitimité d’écri-
tures souvent riches et originales.
Bref historique de l’enfant spectateur
La revendication d’un théâtre d’art, joué par des comédiens adultes pour des
publics spécifi ques d’enfants, n’apparaît clairement qu’au e siècle. Auparavant,
l’enfant est soit spectateur aux côtés de l’adulte, soit spectateur de ses pairs, c’est-
à-dire d’autres enfants en représentation d’un théâtre pédagogique ou commercial.
Une exception, peut-être : d’après Egle Becchi, citant M. Golden, dans l’Antiquité
« les concours sportifs, les sacrifi ces, les spectacles (et même le théâtre de marion-
nettes à l’intention spécifi que des enfants) se succèdent pour mobiliser l’attention
et la participation [des enfants] 5 ».
À part cette trace d’un théâtre spécifi que, il semble que, de l’Antiquité au
e siècle, l’enfant assiste aux mêmes spectacles que les autres spectateurs.
Au Moyen Âge, il est très tôt intégré à la société des adultes, et partage leurs jeux
et activités. D’après Philippe Ariès, étudiant dans l’iconographie de l’époque ce
qu’il appelle les « scènes de genre » :
L’enfant devient l’un des personnages les plus fréquents de ces petites histoires,
l’enfant dans la famille, l’enfant et ses compagnons de jeux, qui sont souvent
des adultes, enfants dans la foule, mais bien « mis en page », sur les bras de
leur mère, ou tenus par la main, ou jouant, ou encore, pissant, l’enfant dans
la foule assistant aux miracles, aux martyrs, écoutant les prédications, suivant
les rites liturgiques comme les présentations ou les circoncisions 6.
On imagine donc l’enfant assistant comme les adultes à toutes les formes spec-
taculaires, religieuses ou profanes (théâtre de foire, musiciens, jongleurs – c’est-
à-dire, ici, ménestrels qui chantaient ou récitaient des vers). À une époque où le
théâtre n’est pas encore professionnalisé, les enfants participent d’ailleurs aussi en
tant qu’acteurs : « dans le théâtre paraliturgique qui accompagne les cérémonies,
le 15 novembre 2004 à Paris III Sorbonne-Nouvelle. Le jury était composé de : M. Gérard Lieber,
université Paul Valéry, Montpellier III, président du jury ; M. Francis Marcoin, université d’Artois,
Arras ; Mme Catherine Naugrette, université Paris III Sorbonne-Nouvelle ; et M. Jean-Pierre
Ryngaert, université Paris III Sorbonne-Nouvelle.
• 5 – B Egle et J Dominique, Histoire de l’enfance en Occident, tome I, Le Seuil, 1998,
p. 47.
• 6 – A Philippe, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Le Seuil, coll. « Points
Histoire », 1973, p. 59.
[« Le théâtre jeune public », Nicolas Faure]
[Presses universitaires de Rennes, 2009]

Introduction - 9 -
les enfants de chœur interprètent des rôles signifi catifs 7 », écrit Egle Becchi ; et
Jean-Pierre Bordier rappelle qu’« en 1539, le fi ls d’un bourgeois de l’île Saint-
Louis a tenu, devant la famille royale, au moins trois rôles, Jésus enfant, un jeune
habitant de Jérusalem et l’âme de Jésus pour la Descente aux enfers. Ce garçon de
neuf ans avait appris environ 3 000 vers 8 ».
Au fond, toujours d’après Jean-Pierre Bordier :
Il n’est pas exagéré […] de dire que tout le monde au e siècle peut voir
du théâtre ; il le serait à peine de dire que tout le monde joue ou peut
jouer. Le théâtre de ce temps n’est réservé à aucune catégorie sociale, à
aucun milieu. Certaines formes, comme la farce et le mystère, sont desti-
nées à tous les publics, et on les trouve associées dans les mêmes spectacles.
D’autres, comme les pièces d’actualité et de polémique, émanent plutôt des
milieux cultivés mais devaient bien souvent s’adresser au public de la fête, à
l’homme de la rue, quand la censure n’était pas trop redoutable 9.
À la fi n du Moyen Âge, le théâtre se professionnalise, tandis que l’interdiction
des mystères en 1548 sonne la fi n des spectacles collectifs religieux. Au e siècle,
les troupes professionnelles et les salles dédiées au spectacle se multiplient. D’après
le docteur Héroard, qui a rendu compte au jour le jour de l’enfance de Louis XIII,
le dauphin assiste aux mêmes spectacles que les adultes. Philippe Ariès résume :
« [Le dauphin] va de plus en plus souvent à la comédie, presque tous les jours :
importance de la comédie, de la farce, du ballet, dans les fréquents spectacles d’in-
térieur ou de plein air de nos ancêtres 10 ! » Diffi cile de savoir si cette enfance royale
peut se comparer aux enfances communes. Mais on peut supposer l’enfant spec-
tateur étroitement lié au public populaire, baguenaudant devant les spectacles de
foire, et, dans les salles, se frayant un chemin au milieu des parterres bruyants.
Au e siècle, le public bourgeois relègue tout en haut du théâtre ces spec-
tateurs spontanés et inconvenants, comme l’écrit Martine de Rougemont :
« Le balcon le plus haut accueille les femmes du peuple (ou de mauvaise vie), les
apprentis, les soldats, quelques abbés en contrebande et plus ou moins déguisés,
des enfants même
11. » Saint Jean-Baptiste de La Salle, cité par Philippe Ariès, se
méfi e d’ailleurs de ces pratiques : « Il n’est pas plus séant à un chrétien de se trouver
à des représentations de marionnettes [qu’à la comédie]. […] Une personne sage
• 7 – B Egle, op. cit., p. 294.
• 8 – B Jean-Pierre, « Le théâtre des “bonnes villes” (e-e siècles) », in V Alain (dir.),
Le éâtre en France, des origines à nos jours, Presses universitaire de France, 1997, p. 72.
• 9 – Ibidem, p. 74.
• 10 – A Philippe, op. cit., p. 96.
• 11 – D R Martine, La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle, Honoré Champion,
1988, p. 228.
[« Le théâtre jeune public », Nicolas Faure]
[Presses universitaires de Rennes, 2009]

Le théâtre jeune public- 10 -
ne doit regarder ces sortes de spectacle qu’avec mépris… et les pères et les mères
ne doivent jamais permettre à leurs enfants d’y assister
12. » Le coût de plus en
plus élevé des places pousse d’ailleurs le public populaire vers les « spectacles de
marionnettes et de montreurs d’ours des Boulevards 13 ».
À côté de cette pratique devenue professionnelle subsistent les jeux drama-
tiques, que nous appellerions aujourd’hui pratique amateur : à la cour, dans les
villages, et plus tard dans les familles, enfants et adultes se croisent dans le public
et sur le plateau. Philippe Ariès écrit : « À la cour de Louis XIII, […] les enfants
jouaient [aux comédies ballets] et assistaient aux représentations. Pratiques de
cour ? non pas, pratique commune. Un texte de Julien Sorel nous prouve qu’on
n’avait jamais cessé de jouer dans les villages des jeux dramatiques, assez compara-
bles aux anciens mystères, aux Passions actuelles d’Europe centrale. […] Comme
la musique et la danse, les jeux réunissaient toute la collectivité et mélangeaient
les âges aussi bien des acteurs que des spectateurs 14. »
Ces pratiques collectives se perpétuent sous forme de théâtre de société au
e siècle, « un des fondements les plus stables de la vie mondaine et des échan-
ges sociaux », écrit Martine de Rougemont. « Une gamme étonnante va des asso-
ciations ouvrières […] aux spectacles de la cour, des granges aménagées pour une
cinquantaine d’invités aux théâtres réguliers et payants. » Parallèlement, un théâtre
enfantin ou d’éducation, composé de « piècettes édifi antes » jouées par des adultes
et des enfants, se développe au sein des familles, et déborde parfois sur le théâtre
de société, voire le théâtre commercial : « Ainsi Mme de Genlis fait-elle jouer ses
deux fi lles, qu’elle accompagne, devant un public choisi d’une soixantaine de
personnes ; mais le succès lui monte à la tête, elle loue le théâtre d’une société
bourgeoise, et se présente pendant plusieurs mois devant des publics de 500 spec-
tateurs parfois payants 15. »
En fait, il semble que l’histoire d’un théâtre spécifi que pour l’enfant spectateur
se confonde d’abord avec celle de l’enfant acteur : on le voit bien dans le théâtre
scolaire, puis dans les troupes d’enfants et d’adultes mêlés pour un public familial.
Le théâtre scolaire se développe notamment dans les nombreux collèges de
jésuites qui, dès 1571, font jouer à leurs élèves des pièces morales en latin, sans
rôle féminin, devant un public choisi d’élèves et de proches, qui est là, comme
l’explique Martine de Rougemont, « pour les élèves et non les élèves pour lui 16 ».
• 12 – A Philippe, op. cit., p. 162.
• 13 – C-G Marie-Claude, « Le e siècle : un siècle de théâtre », in V Alain
(dir.), op. cit., p. 244.
• 14 – D R Martine, op. cit., p. 115-116.
• 15 – Ibidem, p. 306 sqq.
• 16 – Ibid., p. 302.
[« Le théâtre jeune public », Nicolas Faure]
[Presses universitaires de Rennes, 2009]

Introduction - 11 -
En eff et, d’après les recommandations d’un Père jésuite : « Une pièce sérieuse
dans laquelle les mœurs sont bien réglées produit un fruit incroyable parmi les
spectateurs, et souvent même compte plus, pour les conduire à la religion, que les
sermons des plus grands prédicateurs 17. »
Au fi l des années, le public augmente (jusqu’à 4 000 spectateurs dans la cour
du lycée Louis le Grand), les représentations se multiplient. Le répertoire s’élar-
git jusqu’à Racine et même Molière. Pour les rôles de femme, on se travestit.
On inclut le ballet, des dispositifs scéniques imposants. Bref, il s’agit de plaire aux
puissants, de faire la promotion de l’Ordre. Le théâtre pour et par les collégiens
s’est transformé en théâtre d’enfants pour un public général.
Après l’expulsion des Jésuites de France en 1762, le théâtre scolaire survit dans
les collèges de façon plus discrète. On en conserve notamment la trace par des
recueils de pièces morales. Le e siècle relance le jeu dramatique, mais avec bien
d’autres objectifs pédagogiques.
L’autre confusion entre enfant acteur et enfant spectateur apparaît avec les
troupes professionnelles de comédiens enfants du éâtre de la foire, dont l’exis-
tence semble attestée dès le e siècle
18. Leur succès et leur développement
jusqu’au e siècle doit beaucoup à l’exploitation souvent mercantile d’enfants
virtuoses fi gés dans l’imitation des modèles adultes. Des aff aires de mœurs enta-
chent d’ailleurs la réputation de certains théâtres, notamment au e siècle, mais
d’autres troupes tentent d’apporter une éducation à leurs petits acteurs. Le pouvoir
édictera plusieurs décrets, remis en cause par les diff érents changements de régime,
pour interdire ce type de travail enfantin.
Ainsi, pour Maryline Romain : « Jusqu’au début du e siècle, en dehors du
cirque, du guignol et des théâtres d’ombres, il n’existe pas en France de théâtre
spécifi que pour la jeunesse. L’enfant spectateur découvre le théâtre en famille à
travers le répertoire “tout public” (vaudeville, opérettes, mélodrames) des théâtres
de boulevard et des troupes ambulantes. La fi n du e siècle verra la mode des
féeries à grand spectacle […]. Mais ces divertissements, coûteux, conçus d’abord
pour des adultes, privilégient le spectaculaire au point de n’être plus, pour certains,
que prétexte à costumes, trucages et changements de décors 19. »
Un théâtre de comédiens adultes pour un public d’enfants naît fi nalement au
début du e siècle, et la distinction sociale rattrape la distinction par l’âge. Francis
Marcoin explique :
• 17 – P. J, Ratio discendi et docendi, cité par V Alain (dir.), op. cit., p. 157.
• 18 – Voir notamment L’Enfant des tréteaux, Cahiers Robinson, n° 8, Presses de l’université d’Artois,
2000.
• 19 – R Maryline, Léon Chancerel, un réformateur du théâtre français, L’Âge d’homme,
2005, p. 246.
[« Le théâtre jeune public », Nicolas Faure]
[Presses universitaires de Rennes, 2009]
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
1
/
45
100%