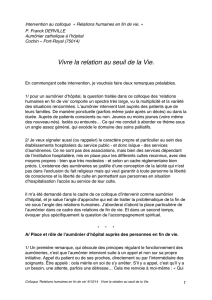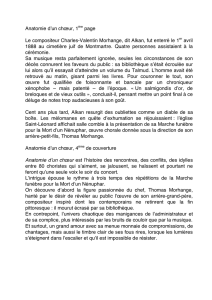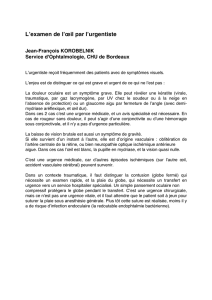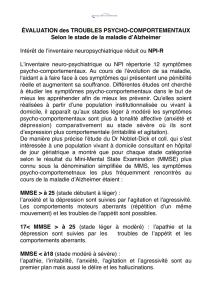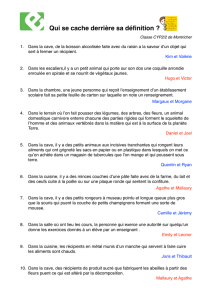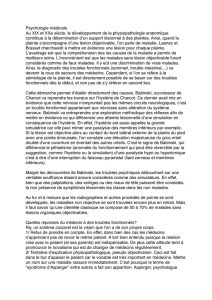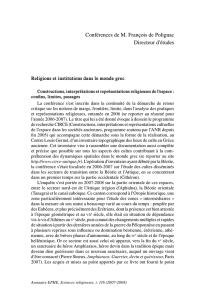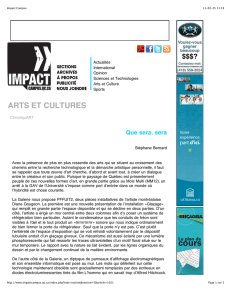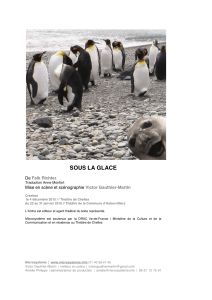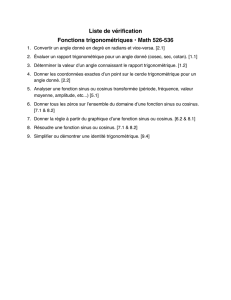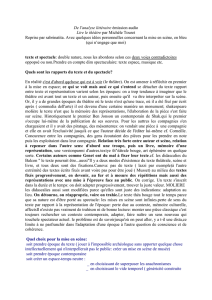Discours et pratiques du théâtre populaire. Le cas du Théâtre

Université de Montréal
Discours et pratiques du théâtre populaire. Le cas
du Théâtre Populaire du Québec de 1963 à 1976
par
Sylvain Lavoie
Département des littératures de langue française
Faculté des arts et des sciences
Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales
en vue de lʼobtention du grade de M. A.
en littératures de langue française
Février 2011
© Sylvain Lavoie, 2011

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales
Ce mémoire intitulé :
Discours et pratiques du théâtre populaire. Le cas
du Théâtre Populaire du Québec de 1963 à 1976
Présenté par :
Sylvain Lavoie
a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
Micheline Cambron, président-rapporteur
Élisabeth Nardout-Lafarge, directrice de recherche
Lucie Robert, membre du jury

iii
Résumé
Le théâtre populaire, concept chargé des finalités les plus diverses,
sʼinstitutionnalise en France à la fin du XIXe siècle, notamment grâce à Romain
Rolland, Firmin Gémier, Jacques Copeau, Jean Vilar et Bertolt Brecht. De
nombreuses traces de ces réflexions et pratiques se retrouvent dans le théâtre
québécois, et tout au long de lʼexistence du Théâtre Populaire du Québec (TPQ)
dont ce mémoire veut dégager les principaux éléments de la pensée artistique des
directions successives pour les confronter aux programmes établis de la fondation
de la compagnie en 1963 jusquʼen 1976.
Au cours de cette période qui sʼest avérée déterminante dans le domaine de la
production théâtrale au Québec, lʼhistoire de la compagnie met en lumière les
paradoxes et les apories du concept de théâtre populaire.
Mots-clés : Théâtre québécois, historiographie théâtrale, théâtre populaire,
Théâtre Populaire du Québec (TPQ)

iv
Abstract
The concept of popular theatre, which is full of the most diverse purposes,
becomes institutionalized in France at the end of the XIXth century thanks to,
among others, Romain Rolland, Firmin Gemier, Jacques Copeau, Jean Vilar and
Bertolt Brecht. Numerous traces of these thoughts and practices are found in
Quebec theatre, and throughout the existence of the Theatre Populaire du Quebec
(TPQ) of which this report aims to draw the artistic thoughtʼs main elements of the
successive directions, to then confront them with the established programs, that
from the foundation of the company in 1963 until 1976.
During this period, which turned out to be a deciding factor in the field of theatrical
production in Quebec, the history of this company enlightens the paradoxes and
aporias of the concept of popular theatre.
Keywords: Quebec theatre, theatre historiography, popular theatre,
Theatre Populaire du Quebec (TPQ)

v
Table des matières
Résumé.................................................................................................................... iii
Abstract.................................................................................................................... iv
Table des matières ...................................................................................................v
Liste des tableaux.................................................................................................... vi
Liste des sigles ....................................................................................................... vii
Remerciements........................................................................................................ ix
Introduction ...............................................................................................................1
Chapitre I
Le théâtre populaire : discours et
pratiques, de la France au Québec.....................................................................10
De la Révolution à lʼinstitutionnalisation .............................................................12
Fondations..........................................................................................................15
La vie théâtrale au Canada français au tournant du siècle.................................20
Firmin Gémier : prestige et rénovation ...............................................................28
Copeau & Compagnons .....................................................................................35
Vilar et querelles de Brecht.................................................................................42
Une histoire utopique ?.......................................................................................59
Chapitre II
Dʼune Comédie-Française au Québec à
un théâtre sous le signe de la contestation.......................................................64
Première partie : les années Valcourt.................................................................65
Un « véritable théâtre de répertoire ».............................................................66
« Porter le théâtre là où il nʼest pas ».............................................................70
Le Théâtre Populaire du Québec, troupe permanente de tournée.................74
Un service public ? .........................................................................................76
Seconde partie : de Millaire à Sabourin..............................................................78
Albert Millaire, la contestation dʼun projet.......................................................78
Le Grand Cirque Ordinaire .............................................................................87
Fernand Quirion, sans conteste un administrateur ........................................92
Jean-Guy Sabourin : un projet contesté .........................................................94
Concessions.................................................................................................102
Conclusion ............................................................................................................106
Bibliographie .........................................................................................................113
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
1
/
131
100%