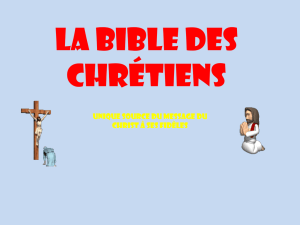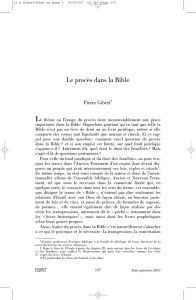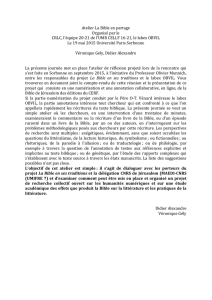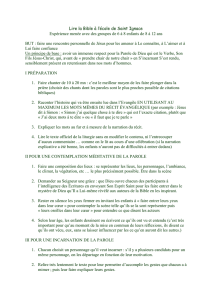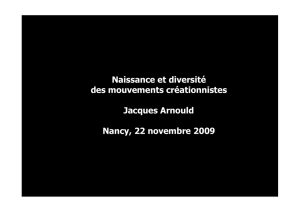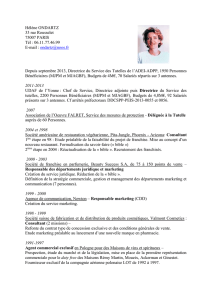Un dossier du « VIF – L`EXPRESS » sur la bible Et l`homme créa la

Un dossier du « VIF – L’EXPRESS »
sur la bible
Depuis plus de deux mille ans, le Livre des livres enflamme les passions
et les imaginations. Quelle est l'origine de cette profusion de textes,
comment ont-ils été écrits ? Quelle est la part de l'Histoire, de la
révélation, des mythes ? Les travaux des chercheurs apportent un
nouvel éclairage sur l'une des pièces maîtresses de la civilisation
occidentale. De la Torah aux Evangiles, voyage au cœur des Ecritures
Table des matières
Et l’homme créa la Bible
Moïse a-t-il écrit la Torah
Les versions modernes de la bible découlent-elles d’un
texte original
Marc, Matthieu, Luc et Jean sont-ils les auteurs des
Evangiles ?
Lexique
Les secrets des textes apocryphes
Pour l'islam, un livre annonciateur
L'épopée israélite à l'épreuve de l'archéologie
Les Hébreux ont-ils séjourné en Egypte ?
Les rois David et Salomon ont-ils existé ?
Nous parlons tous Bible
« La Bible n'appartient à personne »
Un entretien avec
Jaroslav Pelikan, l'un des plus grands spécialistes de l'histoire des
Ecritures
Et l'homme créa la Bible
Moïse a-t-il écrit la Torah ?
Mets par écrit ces paroles, car elles sont les clauses de l'Alliance que je
conclus avec toi et avec Israël. » Telle est la mission que Yahvé confie au
prophète hébreu dans la Torah (le Pentateuque pour les chrétiens, c'est-à-
dire les cinq premiers livres de la Bible). Des générations de fidèles ont pris
les Ecritures au pied de la lettre : Moïse, chargé par Dieu de libérer son
peuple du joug égyptien et de le mener jusqu'à la Terre promise, avait bien
retranscrit mot pour mot le Verbe divin. Problème : le Deutéronome, dernier
ouvrage de la série, fait périr le guide spirituel des Hébreux dans la région de
Moab (Deut xxxiv), à l'orée du pays de Canaan (l'actuelle Palestine), alors
que son peuple est sur le point de toucher au but. Comment Moïse, si inspiré

fût-il, aurait-il pu être en mesure de rédiger sa propre nécrologie ? Le
personnage a sans doute existé, car, « sans la présence d'une forte
personnalité, on ne peut guère rendre compte de la naissance d'un
mouvement religieux aussi original que celui d'Israël », souligne le bibliste
Bernard Renaud. Mais l'Histoire ne nous a laissé aucune trace de ce chef
hébreu qui aurait vécu aux alentours de 1300 avant Jésus-Christ. D'après la
Bible, Moïse - du mot égyptien mos (nouveau-né) - sauvé des eaux du Nil par
la fille de Pharaon, a grandi en Egypte. Un jour, l'élu de Yahvé, membre de la
tribu des Lévites, surprend un Egyptien rouant de coups un Hébreu. Il tue
l'agresseur, dissimule le cadavre, mais, dénoncé par l'un des siens, il doit
s'enfuir et devient berger dans le Sinaï. C'est là que Yahvé s'adresse à lui
pour la première fois, d'une voix mystérieuse surgie d'un buisson enflammé :
« Je suis qui je suis. » Après maintes péripéties, Moïse parvient à conduire
son peuple hors d'Egypte, jusqu'au mont Sinaï, où Dieu lui remet les Tables
de la Loi.
Une deuxième énigme surgit : si Moïse a vécu au xiiie siècle avant Jésus-
Christ, et s'il est l'auteur des cinq livres qui relatent la naissance d'Israël, la
Torah doit dater de la même époque. Or aucun spécialiste ne retient cette
chronologie. Les exégètes estiment aujourd'hui que le Pentateuque a été
couché par écrit au moment de l'exil des Hébreux à Babylone, entre 587 et
539 avant Jésus-Christ environ. Plus tôt, les populations de l'ancien Israël
n'étaient pas alphabétisées. Les scribes professionnels se chargeaient de
retranscrire le contenu des récits qui circulaient - les traditions orales - et qui
étaient nombreux, comme l'atteste la Genèse. Les premiers chapitres
bibliques reprennent ainsi le canevas d'un mythe mésopotamien ancien - la
légende de Gilgamesh - dans lequel un héros en butte à un dieu malfaisant
découvre l'arbre de vie et construit une arche pour échapper au déluge. Mais
revenons à ces milliers d'Israélites du royaume de Juda, déportés à Babylone
par le roi Nabuchodonosor. Il faut s'imaginer ces Judéens - notables, prêtres,
soldats, paysans, commerçants - débarquant sur les bords de l'Euphrate,
sans livres ni temple où pratiquer leur religion et perpétuer leurs rites. Sur
cette terre étrangère où ils ont échoué, ces hommes et femmes veulent
affirmer la vitalité de leur peuple, face aux empires assyrien et égyptien
environnants, qui ne cesseront de faire peser sur eux leur férule jusqu'au iie
siècle avant Jésus-Christ. Dès lors, les grands prêtres vont se lancer dans
l'écriture de leur histoire en s'inspirant des souvenirs de ceux qui avaient été
témoins des principaux événements de ce passé fondateur, souvenirs que la
tradition avait perpétués.
Certains exégètes - peu suivis, il est vrai - soutiennent même que la Torah
aurait été rédigée beaucoup plus récemment, en 230 avant Jésus-Christ. Le
linguiste Yaaqov S. Kupitz, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem,
décèle ainsi de fortes influences grecques dans les textes. D'où il conclut que
les auteurs de l'Ancien Testament vivaient probablement au moment où
l'hellénisation a gagné le Proche-Orient (338 avant l'ère chrétienne). Le duel
de David et Goliath (I Samuel, xvii), par exemple, rappellerait celui de Pâris et
Ménélas, rapporté dans L'Odyssée. Par ailleurs, la monnaie utilisée par Jacob
dans la Genèse pour acheter un terrain à Sichem (Gen., xxxiii, 19) - la qsitah,
dérivé du grec kisté - n'existait pas avant l'arrivée des Hellènes.

Dès le xviie siècle, certains savants osent publiquement douter du fait que
Moïse ait écrit la Torah. Après le juif Baruch Spinoza, condamné pour hérésie
panthéiste par les autorités religieuses, l'oratorien Richard Simon, père de la
critique biblique, suggère l'existence de plusieurs auteurs à l'origine du
Pentateuque. Son intuition sera développée au xixe par Friedrich
Schleiermacher. Soulignant les doublons (une même péripétie est rapportée à
propos de plusieurs personnages), les versions différentes d'un même
événement, dans la Genèse, par exemple, et les contradictions des Ecritures,
l'exégète allemand élabore l'hypothèse dite « documentaire », qui demeurera
très en vogue jusque dans les années 1970. En gros, la Torah serait née de
la fusion - en plusieurs étapes - de deux grandes sources bien distinctes :
l'écriture « yahviste » en cours au royaume de David, au xe siècle avant
Jésus-Christ, et l'écriture sacerdotale «élohiste », remontant au viiie siècle
avant l'ère chrétienne. Cette hypothèse a vécu. Les exégètes penchent
désormais pour une rédaction relativement condensée dans le temps, au
moment de l'exil.
RETOUR SOMMAIRE
Les versions modernes de la Bible découlent-elles d'un texte
originel ?
Rien n'est moins sûr. Nous ne disposons d'aucun écrit de ce genre. Tout au
plus peut-on tenter de reconstituer la ou les matrices du Pentateuque à partir
des versions qui nous sont parvenues. Les exégètes s'appuient sur la
Septante, la traduction grecque des Ecritures hébraïques - considérées
comme sacrées par les fidèles israélites - qui fut achevée au ier siècle avant
Jésus-Christ. Elaborée par les juifs d'Alexandrie afin de permettre aux jeunes
générations qui ne parlaient plus l'hébreu d'accéder aux Livres saints, cette
version tire son nom d'une légende. On raconte ainsi que le roi d'Egypte,
Ptolémée II Philadelphe, envoya quérir six savants de chacune des 12 tribus
d'Israël. Ces 72 érudits, enfermés 72 jours dans l'île de Pharos, livrèrent 72
versions identiques de l'Ancien Testament. Des versions si correctes qu'il fut
jugé bon que cette £uvre restât « comme elle était, sans la moindre retouche
». D'où l'appellation « Septante » (70), du latin populaire septanta.
Dans leur enquête sur les origines de la Bible, les spécialistes se fondent
aussi sur la reconstitution de la Bible hébraïque, effectuée par les scribes
massorètes au xe siècle après Jésus-Christ, soit près de onze siècles après
la Septante. Là encore, il faut tenter de retrouver l'esprit de ce monde antique,
si différent du nôtre, pour comprendre le cheminement du texte sacré. La
Torah fut d'abord le fruit d'une tradition orale : les Hébreux se transmettaient
de génération en génération des histoires, faites d'événements, de
personnages et de Lois, qu'ils reproduisaient fidèlement. Lors du passage à
l'écrit, les mots hébreux furent retranscrits sans leurs voyelles. Les
Massorètes se chargèrent de les réintroduire dans la version en hébreu qui
leur était parvenue au fil des siècles et qu'ils considéraient comme la « bonne
».

Nous disposons donc de deux matériaux : d'un côté, la Septante, qui produit
une version complète, avec voyelles et consonnes, de la Torah - ce qui
signifie qu'au iiie siècle les juifs d'Alexandrie avaient en leur possession des
écrits « complets ». De l'autre, la version des Massorètes, qui ont effectué
leur reconstitution à partir de documents «à trous », qu'ils ont dû compléter.
Conclusion : les uns et les autres ont vraisemblablement travailléà partir de
deux textes distincts de la Torah. De fait, la version grecque comporte des
pièces narratives qui ne figurent pas dans la Bible hébraïque massorétique :
des fragments du livre de Job, les livres d'Esther, du Siracide ou les deux
livres des Maccabées, notamment. « Ce que l'on a longtemps pris pour des
erreurs de traduction atteste en réalité l'existence, dès l'origine, d'une pluralité
de textes », explique la traductrice Dominique Barrios, chargée du secteur
biblique aux éditions du Cerf pendant plus de trente-sept ans. Méprise
linguistique ou source textuelle différente ? Dans le livre d'Isaïe, il est écrit : «
Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera
le nom Emmanuel. » La restitution grecque est tout autre : « Voici que la
Vierge sera enceinteà» (vii,14). Le mot hébreu almah (jeune fille) est devenu
parthenos (vierge) dans la version de la Septante, d'où provient la Bible
chrétienne. Ce glissement a permis aux Pères de l'Eglise catholique d'affirmer
que Marie avait conçu Jésus sans commettre l'acte de chair. Dans ses
longues tribulations, qui l'ont menée jusqu'à nous, la Bible, passée de l'hébreu
au grec, puis du grec au latin dans sa version canonique, a néanmoins connu
d'inévitables altérations dues aux erreurs des hommes. Les moines qui
recopiaient la Vulgate en vue de fournir des manuscrits pour la catéchèse
n'entendaient pas toujours bien ce qu'on leur dictait. Ils jetaient leurs vieilles
copies au fur et à mesure de leurs travaux. Pareils écarts ont certainement
joué pour le Nouveau Testament. Jésus parlait araméen, mais les Evangiles
ont étéécrits en grec, sauf celui de Matthieu, rédigé en araméen, lui, puis
traduit. En outre, les plus anciens manuscrits des Evangiles dont nous
disposons ne remontent qu'au ive siècle. Bref, on peut imaginer que de
nombreuses variantes se sont glissées au fil des siècles. Ce qui ne veut pas
dire qu'il faille tailler dans la Bible à grands coups de ciseaux, au sens propre,
comme le fit autrefois Thomas Jefferson. En 1804, « en deux ou trois nuits
seulement, après une journée à traiter les lettres et les paperasses de la
journée », selon ses propres mots, le troisième président des Etats-Unis
entreprit d'éliminer du Nouveau Testament tous les éléments qui lui
paraissaient douteux et peu conformes à sa vision du prophète galiléen. De
ce grand élagage naquit un ouvrage, La Philosophie de Jésus de Nazareth.
RETOUR SOMMAIRE
Marc, Matthieu, Luc et Jean sont-ils les auteurs des Evangiles
?
En partie seulement. Bien d'autres sont intervenus dans la rédaction des
témoignages qui forment le c£ur du Nouveau Testament. Les premiers
chrétiens n'éprouvaient pas le besoin de conserver des traces écrites des
actes et des paroles de Jésus. Ils gardaient en mémoire le message du
Nazaréen venu, selon eux, accomplir les Ecritures et sceller la Nouvelle
Alliance de Dieu avec les hommes. Convaincus de l'imminence de la fin du

monde, ces fidèles juifs pratiquaient leur culte en puisant dans la Bible
hébraïque les passages qui leur semblaient illustrer l'annonce du Messie et sa
résurrection. Le temps passant, des communautés de chrétiens de plus en
plus importantes se sont constituées tout autour de la Méditerranée
(Thessaloniciens, Corinthiens, Galatesà). Il a fallu des textes pour transmettre
à ces nouveaux venus une doctrine unifiée. Paul de Tarse, un juif pharisien
converti au christianisme sur le chemin de Damas, fut le premier à s'atteler à
la tâche, cinquante ans après la mort de Jésus. Il rédigea 21 épîtres afin de
structurer les premiers cercles chrétiens - en proie aux schismes, à la
débauche et aux tentations païennes - et d'y mettre de l'ordre. Persécutés par
les Romains, les disciples de Jésus jugèrent plus prudent de fixer par écrit la
prédication de leur Messie.
Le premier texte annonçant la « Bonne Nouvelle » - le terme « Evangile »
n'apparaît qu'en 150 de l'ère chrétienne - est attribuéà Marc. Il a étéécrit vers
70, au moment où les légions romaines détruisirent le Temple de Jérusalem.
Celui de Matthieu suivra en 80, puis celui de Luc en 90, et celui de Jean, dix
ans plus tard. Les Evangiles de Matthieu et de Luc présentent de très
grandes ressemblances. Or certains éléments rapportés dans leurs récits ne
figurent pas dans l'Evangile de Marc, dont ils se sont pourtant fortement
inspirés. La prière du « Notre Père », par exemple. Qu'en conclure ? Que les
auteurs de ces témoignages ont puisé dans une autre tradition - orale ou
écrite - perpétuant l'enseignement de Jésus. C'est la thèse dite du document
Q - de l'allemand Quelle (source) - postulée par des exégètes à la fin du xixe
siècle. D'autres chercheurs avancent même l'idée de six ou sept matériaux
d'origines différentes.
« La notion d'auteur n'existait pas jusqu'au début du iie siècle de notre ère,
rappelle le bibliste André Paul. Ce n'est qu'à partir de cette période que l'on
impute un livre unique à une figure de la tradition. »
Chaque évangéliste appartenait à une communauté qui rapportait à sa
manière l'enseignement de Jésus de Nazareth. Marc et Matthieu étaient
proches des milieux juifs, Luc, des cercles hellénistiques. Jean, lui, « le
disciple que Jésus aimait », évoluait parmi les chrétiens d'Ephèse, en conflit
ouvert avec leurs frères juifs, dont ils commençaient à se démarquer. «
L'Evangile de Jean a fait, plus que tous les autres, l'objet de rédactions
successives, souligne Michel Quesnel, recteur de l'Institut catholique de Lyon.
Il a été enrichi par des ajouts qui ont amplifié le texte et il a fait l'objet de
remaniements. On peut distinguer au moins deux ou trois couches
rédactionnelles successives. »
Les écrits des chrétiens des origines reflètent la culture du ier siècle, où les
influences grecques se mêlaient au fond judaïque. Selon André Paul, les
Evangiles perpétuent la tradition des biographies à l'antique, un genre né au
ive siècle avant Jésus-Christ. Le personnage central apparaît sous les traits
d'un héros au parcours lacunaire mais exemplaire. L'emphase et le
merveilleux exaltent le récit. Mais ce n'est pas tout : les célèbres manuscrits
dits de Qumran ont aussi fait la preuve que le christianisme s'était
abondamment nourri de la culture judaïque antique. En 1946, trois Bédouins
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%