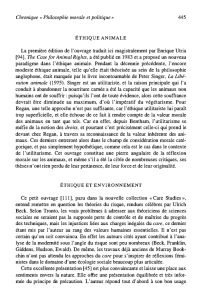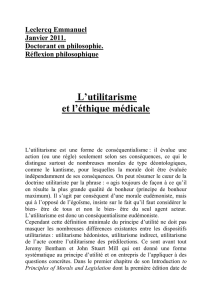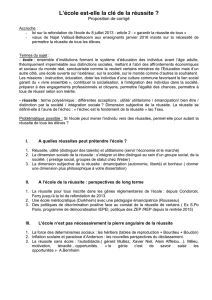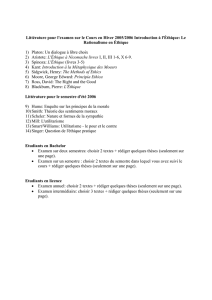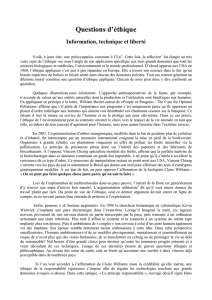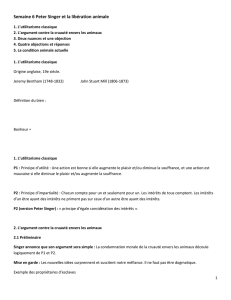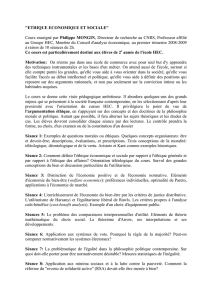Utilitarisme : attention aux effets secondaires

Science et conscience
Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 3 - septembre 2001
armi les philosophies qui influent sur
l’exercice médical, l’utilitarisme (1)
tient une place de choix. Ce courant philoso-
phique régit la pensée anglo-saxonne depuis
maintenant deux siècles, et son influence, sur
nos pratiques, ne cesse de s’accentuer, en par-
ticulier dans le domaine de l’éthique appliquée
(euthanasie, avortement, droit des générations
futures, droit des animaux…) (2). Cette doc-
trine “enseigne qu’une action ne peut être
jugée moralement bonne ou mauvaise qu’en
raison de ses conséquences bonnes ou mau-
vaises pour le bonheur des individus concer-
nés” (2). Ainsi le bonheur – éviter la douleur
et rechercher le plaisir – devient-il la fin de
toute vie humaine (“welfarisme”), la valeur
unique ; ainsi l’utilité – tout ce qui procure
satisfaction – devient-elle le seul fondement
de la vérité. Tel est, en quelque sorte, ce qui
fonde le bien et le mal. À ce critère s’ajoute
un impératif moral, celui de maximiser le
bien : “Produire le plus grand bonheur pour le
plus grand nombre”, selon la thèse de Jeremy
Bentham (“prescriptivisme”). Enfin, l’action
morale est évaluée en fonction de ses consé-
quences sur l’individu et le collectif (“consé-
quentialisme”) : faire le bien suppose une éva-
luation au cas par cas qui tienne compte des
effets prévisibles de l’acte (3). En d’autres
termes, il ne peut y avoir, ici, de critère a priori
pour juger l’action. L’utilitarisme rejette donc
toute morale déontologique “dans laquelle
c’est le respect de principes indépendants qui
donne son caractère moral à l’acte” (2). C’est,
en ce sens, l’antithèse de la position kantienne
pour laquelle l’action morale doit s’exercer
sans tenir compte de ses conséquences.
Parmi les applications pratiques de l’utilita-
risme, citons les échelles de qualité de vie, les
QALYs(1),dont la justification se trouve dans
la nécessité où l’on est de “tenir pour morale-
ment préférable de produire un avantage glo-
bal plus grand” (4) pour le plus grand nombre,
étant entendu, par postulat, que l’individu n’a
accès qu’à des faits et que ceux-ci “peuvent
être traités comme des choses, des objets expé-
rimentaux, quantifiables, mesurables, calcu-
lables”(5). L’introduction de la notion de coût-
bénéfice découle aussi de la mise en pratique
de principes utilitaristes (3). Il en va de même
de l’evidence based medicine (EBM). Chacun
sait toute la place prise par ces applications
utilitaristes qui visent à “formater” l’exercice
de la médecine au nom du refus de l’aléatoire
et de l’arbitraire, au nom de la nécessité de
procurer le plus grand bienfait global et de
celle de fonder les pratiques sur les informa-
tions scientifiques les plus pertinentes et les
plus récentes. Et qui pourrait s’en offusquer ?
De prime abord, personne. Cela a d’incontes-
tables avantages. Toutefois, l’impératif philo-
sophique – avoir un regard critique sur les
concepts, ne cesser de s’interroger, refuser
l’“intellectuellement correct” – amène à avan-
cer quelques réflexions.
C’est à juste titre que S. Rameix (3) constate
que, dans l’utilitarisme, la conception de l’être
souffre d’un réductionnisme inquiétant : peut-
elle se résumer à une somme de plaisirs ou de
déplaisirs ? Le vécu de chacun est-il réductible
à un score ? Et peut-on accepter comme uni-
verselle “l’attitude systématique qui fait de
l’utilité la valeur suprême et la référence abso-
lue” (5) ? L’utile peut-il être une fin en soi ?
Autre problème, et non des moindres, celui de
l’évaluation des critères du bien et du mal. Qui
va évaluer, comment et sur quelles bases ?
L’évaluateur peut-il réellement être, comme le
formulait John Stuart Mill dans L’utilitarisme,
“aussi rigoureusement impartial qu’un spec-
tateur désintéressé et bienveillant” ? Et que
devient le caractère distinct et unique de
chaque individu dans tout cela ? Autant d’in-
terrogations qui, sans nier les apports de l’uti-
litarisme, n’en soulignent pas moins, non seu-
lement les insuffisances, mais aussi les risques.
Car danger il y a, comme en témoignent les
travaux de Peter Singer(2),héritier moderne
des théories utilitaristes et qui en tire des
conséquences extrêmes. Le principe d’éga-
lité doit, nous dit Singer, s’appliquer au-delà
de notre espèce : “Il faut accepter qu’il règle
nos relations avec les autres espèces, les ani-
maux non humains” (6),reprenant, ce faisant,
les thèses de Jeremy Bentham, “en avance sur
son temps” : “Un cheval adulte ou un chien
est, sans conteste, un animal plus rationnel et
qui communique davantage qu’un enfant
d’un jour, d’une semaine ou même d’un
mois.” Au nom du principe de l’égalité de
considération des intérêts, “principe moral
[qu’il tient] pour fondamental” (6),Singer
soutient qu’il importe de considérer à égalité
tous les êtres vivants capables de souffrir. “De
ce point de vue, les animaux non humains,
les enfants et les personnes gravement han-
dicapées mentales entrent dans la même caté-
gorie” (6). Au nom du conséquentialisme, il
faut revoir l’impératif moral selon lequel
toute vie humaine doit être considérée
d’égale valeur. Dans l’éthique singerienne,
un handicapé mental a moins de valeur qu’un
non-handicapé. Peter Singer rejette la dis-
tinction kantienne qui oppose l’être humain
rationnel et autonome à l’animal. Certes,
reconnaît-il, autonomie, rationalité, capacité
de langage définissent l’homme au regard de
la philosophie. Mais “toutes ces descriptions
s’appliquent-elles à un enfant de trois mois
ou à un individu dans un coma dépassé ? Évi-
demment non (…) Un chimpanzé, ou un
cochon, par exemple, se rapproche bien plus
du modèle d’être autonome et rationnel qu’un
nouveau-né” (7). Autrement dit, l’être
humain ne possède pas, en tant que tel, les
caractéristiques lui permettant de prétendre
à un statut éthique particulier par rapport aux
autres espèces animales. D’où un nouvel
aphorisme singerien : “La doctrine du carac-
tère sacré de la vie humaine n’est plus défen-
dable” (7).
Poursuivons cette logique en l’appliquant à
l’embryon. Que dit notre enseignant ? Que
Utilitarisme : attention aux effets secondaires
●
T. du Puy-Montbrun*
* Service de colo-proctologie,
hôpital Léopold-Bellan, Paris.
(1) Quality Adjusted Life Years.
(2) Peter Singer est, depuis 1999, professeur
de bioéthique à Princeton.
P
105
CP septembre MAQ.ok 31/10/01 09:25 Page 105

Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 3 - septembre 2001
Science et conscience
l’embryon est certes une personne poten-
tielle (8) mais que ce fait n’a pas de signifi-
cation morale et qu’en conséquence, il n’y
a “aucune raison d’accorder un droit de vie
spécial à une personne potentielle” (7).
Allant encore un peu plus avant – et toujours
dans le même esprit –, Singer considère que
le nouveau-né handicapé n’est pas non plus
une personne pleine et entière : “Tuer un
nouveau-né handicapé n’est pas équivalent
d’un point de vue moral de tuer une per-
sonne” (7). Et cela vaut aussi, nous apprend-
il, pour un nouveau-né normal.
Mais, alors, à quel moment un nourrisson devient-
il une personne ? Réponse : “On peut au moins
affirmer que, dans le premier mois de son exis-
tence, un nouveau-né n’est pas une personne (7)”.
Qu’il se hâte de grandir ! ■
RÉFÉRENCES
1. L’utilitarisme apparaît avec Jeremy Bentham
(1748-1832) et John Stuart Mill (1806-1873).
2. Audiard C. “Utilitarisme”, Dictionnaire d’éthique
et de philosophie morale. Paris : PUF, 2001 : 1657-64.
3. Rameix S. Fondements philosophiques de l’éthique
médicale. Paris : Ellipses, 1996 :
4. Lockwood M. cité par Rameix S. in op. cit.
5. Folscheid D. DESS d’éthique médicale et hospita-
lière. Cours.
6. Singer P. Questions d’éthique pratique. Paris :
Bayard Éditions, 1997.
7. Peter Singer : l’éthique revisitée (propos recueillis
et traduits de l’anglais par S. Ruphy) in : La
Recherche 2000 ; 335 : 108-11.
8. Voir à ce sujet l’avis 08 du 15/12/86 du CCNE
relatif aux recherches et utilisations des embryons
humains in vitro à des fins médicales et scientifiques.
http://www.ccne-ethique.org
106
CP septembre MAQ.ok 31/10/01 09:25 Page 106
1
/
2
100%