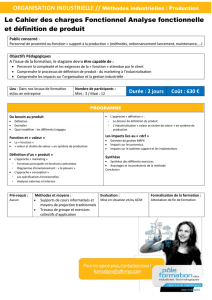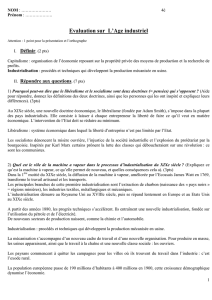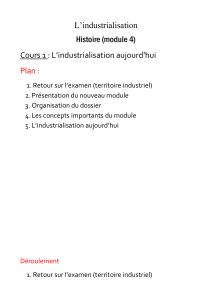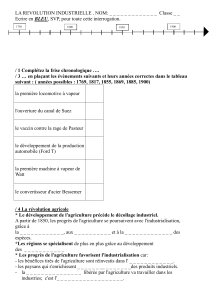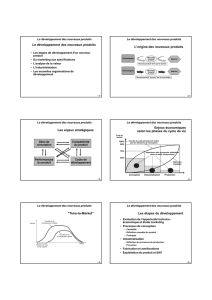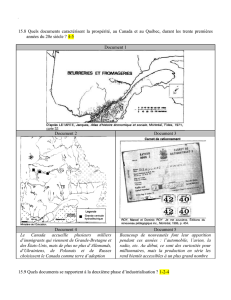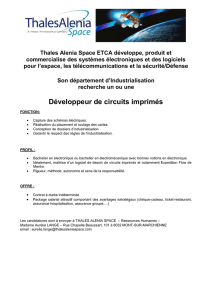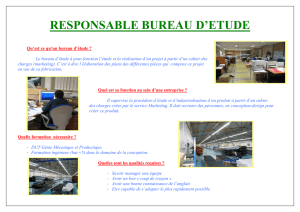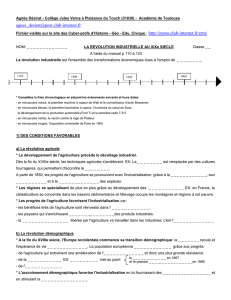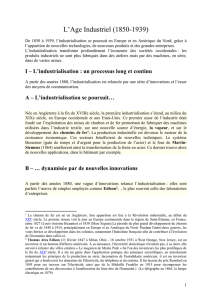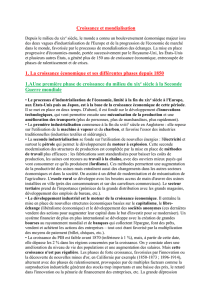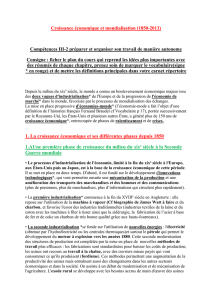Une économie de production de masse - Hachette

1
L-ES « PARTIE I. L’âge industriel et sa civilisation du milieu
du XIXe siècle à 1939.
1. Transformations économiques, sociales et idéologiques de l’âge
industriel, en Europe et en Amérique du Nord.
Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente
le processus d’industrialisation et les transformations économiques
et sociales qui lui sont liées. Il s’agit de saisir les évolutions et les
ruptures majeures sur près d’un siècle et non d’examiner le détail de la
conjoncture. »
S « PARTIE I. L’âge industriel en Europe et en Amérique du Nord du
milieu du XIXe siècle à 1939.
1. Industrialisation et croissance.
2. La société de l’âge industriel.
Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente
le processus d’industrialisation et les transformations scientiques,
techniques, économiques, sociales et idéologiques qui lui sont liées. Dans
tous les cas, il s’agit de saisir les évolutions et les ruptures majeures. »
À partir du XIXe siècle, l’industrie devient le moteur de la croissance et
transforme profondément l’économie des sociétés occidentales.
Le premier dossier met en évidence l’importance des innovations
techniques et scientiques à travers l’exemple des moyens de transports, qui
se perfectionnent, se diversient et se démocratisent progressivement.
La leçon 1 montre la continuité du processus d’industrialisation depuis la
Révolution industrielle, grâce à l’enchaînement des innovations.
La leçon 2 présente un acteur majeur de l’industrialisation, la grande
entreprise, qui se transforme et s’agrandit pour accroître la production.
Les documents mettent en évidence les stratégies mises en œuvre par les
entreprises pour s’agrandir.
La leçon 3 décrit les irrégularités de la croissance économique dans
l’espace et dans le temps, et leurs conséquences.
L’histoire de l’industrialisation se caractérise par des interactions entre
les aspects économique, technique, scientique, géographique, mais aussi
culturel, artistique et social.
Une économie de production de masse

L’histoire économique des États occidentaux depuis le XIXe siècle a
suscité diérentes interprétations. Les premières explications remontent
à Marx et Engels (1845) ; puis l’historien anglais Arnold Toynbee propose
une « Lecture sur la Révolution industrielle » en 1883, à destination des
futurs administrateurs des Indes britanniques. Dans les années 1950,
l’économiste Rostow dénit la notion de « décollage industriel » (take o) :
la production prend son essor, marquant le début de la « Révolution
industrielle ». Cette expression est aujourd’hui contestée car la Révolution
industrielle est dicile à dater précisément et parce qu’elle met l’accent sur
l’idée d’une rupture nette et dénitive. Les historiens privilégient plutôt
l’idée d’une continuité dans l’évolution économique.
Certains, comme François Caron, s’inspirent des travaux de l’économiste
Schumpeter qui insiste sur le rôle des innovations : les progrès techniques
permettraient l’apparition d’innovations « en grappes » qui seraient à
l’origine des phases de croissance.
Histoire économique et sociale
– P. Bairoch, Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde
du XVIe siècle à nos jours, t. 2 et 3, Folio-Gallimard, 1997.
– É. Bussiere, P. Griset, Ch. Bouneau, J.-P. Williot, Industrialisation
et sociétés en Europe occidentale 1880-1970, A. Colin, 1998.
– F. Caron, « Qu’est-ce qu’une révolution industrielle ? », Sciences
humaines n°120, octobre 2001.
– P. Léon, Histoire économique et sociale du monde, vol. IV :
La Domination du capitalisme 1840-1914, vol. V : Guerres et crises
1914-1947, A. Colin, 1978.
– P. Richet, L’Âge du vert, Découvertes, Gallimard, 2000.
– J.-P. Rioux, La Révolution industrielle, coll. Point Histoire, Le Seuil, 1989
(1re éd., 1971).
– P. Verley, La Révolution industrielle, Folio-Gallimard, 1997.
– P. Verley, La Première Révolution industrielle (1750-1880), A. Colin, 1999.
– D. Woronoff, Histoire de l’industrie en France du XVIe siècle à nos jours,
Le Seuil, 1994.
Transformations du travail et évolution technique
– A. Beltran, P. Griset, Histoire des techniques aux XIXe et XXe siècles,
A. Colin, 1990.
– A. Dewerpe, Le Monde du travail en France 1800-1950, A. Colin, 1996.

D’une économie artisanale… à une
économie de production de masse
Un marchand ambulant.
Dès le milieu du XIXe siècle, de nouvelles formes
de distribution à grande échelle apparaissent
en Europe occidentale (les grands magasins
comme Le Bon Marché). L’entrée dans l’ère de
la consommation, la concurrence accrue entre
les marchés et les difcultés économiques de
l’entre-deux-guerres obligent les entreprises à
moderniser leurs pratiques commerciales. Les
industriels se dotent de services des ventes,
développent la publicité, des emballages
personnalisés et de nouvelles méthodes de
vente, souvent importées des États-Unis.
Les marchands ambulants ne disparaissent
que progressivement et partiellement : ils se
maintiennent dans certains secteurs et certains
espaces (le camion du crémier ou du boulanger
dans les campagnes…).
De nouveaux biens de consommation.
Le document illustre parfaitement la société
de consommation déjà bien avancée aux États-
Unis. Mais la confrontation des deux images
montre davantage le passage d’une économie à
une autre et invite les élèves à s’interroger sur
les facteurs qui le rendent possible. Il y a bien sûr
le crédit, la publicité, les nouvelles techniques,
la hausse du niveau de vie… mais au-delà, une
nouvelle culture économique et industrielle. La
concentration industrielle s’est accompagné
d’une redénition de l’organigramme type
des entreprises industrielles : pour reprendre
la thèse de l’économiste Schandler, on passe
d’une structure centralisée et organisée en
départements fonctionnels (forme en U) à
une structure multi-divisionnelle comportant
un état-major central et un certain nombre
de divisions spécialisées chacune dans un
produit. Pour Schandler, c’est ainsi que naît
l’entreprise moderne qui tire sa force de sa
capacité à coordonner des activités sur une
grande échelle et à prévoir l’avenir (lancer de
nouveaux produits comme ici pour entretenir
la croissance), donc à avoir une stratégie qui
inclut le marketing, le service après-vente, la
vente à crédit. Mais cela induit un changement
de structure plus souple, car chaque division
s’occupe d’un produit et donc d’une stratégie
particulière en totale autonomie d’une part,
et d’autre part, chaque division ou usine est
dégagée des tâche nancières, de gestion et
de management qui sont centralisés dans
la maison mère. Parallèlement, après avoir
privilégié la sous-consommation, les industriels
prennent conscience au XXe siècle de l’intérêt
de favoriser la consommation (le fordisme).
C’est surtout Gerald Swope, président de
General Electric en 1922, qui invente la notion
de « salaire culturel » au début des années
1920 et théorise la pratique de Ford, c’est-à-
dire l’idée que le salaire doit pouvoir laisser une
marge sufsante pour proter de la vie (dans le
sens ici de consommer), pourvoir à l’éducation
et à sa santé. Alfred Sloan, directeur de General
Motors en 1923, dont Frigidaire est une liale,
lance l’idée que la consommation de masse doit
proposer une gamme diversiée à la fois en
fonction des budgets, mais aussi renouveler les
modèles (comme on le voit sur l’image pour ce
qui est des réfrigérateurs) par des combinaisons
d’éléments de base standardisés et cette
gamme de produits est le miroir des espoirs
d’ascension social. Il réorganise également
General Motors suivant des cibles de marchés
et, pour reprendre les expressions du magazine
Fortune, on peut distinguer Chevrolet pour la
« populace » ; Pontiac pour les « pauvres mais
ers », la petite classe moyenne ; Oldsmobile
pour les « discrètement aisés » ; Buick pour les
« battants » ; et Cadillac pour les « riches ».
CARTES
L’économie mondialisée
1
2
Il s’agit de deux cartes construites à partir de la
projection à compensation régionale de Bertin
(1953). Cette projection polaire modiée permet
de limiter les distorsions dans l’hémisphère
nord.
À l’échelle mondiale, les États-Unis sont
devenus la première puissance économique
(32 % de la production industrielle mondiale).
Une économie de production de masse

On peut néanmoins remarquer la faiblesse des
investissements américains à l’étranger (7,5 %).
En 1914, les États-Unis sont encore débiteurs
de l’Europe. L’Allemagne a pris la première
place européenne avec 14,8 % de la production
industrielle (forte concentration industrielle).
Elle a distancé la Grande-Bretagne et la France
dont les structures économiques vieillissent.
On voit également émerger une nouvelle
puissance économique : le Japon qui connaît
des taux de croissance spectaculaires depuis
son ouverture économique (révolution Meiji).
En 1914, l’Europe reste au centre de l’éco-
nomie mondiale. Elle englobe les principaux
pôles de l’investissement. La Grande-Bretagne
à elle seule réalise presque la moitié des
investissements à l’étranger et elle est au
centre du système commercial et nancier
du monde ; elle est suivie par la France
(investissements en Russie, dans l’Empire
ottoman, dans les Balkans) et l’Allemagne.
L’Europe détient, en 1914, 60 % du stock d’or
mondial dans un système monétaire fondé
sur l’étalon or (Gold standard). L’impérialisme
européen se manifeste aussi par la possession
d’immenses empires coloniaux qui s’étendent
en Asie et en Afrique.
La carte montre l’organisation des ux
nanciers et commerciaux de l’Europe vers
l’Afrique et l’Asie et le Pacique et des États-
Unis vers l’Amérique du Sud. Ces ux favorisent
l’émergence des « pays neufs » qui connaissent
une croissance économique rapide (Australie,
Canada, etc.).
La solidarité commerciale et nancière
qui lie les économies capitalistes explique
en partie la diffusion de la crise de 1929 à
l’échelle mondiale. La crise trouve son origine
dans le krach de la bourse de Wall Street. Elle
amplie la crise de surproduction agricole dont
souffraient déjà les États-Unis et les « pays
neufs » et entraîne une crise industrielle
majeure. Les marchés sont encombrés et le
commerce mondial se contracte. Les pays
dont le développement économique dépend
en grande partie des exportations (Amérique
latine, Afrique) s’enfoncent dans la dépression.
Par ailleurs, on assiste à un reux des capitaux
américains placés en Europe (notamment en
Allemagne et en Autriche). Tout le système
économique mondial est atteint. En réponse au
marasme, certains pays choisissent l’autarcie
(Italie fasciste et Allemagne nazie), d’autres
optent pour le repli sur leur empire colonial.
C’est le cas de la France et de la Grande-
Bretagne (Commonwealth).
CARTES
L’industrialisation de l’Europe
L’industrie européenne naît en Grande-
Bretagne. À la n du XVIIIe siècle, l’Angleterre
a connu une mutation profonde et rapide de
ses structures économiques. On a pu alors
parler de Révolution industrielle. Ailleurs,
l’industrialisation a été plus lente. Elle s’est
d’abord diffusée en Belgique, en France et en
Suisse dans le premier tiers du XIXe siècle.
La deuxième vague d’expansion (1840-1860)
a touché les territoires allemands et le
Danemark. Après 1860, le nord de l’Italie et la
Suède s’industrialisent.
À la n du XIXe siècle, l’Europe du Nord-Ouest
s’est industrialisée alors que les régions Sud et
Est sont restées à dominante rurale.
Sur la carte de l’Europe industrielle des
années 1930, de nouvelles régions industrielles
sont apparues : en Espagne, la Catalogne, la
Galice et la région autour de Madrid ; en URSS,
le Donbass, la région autour de Kiev.
Les principales régions industrielles sont
situées en Angleterre, dans le nord de la France
et en Lorraine, dans la Ruhr, en Saxe et dans
le nord de l’Italie. On peut noter, par ailleurs,
le développement du réseau de chemin de fer
dont le maillage s’étend sur toute l’Europe.
Les principales places boursières sont Londres
et Paris. Le cœur économique de l’Europe se
situe donc au nord-ouest où se concentrent les
régions industrielles, les places boursières et
les principales métropoles.
La seconde industrialisation repose sur deux
nouvelles énergies : l’électricité visible sur la

carte (développement de l’hydro-électricité
dans les Alpes) et le pétrole (puits en Asie
centrale).
DOSSIER
Quels transports
pour une économie moderne ?
Ce dossier met en évidence le développement,
la diversication et la modernisation constante
des moyens de transports. Cette « révolution des
transports » permet une intensication des ux
de marchandises, de personnes, d’informations,
indispensables à l’industrialisation. La crois-
sance des échanges impose de disposer
d’un ensemble de communications à quatre
niveaux au moins : à l’intérieur des grandes
agglomérations (tramway, métro, bus), au
niveau national (routes et chemins de fer
surtout), continental et mondial (voies uviales,
routes maritimes, chemin de fer puis avion).
On assiste à une transformation des échelles
de temps : des trajets toujours plus longs
sont parcourus en une durée toujours plus
réduite. Parallèlement, les coûts de transports
baissent, permettant une diversication et
un éloignement des approvisionnements.
L’interdépendance des économies s’accentue
et les rmes multinationales se développent.
1
En Angleterre, la première ligne (19 km) est
ouverte en 1821 ; dès 1838 la locomotive North
Star construite par Stephenson tire un train de
80 tonnes à 50 km/h ; et en 1840 apparaissent
les premières voitures spécialement conçues
pour les voyageurs, largement inspirées des
diligences. Le chemin de fer se perfectionne
constamment au l de l’industrialisation,
devenant à la fois plus able, plus rapide et
plus confortable.
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les
réseaux de chemin de fer se densient consi-
dérablement dans les pays occidentaux qui
s’industrialisent. En 1879, le ministre français
des Travaux publics, Freycinet, lance un
programme d’aménagement de 3 000 km de
lignes secondaires : la longueur totale des
chemins de fer passe de 24 000 km en 1881 à
41 000 en 1911. Cette croissance rapide répond
aux besoins de la population plus nombreuse
et surtout aux mouvements migratoires
interrégionaux, générés par l’industrialisation.
Au lendemain du premier conit mondial, les
réseaux ferroviaires ont atteint leur maximum,
parfois même un suréquipement qui pose le
problème de leur rentabilité économique. Les
constructions de lignes s’arrêtent et durant
les années 1930, des services et des lignes
sont supprimés. Mais c’est après la Seconde
Guerre mondiale que la place du chemin de fer
se rétracte vraiment, subissant la concurrence
de la route.
Le document montre clairement que la
principale période d’expansion du chemin de
fer se situe entre 1870 et 1913 : le maillage
ferroviaire se densie alors considérablement
pour répondre aux besoins des populations
et des industries. On voit également que le
développement des chemins de fer est plus
précoce aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Allemagne et en France.
2
Le transport des personnes, mais aussi des
marchandises et des matières premières
impose des infrastructures toujours plus
puissantes. Dès le début du XXe siècle, le Rhin
est aménagé grâce à de multiples ports en
eau profonde et grâce à des canaux : il permet
notamment de relier les régions intérieures,
en particulier la Rhur industrielle, aux grands
ensembles industrialo-portuaires tels que
Anvers ou Rotterdam.
Au XIXe siècle, grâce à un réseau de canaux
très développés, Bruxelles devient le point de
rencontre entre les produits du nord de l’Europe
et d’Amérique (bois, produits manufacturés,
agricoles…), et ceux du sud du pays (charbon,
pierres…). À la n du XIXe siècle, on ressent
donc la nécessité d’entreprendre de grands
travaux pour élargir et approfondir un canal
an de construire une véritable voie maritime et
un port de mer à Bruxelles : jusqu’aux années
1930 au moins, ces infrastructures seront
régulièrement complétées et étendues.
Dès la première moitié du XIXe siècle,
l’extension des grandes villes en Europe
occidentale entraîne le développement de
transports intra-urbains. À Paris, en 1828,
Une économie de production de masse
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%