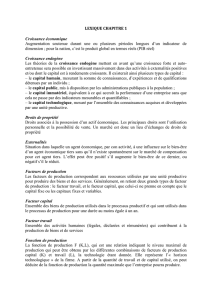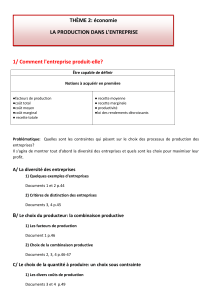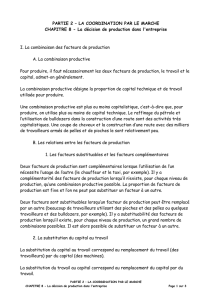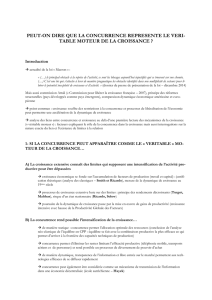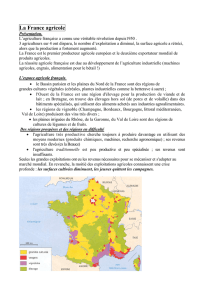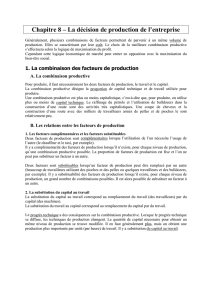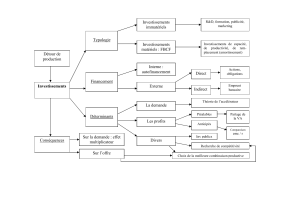une régulation sectorielle spécifique

Christian du Tertre
Novembre 1995
LE BATIMENT :
une régulation sectorielle spécifique.
(éléments de problématique)
L'évolution des contraintes liées aux nouvelles "formes de la concurrence", aux
modifications du "rapport social de travail" et à celles des "règlements internationaux"1
provoque des bouleversements de grande ampleur dans la dynamique des différents
secteurs d'activité et dans celle de l'économie dans son ensemble, quelque soit le pays
considéré. C'est notamment le cas bien entendu de la France. Ces transformations en
cours changent non seulement la dynamique des secteurs, mais la place et le rôle qu'ils
jouent dans la dynamique macro-économique.
De ce point de vue, l'analyse du Bâtiment semble essentielle pour comprendre
l'évolution actuelle de la dynamique macro-économique. En effet, le Bâtiment a occupé
une place très particulière dans la croissance d'après guerre des pays développés,
notamment de la France, et apparaît comme au cœur de la crise de l'activité et de
l'emploi depuis le milieu des années soixante-dix.
Mais pour ce faire, il apparaît fondamental de définir une problématique qui
nous permette d'apprécier la dynamique des secteurs, et plus particulièrement ici, celle
du Bâtiment, d'apprécier les caractéristiques propres de sa régulation2. Pour progresser
dans cette compréhension, nous sommes amenés à préciser ce qui relève, en général,
d'une dynamique sectorielle, puis à décrire les relations qui lient cette dynamique à celle
d'ordre macro-économique, enfin à caractériser les spécificités du secteur du BTP,
notamment dans le cas de la France.
Pour introduire ce développement analytique, il semble utile de revenir sur le
mode de définition des secteurs à partir d'une prise en compte de leur logique
productive qui dépend des liens unissant le travail, les technologies et l'organisation3. Il
1Nous reviendrons par la suite sur la définition précise de ces concepts. Pour l'instant on peut entendre
par : - "formes de la concurrence", la structure de la concurrence dans un secteur d'activité, les
modalités à travers lesquelles les enreprises se font concurrence et l'intensité de la concurrence ;
- "rapport social de travail", l'organisation du travail et les conditions sociales de gestion de la
main-d'oeuvre ;
- "règlements internationaux", le cadre dans lequel la production et les échanges s'organisent au
niveau international, européen comme mondial.
2La théorie de la régulation se présente d'abord comme une théorie macro-économique. Mais un certain
nombre de chercheurs se référant explicitement à cette théorie, se sont engagés dans des analyses d'ordre
méso-économique, pour tenter d'expliciter la réalité des dynamiques sectorielles. Les recherches portant
sur la régulation sectorielle, se sont, en particulier, penchées sur l'analyse des secteurs non fordiens dont
la dynamique apparaissait comme a-typique : le BTP, l'agriculture, les services. La mise à jour d'une
problématique théorique qui permette de saisir leurs caractéristiques prend d'autant plus d'importance,
aujourd'hui, que les évolutions de ces secteurs ont d'impact sur la régulation d'ensemble. (cf C. du Tertre
in R. Boyer et Y. Saillard éditeurs, La Découverte 1995).
3. Ce que nous définissons, ici, par "configuration productive".
1

s'agit ainsi de revenir sur les définitions des concepts de "configuration productive",
de "rapport social de travail", et de "sphère productive".

1.
Quels découpages de l'activité productive mettre en oeuvre ?
Quelle définition du secteur retenir ?
Soulignons, tout d'abord, que la théorie de la régulation à laquelle nous nous
référons, ici, considère le secteur comme un niveau pertinent d'analyse, non pas à partir
de la conception walrassienne qui structure son approche sur la base de l'homogénéité
du produit, mais à partir d'une conception "institutionnaliste" qui considère le secteur
comme une construction sociale complexe de la dynamique productive, repérable
historiquement. La thèse développée, ici, considère que le secteur met en oeuvre une
"configuration productive" qui relève d'une "sphère productive" particulière. Cette
production est liée à un certain "rapport social de travail" et soumise à des "formes de
concurrence" spécifiques.
1.1. Les configurations productives.
* Du concept de "procès de travail" à celui de "configuration productive".
Il faut tout d'abord prendre la mesure que les productions de valeurs d'usage sont
réalisées sur la base de technologies, d'organisations et de qualité de travail spécifiques4
qui concernent tant la dynamique de l'atelier ou du chantier, que celle des services
fonctionnels. Si le concept de "procès de travail", d'origine marxienne, avait pu conduire
à la définition d'un procès de "type chantier", propre au BTP, et à la mise en évidence de
l'existence d'économies internes spécifiques5, ce concept présentait certaines limites.
L'analyse était concentrée sur l'atelier, le site ou le chantier comme lieux centraux de la
valorisation du capital.
Or les recherches récentes ont montré que les dispositifs productifs sont
également soumis aux tensions de la compétitivité hors coût. L'articulation du travail,
des technologies et de l'organisation dépend, alors, également des enjeux de la qualité et
des délais d'innovation, ce qui se traduit par un rôle de plus en plus important accordé
au dispositif fonctionnel des entreprises et à sa cohérence avec le dispositif directement
productif. L'activité de travail est alors saisie par l'intermédiaire du concept de
configuration productive6 qui permet d'élargir le champ de l'analyse aux relations
coopératives et conflictuelles qui s'établissent entre productifs et fonctionnels7.
4 Dans le cas de l'agriculture, il faudrait ajouter à ces facteurs de production, les terres et les ressources
vivantes ; cf. Lacroix, Mollard, 88,94.
5 Cf. C; du Tertre, 1989. "l'intensité connexe du travail", les "économies de flexibilité organisationnelle".
6 Dans le cadre de l'analyse en termes de "configuration productive", il est possible de distinguer sept
configurations différentes dans lesquelles se classe toute production : la configuration des activités
agricoles, celle des industries de série, celle des industries de process, celle des activités de chantier, celle
des services logistiques, celle des services administratifs/informationnels, celle des services
immatériels/relationnels.
7 Cf. C. du Tertre 1992. Ce développement conceptuel permet, par ailleurs, d'étendre ce type de
recherches aux services. Le concept de procès de travail est, en effet, peu opératoire pour saisir les
caractéristiques productives de ces activités. Cette difficulté est liée à la nécessité de tenir compte, dans
les rapports de travail, de la spécificité de la relation de service qui s'instaure entre les prestataires et les
bénéficiaires, et à l'impossibilité de définir des outils fiables de mesure des gains de productivité (Gadrey
90 et 92).

Sur le plan des gains de productivité, cette approche a le mérite de permettre une
articulation entre la réalisation d'économies internes et d'économies externes. La
"cohérence organisationnelle" d'une entreprise relève, alors, de la mise en oeuvre de
dynamiques productive et fonctionnelle qui permettent au mieux de penser et de
cumuler les effets internes et externes.
* La "configurations productives de type chantier".
Dans le cas du Bâtiment, la configuration productive est marquée par quatre
caractéristiques :
1. Il existe d'importantes contraintes spatiales. La production est
réalisée sur un lieu à chaque fois différent où vont être "consommés" l'ensemble des
facteurs de production. Si le bien lui-même n'est pas transportable, les facteurs de
production vont être soumis à d'importantes contraintes de mobilité. Cette production va
être fortement marquée par les aléas "naturels" ou spatiaux (contraintes fortes des
intempéries, de la qualité du sol...) et avoir des effets contraignants sur la mobilité de la
main-d'oeuvre ou celle des autres facteurs de production. De plus ces contraintes
spatiales vont marquer la dynamique de la gestion. L'enjeu de la décentralisation de la
gestion productive qui concerne tant les hommes, le matériels que les matériaux, sera
souvent décisif dans les résultats d'un chantier ;
2. la production est généralement réalisée à l'unité, à partir d'un
cahier des charges spécifiques. Cette caractéristique va provoquer la mise au point et
l'usage d'outils qui vont être relativement peu spécialisés. Il n'existe pas, en fait, comme
dans l'industrie de série de machine-outil. En d'autres termes, les matériels utilisés
n'imposent pas de dispositif organisationnel précis et rigide, ni de temps-machine
particulier ;
3. sur les chantiers, les tâches directement productives sont
intrinsèquement liées aux tâches de régulation, c'est à dire de réglage, d'outillage, de
contrôle de la qualité... Cette caractéristique a un effet sur la main-d'oeuvre composée
essentiellement de compagnons. Ces derniers plus ou moins habiles, expérimentés et
compétents, constituent le coeur du dispositif ouvrier. Les manoeuvres sont par contre
dans une situation d'apprentissage et dans une posture d'aide vis-à-vis des compagnons ;
ils sont sans réelle autonomie ;
4. La production se réalise par projet. Elle est généralement
évolutive. De ce point de vue, la gestion de la production est soumise à :
- de fortes contraintes de successivité. Il existe fort
peu de possibilité de production en temps masqué ;
- de fortes contraintes temporelles. La production
n'est pas stockée et ne repose que sur très peu de stocks intermédiaires.
- des contraintes d'autonomie. La gestion de
production est généralement associée à une forte autonomie du chantier, plus ou moins
négociée, vis-à-vis des services fonctionnels.
L'ensemble de ces caractéristiques conduisent à considérer :

- que les gains de productivité se jouent essentiellement dans le chantier
sur la base de "l'intensité connexe du travail8" plus largement dans l'entreprise sur la
base des "économies de flexibilité", notamment organisationnelles.
- que les capacités des entreprises à assurer non seulement des gains de
productivité mais également des objectifs performants face à la concurrence, en matière
de qualité, de délais, de services connexes dépend de la cohérence organisationnelle
du dispositif fonctionnel vis-à-vis de l'organisation productive de chantier.
* "Configuration productive" et "sphère productive".
Les différents types de configurations productives peuvent être associés à des
sphères productives qui assument une fonction particulière dans la dynamique macro-
économique. Ainsi, le secteur du Logement fait partie de la sphère productive du
Bâtiment et des Travaux Publics qui ont un rôle essentiel quant à la définition des
normes de consommation des ménages et des normes de production. En effet le cadre
bâti structure l'espace social dans lequel les ménages sont amenés à consommer les
biens et les services. Il structure l'espace dans lequel se réalisent les activités
productives industrielles et de services. Le BTP structure également le cadre de vie,
c'est à dire les conditions sociales d'existence, de circulation... Cette fonctionnalité est
très importante à apprécier pour comprendre la nature de la demande que la société est
amenée à émettre, les blocages institutionnels que la sphère d'activité peut rencontrer
dans son développement.
1.2. Du "rapport salarial" et "rapport social de travail".
Selon les premiers travaux de la théorie de la régulation, l'activité productive
met en jeu un travail qui est lui-même situé dans un rapport salarial particulier :
- liens spécifiques entre les techniques utilisées, la forme de
l'organisation du travail et la qualité du travail requis ;
- existence de certains dispositifs institutionnels (conventions de branche,
formes juridiques de mobilisation de la main-d'œuvre, dispositif de formation) ;
- conditions de formation du revenu direct et indirect.
* Les limites du concept de "rapport salarial".
Mais le concept de rapport salarial présente une limite qui réside dans sa
focalisation sur le salariat. Les travaux sur l'agriculture (Lacroix-Mollard 88, 94) ont
montré que l'activité agricole s'appuie sur des processus de valorisation du capital qui
non seulement mettent en oeuvre des équipements, des produits intermédiaires et du
travail, ce qui définit le procès de travail et le salariat, mais également des terres, des
ressources naturelles et des ressources vivantes. Par ailleurs ces recherches ont souligné
l'importance du travail indépendant, déployé dans le cadre de la famille, et la façon dont
les rapports de travail s'articulent aux relations familiales. Les intérêts patrimoniaux et
fonciers se lient ainsi au rapport capital/travail. L'ensemble de ces résultats de recherche
les amènent à proposer le concept de rapport social de travail qui d'un côté tient
compte des différentes façons dont l'activité de travail se lient, non seulement aux
8 Les gains de productivité du travail sont liés à la qualité des tâches de régulation qui in fine
conditionnent le rythme de déroulement des opérations productives. Cf. C. du Tertre, Flexibilité
organisationnelle et productivité dans le Bâtiment, PCA-Recherche, 1988.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%