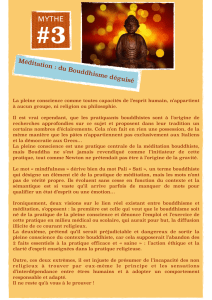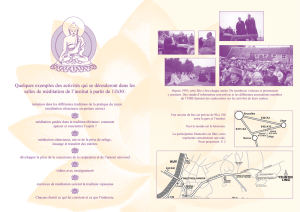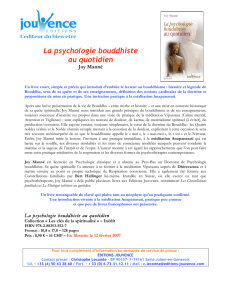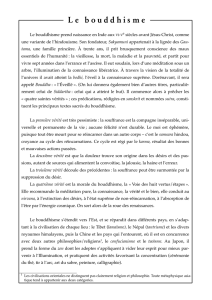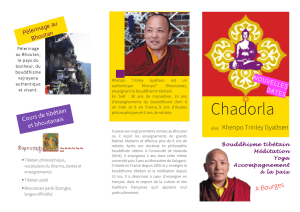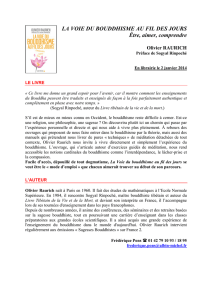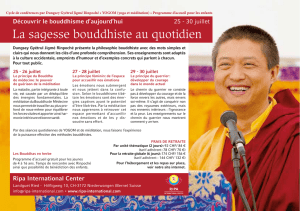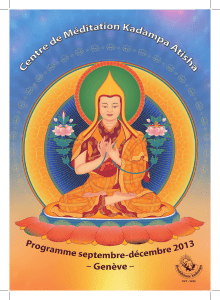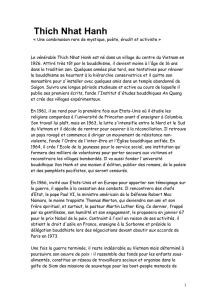3-Le silence dans le bouddhisme theravàda chez les Cambodgiens

1
Le silence dans le bouddhisme theravàda chez les Cambodgiens*
Dr. KHING Hoc Dy
Le bouddhisme originel s'est divisé en plusieurs écoles aux frontières dogmatiques
souvent incertaine mais aux limites géographiques bien déterminées. "Classé parmi les écoles
appelées péjorativement Hinayàna (Petit Véhicule), le Bouddhisme Theravàda, dit
"d'Anciens" ou des "Doyens" et réputé le plus orthodoxe, apparaît ainsi à l'époque moderne
comme l'une des principales caractéristiques de l'Asie du Sud-Est péninsulaire"1 Le
« Bouddhisme Theravàda »2 a été pendant des siècles la religion majoritaire, voire en certains
cas la religion d'Etat des pays de l'Asie du Sud-Est situés entre l'Inde et la Chine où seul le
Viêt-Nam relevait, lui, du Bouddhisme Mahàyàna, Eglise du Grand Véhicule.3
Pour ajouter à cet éclatement "il me semble bien en effet que les Occidentaux se soient
fait de longue date une image du bouddhisme à leur usage. D'une part, sur le plan des études,
ils se sont centrés sur les textes canoniques du Tripitaka en pàli, et ont privilégié l'aspect du
bouddhisme comme système de pensée, comme philosophie ou spiritualité transcendante. Et
d'autre part, le bouddhisme évoque avant tout pour eux un ensemble de méthode de
méditation, de concentration, de maîtrise de soi. A un degré supérieur de spiritualité, une
recherche d'absolu, d'union avec le Tout, ou avec le Vide. Et d'une manière plus générale et
plus vague, un système de pensée et une thérapeutique qui permettent d'échapper aux
contingences et aux agressions du monde, pour atteindre un état de sérénité parfaite et
d'abstraction de la durée, de l'angoisse et de la souffrance."
"En cela, ce bouddhisme est conforme à l'enseignement originel développé dans les
textes du canon, mais il se trouve dépouillé de son contexte local, de son environnement
historique, de sa pratique humaine au cours des siècles. Il n'a retenu que ce qui pouvait être
utile, au cœur de la société occidentale moderne, à une quête de sérénité, de maîtrise de soi,
sans exigence d'adhésion à une foi ou à des dogmes. Nous allons retrouver cet aspect dans le
cadre des société modernes de l'Asie du Sud-Est."4
Le silence chez les bouddhistes au Cambodge et ailleurs est la recherche de la sérénité
et la paix de l'intérieur. C'est le samàdhi, "la concentration totale de l'esprit" ou "la
*A mon Maître, le Vénérable PANG Khat, en hommage respectueux.
1J. Népote, "Pour une approche socio-historique du monachisme théravada", Péninsule, n° 1, 1980, p. 94.
2Au Cambodge, le bouddhisme theravàda vient succéder au brahmanisme et au bouddhisme mahayàna vers le
milieu du XVe siècle après la chute de l'empire angkorien. En ce qui concerne le bouddhisme au Cambodge, il
faut lire les travaux du Vénérable PANG Khat,
Jivit manuss (La vie des hommes), Phnom-Penh,
Imprimerie khmère, 1952, 49 p., Kàr tràs’ tin (L'illumination), Phnom-Penh, Ed. Aank nibandh,
39 p.;
?Buddhasàsanà jà vidyàsàstr? (Le bouddhisme est-il une science?), Phnom-
Penh, Ed. Anak nibandh, 1972, 60 p., "Le bouddhisme au Cambodge", France-Asie, Présence du bouddhisme,
n° 153-157, tome, XVI, Saïgon, 1959, p. 841-852, ré-édité par le Centre d'Etudes Bouddhiques au Cambodge,
Phnom-Penh, Institut Bouddhique, 1963, p. 41-68...
3S. Thierry, "Aspects contemporains du bouddhisme en Asie du Sud-Est, Livret 3, p. 3 (directeur d'études à
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes - Ve section, spécialiste des religions de l'Asie du Sud-Est et l'Insulinde).
4Ibid.

2
méditation". Ce mot qui vient du sanskrit et du pàli, signifie étymologiquement "se
concentrer". Les pratiquants s'assoient correctement sans se faire mal au dos, cultivent d'abord
le va-et-vient du souffle, les yeux mi clos, mais toujours en éveil. Cette méthode "consiste à
rétrécir le champ de l'attention selon un mode et pour une durée déterminée par la volonté. Le
résultat est que l'esprit devient fixe, comme la flamme d'une lampe à huile en l'absence de
vent. En termes affectifs, la concentration aboutit à un état de calme paisible, parce qu'on s'est
retiré pour un temps donné de tout ce qui peut causer de trouble."5
Les techniques de méditation
Voici quelques techniques que j'ai observées chez les méditants dans les pagodes
khmères en France et au Cambodge.
D'abord il faut s'asseoir en lotus (ou en demi lotus) sur coussin (20 cm d'épaisseur
d'environ) avec bascule du bassin en avant et sur trois points d'appui, c'est-à-dire les deux
genoux et le coccyx.
Les épaules doivent être décontractées (légèrement rentrées), la tête droite
naturellement avec mention rentrée, nuque tendue, les yeux mi-clos avec le regard juste posé
devant soi.
La colonne vertébrale doit suivre la forme naturelle (cambrée à l'endroit du 5ème
vertèbre lombaire là où il y a une légère bascule du bassin).
Les bras non collés au corps, les coudes légèrement courbés, les mains (l'une posée sur
l'autre) posées sur les cuisses devant le point d'énergie (se trouvant environ 3 doigts sous le
nombril), on cultive des expirations abdominales longues et profondes (l'inspiration se fait
toute seule après chaque expiration longue), en restant immobile. Le méditant se livre à la
bhàvanà (lit. "création mentale"6, par extension "répétition") c'est-à-dire qu'il répète souvent
intérieurement une formule, par exemple, "Hommage à lui le Béni, le Très saint, le
Parfaitement éveillé"7, trois fois en un seul souffle.
Quand les pensées arrivent et parfois encombrent l'esprit, il ne faut pas chercher à les
retenir et se concentrer uniquement sur la bonne posture et sur les expirations abdominales
longues.
Pendant la méditation, il faut reste vigilant, c'est-à-dire, ne pas tomber dans la
passivité, ni s'endormir8
Cette technique de méditation se retrouve à peu près similairement dans les églises de
Theravàda et de Mahàyàna.
Voici des exemples sommaires de quelques techniques pratiquées chez les bouddhistes
du Theravàda dans l'Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge:
1- Les kasina (fixer l'objet visible/concentration).
5E. Conze, Le bouddhisme, Paris, Payot, 1971, p. 115.
6Cette "création mentale" se définit par l'effort de l'adepte qui passe en revue les vérités et "objets d'acquisition"
que propose l'enseignement. Ses deux applications sont le samantha (tranquillité) et la vipasssana (inspection).
Cf. F. Bizot, Le chemin de Lankà, Paris, Publ. EFEO, 1992, p. 304.
7Namo tassa bhagvato arahato sammasambuddha (3 fois),: litt. cela signifie "Hommage au Buddha qui,
(atteignant la Perfection de l'Eveil) est un Saint, un Bienheureux".Cette formule doit être récitée trois fois par les
bouddhistes avant de commencer la méditation ou toutes les activités religieuses. Ensuite, ils doivent également
répéter trois fois une autre formule: Buddham saranam gacchami, dhammaµ saranam gacchami, sangham
saranam gacchami: "Je prends refuge en le Buddha, je prends refuge en la Loi, je prends refuge en la
Communauté" (3 fois). Cf. San Sarin, Les textes liturgiques fondamentaux du bouddhisme cambodgien actuel,
thèse de EPHE, IVe section, Paris, 1975, 225 p.; voir également Olivier de Bernon, Le manuel des maîtres de
kammatthàn. Étude et présentation de rituels de méditation dans la tradition du bouddhisme khmer, thèse de
doctorat sous la direction de Pierre Lucien Lamant, Paris, Inalco, 2000, 828 p.
8Cf. Dr. Ikemi et Taisen Deshimaru, Zen et self-control, Paris, Albin-Michel, 1985.

3
2- Les anussati (rappel au souvenir, récollection): Buddha, Dhamma, Sangha.
3- Les 4 demeures de Brahma (Brahmavihàra): metta, amour, karuna, compassion,
mudita, joie altruiste, upekkhà, équanimité.
4- Anàpànàsati: l'attention au va-et-vient du souffle et la technique centrale, celle
qu'utilisa le Bouddha pour atteindre le nibbàna.
Dans le bouddhisme theravàda, le sujet de méditation est donné par le maître. Il relève
de l'un des deux groupes suivants:
1) Les jhàna, en pàli, lit. "absorption" (sujet de méditation), sont des moyens pour
transcender le choc des stimulants sensoriels et de nos réactions normales à ce choc. On
commence l'exercice en se concentrant sur un stimulant sensoriel, par exemple sur un cercle
fait de sable rougeâtre, ou de fleurs bleues, sur un bol d'eau ou sur une image du Bouddha
(première étape s'achève quand on est en état d'annuler pour un temps donné des tendances
malsaines9 (attention et concentration qui mènent au jhàna),
2) Les illuminés (appamàna) sont des méthodes pour cultiver les émotions. Ils
comportent 4 stades: amitié, compassion, joie sympathisante et équanimité.10
Vipassana
"L'orientation nouvelle de la méditation est spectaculaire en Thailande où de vastes
centres d'accueil, souvent gérés par les laïcs, ou des ensembles monastiques comme celui de
Rangsrit à Nantaburi ou celui de Suon Mokh près de Chaiya voient s'accroître d'année en
année le nombre de méditants. Les buts de ces techniques, notamment de la méditation dite
"vapassana kammatthana", méthode d'introspection centrée sur le corps, sont exposés dans de
nombreux ouvrages"11. Le courant de ce genre de méditation devient à la mode au Cambodge
depuis les dix dernières années. Le Professeur Chheng Phon, ancien ministre de la culture du
gouvernement communiste de la République Populaire du Kampuchea (Cambodge) en 1979-
90, après sa retraite forcée, a créé un "Centre pour la culture et de vipassana"(Majjhamadala
vappadharm nin vipassanà, Center for Culture and Vipassanà) implanté à Prèk Ho dans la
province de Kandal, proche de Phnom Penh12. L'orientation nouvelle de la méditation est
également spectaculaire au Cambodge actuel. Quelques énormes centres de méditation de
plusieurs hectares ont été créés récemment à Oudong au pied de la Montagne royale
(Vipassana Thurak Buddhist Centre of Kingdom of Cambodia) et à Kandal (Buddha Mandala
Kampuchea). Ces deux centres ont été subventionnés une grande partie par les Cambodgiens
vivant à l'étranger (Etats Unis, Australie, France...).
Vipassana signifie "vision profonde". "La vision pénétrante constitue le moyen
nécessaire, qu'il ait été cultivé seul ou après un détour plus ou moins long par la voie de la
tranquillité, étant entendu que même sans atteindre ni cultiver les Jhæna, un degré minimum
de concentration permet seul la pratique fructueuse de la vision pénétrante."13 Dans la
littérature bouddhique, nous trouvons plusieurs paraboles montrant la voie du milieu afin de
trouver la tranquillité, la sérénité et l'éveil.
Le luth accordé
9Cf. E. Conze, op. cit., p. 116
10Ibid, p. 117-118
11S. Thierry, op.cit., p. 12.
12Après l'année 2000, il y a de création d'autres centres de vipassanà dont l'un se situe à Oudong au pied de
« Montagne royale » (Bhnam Brah ràj drabv) qui porte le nom en anglais "Vipassana Thurak Buddhist Centre of
Kingdom of Cambodia" et l'autre dans un terrain de plusieurs hectares dans la province de Kandal portant le nom
de "Buddha Mandala Kambujà"(Centre bouddhiste du Cambodge). Ces grands centres ont été subventionnés
notamment par les communautés cambodgiennes à l'étranger (Etats Unis, Australie, Europe...)
13Jean-Pierre Schnetzler, La méditation bouddhique, Paris, Dervy-Livres, 1988, p. 93.

4
Parabole du chemin du milieu:
Le Bouddha se livre à la méditation et au jeûne (dukkhara kiriya) pendant six ans. Il
devint très maigre, n'eut que la peau sur les os. Mais il ne trouvait pas l'illumination. Dans le
silence total, il vit Indra descendre du ciel pour jouer du luth devant lui. Le roi des trente-trois
dieux, accorda son instrument en lâchant trop les cordes. Celles-ci ne donnèrent pas de ton
juste. Puis, il tendit fortement. Elles se cassèrent. Enfin, il remplaça ces cordes cassées en les
serrant moyennement. Le luth donna le ton juste. A partir de ce moment, le Bouddha comprit
et commença à se nourrir correctement et continua sa méditation jusqu'à l'obtention de
l'éveil.14
Une autre parabole du chemin du milieu (Vinay, mahàvagga V, p. 194)
Le vénérable Sona (Sona Kolivisa), aussitôt après avoir reçu l'ordination supérieure,
s'était établi dans le bosquet de Sitavana.
Tandis que, dans sa détermination pleine de zèle, il allait et venait, il se blessa les
pieds et l'endroit où il se promenait fut bientôt couvert de sang comme un abattoir de bœuf.
Puis, tandis que, retiré dans la solitude, le vénérable Sona se livrait à la méditation profonde,
cette pensée lui vint à l'esprit: "Quoique je sois un de ses disciples du Bienheureux qui vivent
dans la pratique des efforts soutenus, mon esprit n'est cependant pas arrivé à la délivrance des
corruptions qui résulte de la suppression des désirs. Et ma maison est remplie de richesses qui
m'attendent. Il est possible à la fois de profiter de ces richesses et d'accomplir des actes
méritoires. Et bien! je rentre dans la condition inférieure, pour profiter de mes richesses et
faire de bonnes actions".
Alors, le Bienheureux comprit la pensée du vénérable Sona: et, aussi rapidement qu'un
homme vigoureux peut étendre le bras ou le replier après l'avoir étendu, il disparut de la
colline du Pic du Vautour et apparut dans le bosquet de Sitavana. Alors le Bienheureux étant
passé par les dortoirs, arriva avec d'autres moines à l'endroit où le vénérable Sona s'était
promené (...).
Alors, le Bienheureux se rendit à la maison où demeurait le vénérable Sona, et là, il
s'assit sur un siège préparé pour lui. Et le vénérable Sona s'inclina devant le Bienheureux et
s'assit à son côté. Alors, le Bienheureux dit au vénérable Sona: "N'est-il pas vrai, Sona, que
lorsque retiré dans la solitude vous vous livrez à la méditation profonde, cette pensée vous est
venue à l'esprit: "Quoique je sois un de ces disciples du Bienheureux qui vivent dans la
pratique des efforts soutenus, mon esprit n'est cependant pas encore parvenu à la délivrance
des corruptions qui résulte de la suppression des désirs. Et ma maison est remplie de richesses
qui m'attendent. Il est possible, à la fois, de jouir de ces richesses et d'accomplir des actes
méritoires. Eh bien! je rentre dans la condition inférieure (qui était la mienne auparavant) pour
profiter de mes richesses et accomplir des actes méritoires?"
"Oui, Seigneur."
14C'est une version orale et populaire concernant le chemin du milieu. Dans la version du Vinaya, texte
canonique, on trouve: "Dès que le Bodhisattva fut arrivé à cet endroit, il pratiqua des austérités pendant six ans.
Malgré cela, il ne peut voir de ses propres yeux de la doctrine suprême de la connaissance (jñàna) sainte (àrya)
suprême" (...) "Il eut encore cette pensée: "Est-ce que en pratiquant l'absence de désir et en abandonnant les
choses mauvaises que j'obtiendrai ce bonheur (sukha dharma)? Ce n'est certes pas à cause des souffrances que
j'utilise à mon corps que j'obtiendrai ce bonheur. A présent, ne vaut-il pas mieux pour moi manger un peu de riz
bouilli et de bouillie de grains grillés pour acquérir des forces suffisante?" Un peu plus tard, le Bodhisattva
mangea un peu de riz bouilli et de bouillie de grains grillés pour acquérir des forces suffisantes". A. Bareau,
Recherches sur la biographie du Buddha dans les Sùtrapitaka et les Vinayapitaka anciens: de la quête de l'éveil
à la conversion de Sàriputra et de Maudgalyæyana, Paris, Publ. EFEO, 1963, p. 48-52.

5
"Qu'en pensez-vous, Sona? Vous étiez un habile joueur de luth, n'est-ce pas, quand
vous apparteniez au monde?"
"Qu'en pensez-vous, Sona? Lorsque les cordes de votre luth étaient trop tendues, votre
luth donnait-il le ton juste? Etait-il dans de bonnes conditions pour que vous en jouiez?"
"Non, Seigneur".
"Qu"en pensez-vous, Sona? Lorsque les cordes de votre luth étaient trop lâches, votre
luth donnait-il le ton juste? Etait-il dans de bonnes conditions pour que vous en jouiez?"
"Non, Seigneur."
"Qu'en dites-vous, Sona? Lorsque les cordes de votre luth n'étaient pas trop tendues ni
trop lâches, mais avaient été fixées comme il convenait, votre luth donnait-il le ton juste?
Etait-il dans de bonnes conditions pour que vous en jouiez?"
"Oui, Seigneur."
"De même, Sona, l'effort excessif aboutit à une agitation stérile et l'effort insuffisant
conduit à l'indolence. En conséquence, ô Sona, astreignez-vous à obtenir l'équilibre de vos
forces, cherchez sans cesse l'équilibre de vos facultés mentales. Que cela soit l'objet de vos
pensées."
"Il en serait ainsi, Seigneur", dit le vénérable Sona; et il suivit le conseil du
Bienheureux.15
Histoires relatives à la méditation:
"En ce temps-là, Poukkousa, jeune Malla et disciple d'Alara-Kalama, suivait la grande
route de Koussinara à Pava. Et Poukkousa, le jeune Malla, aperçut le Bienheureux assis au
pied de l'arbre. A cette vue, il se rendit à l'endroit où se trouvait le Bienheureux et quand il y
fut arrivé, il salua le Bienheureux et s'assit respectueusement de côté, et une fois assis,
Poukkousa, le jeune Malla, dit au Bienheureux: "Quelle chose étonnante, Seigneur, quelle
chose merveilleuse que la tranquillité d'esprit de ceux qui ont renoncé au monde.
"Dans une circonstance antérieure, Seigneur, un jour qu'Alara-Kalama voyageait sur la
grande route, il s'en écarta et alla s'asseoir au pied d'un arbre pour y passer les heures chaudes
du jour. A ce moment, Seigneur, cinq cents chars vinrent à passer près d'Alara-Kalama. Et un
homme qui marchait en queue de convoi se rendit à l'endroit où se trouvait Alara-Kalama et
quand il y fut arrivé, il s'adressa en ces termes à Alara-Kalama:
"Avez-vous vu passer ces cinq chars, Seigneurs?"
"Non, mon ami, je ne les ai pas vus."
"Mais, Seigneurs, vous avez entendu le bruit produit par ces chars?"
"Non, mon ami, je n'ai rien entendu."
"Vous dormiez donc, Seigneur?"
"Non, mon ami, je ne dormais pas."
"Mais, Seigneur, étiez-vous en possession de tous vos sens?"
"Certes, mon ami."
"Ainsi donc, Seigneur, étant en possession de tous vos sens et éveillé, vous n'avez pas
aperçu les chars, vous n'avez pas entendu le bruit des cinq cents chars passant l'un après
l'autre près de vous? Mais, voyez donc, Seigneur, votre robe même est couverte de la
poussière soulevée par ces chars?"
"Il en est ainsi mon ami."
Et l'homme pensa: "Quelle chose étonnante! Quelle chose merveilleuse que la
tranquillité d'esprit de ceux qui ont renoncé au monde. Elle est telle qu'un homme éveillé et en
possession de ses sens n'aperçoit pas cinq cents chars, n'entend pas le bruit de cinq cents chars
passant près de lui."
15Cf. Rhys Davids, Gotama le Bouddha, Paris, Payot, 1951, p. 117-119.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%