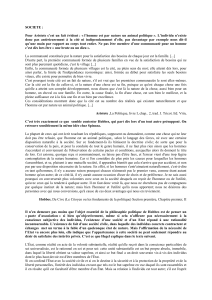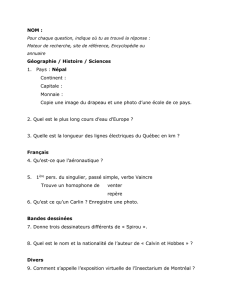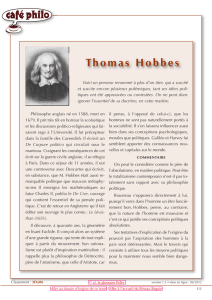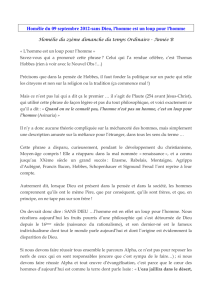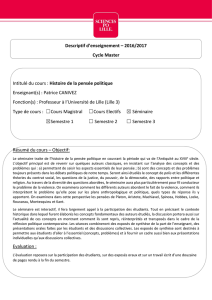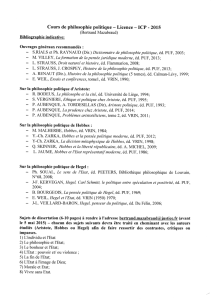EBook _securite - Implications philosophiques

www.implications-philosophiques.org 1
Sociétés contemporaines
et sécurité

www.implications-philosophiques.org 2
Sociétés contemporaines
et sécurité
Implications philosophiques
Dossier Printemps 2010
Coordination :
Hélène L'Heuillet - Thibaud Zuppinger

www.implications-philosophiques.org 3
Sociétés contemporaines et sécurité
• Thibaud Zuppinger, Présentation
• Hélène L'Heuillet, Introduction.
Thématique
• Thierry Oblet, Peut-on parler de sécurité sans être suspecté
d'obsession sécuritaire ?
• Aurélien Faravelon, Vie privée et dispositifs de sécurité
• Robert Chaouad, Les frontières de la sécurité.
• Dominique Weber, Léviathan, la sécurité et le monde liquide.
• Elodie Djordjevic, Sécurité et politique : sur qui et quoi porte la
sécurité ?
• Bastien Nivet, La sécurité comme condition du politique ?
Focus
• Séverine Germain, Un contrôle institutionnel renouvelé : la
vidéosurveillance de voie publique
• Marie des Neiges Ruffo, Technologie et peurs instinctives :
qu’est-ce que la RFID ?
• Samson David, La biométrie, un cas d'espèce d'entrelacement
entre sécurité et liberté ?
Prolongements
• Henri Bah, Pour une compréhension de la diplomatie des droits
de l’Homme à partir de Nietzsche et Bergson.
• François Carrière, La nature comme menace

www.implications-philosophiques.org 4
Présentation
Thibaud Zuppinger
Pourquoi la sécurité ?
Ce deuxième dossier des Implications philosophiques est consacré à la
notion de sécurité. Il ne s’agit évidemment pas de clore une fois pour toute la
question, ni de fournir un panorama exhaustif. Bien au contraire, s’il est une
conviction qui se dégage de l’ensemble de ces articles, c’est qu’il s’agit là d’un
débat inhérent à nos sociétés contemporaines, inhérent aux sociétés libérales et
que la plus grande menace réside très certainement dans la désertion civique, ou
l’abandon intellectuel de ce débat. L’existence de ce dossier n’a d’autre ambition
que d’encourager la réflexion, d’examiner les outils d’analyse dont nous
disposons afin de mieux comprendre et d’agir aujourd’hui.
Difficultés méthodologiques
Toutefois, ce travail d’élucidation s’est heurté, dans son élaboration, à
deux types de difficultés. D’une part une médiatisation intense qui parasite la
pensée, et d’autre part un champ de recherche si vaste qu’il semble impossible
d’en proposer une vue d’ensemble.
En un sens, c’est cette médiatisation du concept de sécurité qui nous a
donné la conviction qu’il fallait procéder à une analyse dépassionnée (ce qui ne
signifie pas apolitique) de ce débat – une mise en perspective pour en cerner les
implications philosophiques. Pour reprendre le titre de l’article de Thierry Oblet :
peut-on parler de sécurité sans être suspecté d’obsession sécuritaire ? Nous
avons fait le pari que cette possibilité existe encore.
Restait l’immensité du sujet. Afin d’éviter les regards biaisés ou
incomplets, il a été décidé d’accueillir dans ce dossier les approches pluri-
disciplinaires qui permettent de multiplier les postures sur cet objet conceptuel,
central ici, qu’est la sécurité. On trouvera ainsi dans ce dossier des analyses
issues des grilles méthodologiques des relations internationales, de la science
politique, de la sociologie, de l’histoire de la philosophie et de la philosophie
éthique et politique.
Diversité des horizons et unité problématique
Une multiplicité d’approches n’a évidemment de sens que lorsque celles-
ci sont appliquées à traiter un objet commun. Or c’est précisément cette unité
qui semble faire problème : « plutôt que de chercher à remplir abusivement la
notion de sécurité par un contenu, il est plus juste d’en préserver
l’indétermination. » (Hélène L’Heuillet – Introduction)
Par conséquent, il a été choisi d’articuler ce dossier autour de trois
problématiques qui nous sont apparues comme structurant de façon
relativement complète le débat contemporain sur les questions de sécurité.

www.implications-philosophiques.org 5
Le premier axe retenu s’efforce de clarifier les usages qui sont faits de ce
terme dans une perspective quasiment analytique d’élucidation des concepts (H.
L’Heuillet, T. Oblet A. Faravelon). Le deuxième faisceau problématique s’attache
à reconstituer la construction historique de ce concept, en fournir une sorte de
généalogie philosophique (D. Weber, E. Djordjevic, H. Bah) – mais aussi
institutionnelle (R. Chaouad, B. Nivet). Enfin, la troisième problématique se
consacre plus spécifiquement sur l’articulation théorie/pratique en examinant
des cas empiriques de dispositifs de sécurité (S. Germain, S. David, MdN Ruffo) et
confronter en retour l’aptitude des outils intellectuels à appréhender
correctement ce qui se déploie aujourd’hui (F. Carrière).
Un mot, avant de conclure, pour remercier l’ensemble des auteurs qui
ont tant apporté à ce dossier, par la qualité et l’originalité de leur article, par
leurs suggestions et leurs remarques. La rédaction tient également à remercier
tout particulièrement Hélène L’Heuillet qui a accepté de co-diriger ce dossier.
En vous souhaitant une bonne lecture,
Thibaud Zuppinger
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
1
/
130
100%