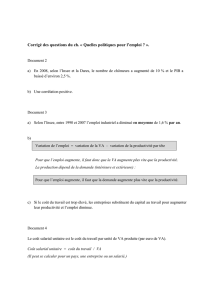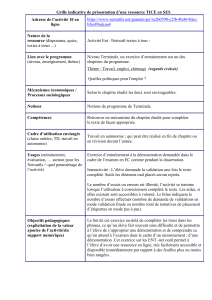tes_ses_2_cned_cours

Séquence 3-SE01 63
Travail et emploi
>
© Cned – Académie en ligne

Sommaire séquence 3-SE01 65
Chapitre 1 > Organisation du travail et croissance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
A
Du taylorisme au toyotisme, ou comment l’organisation du travail favorise la
croissance
Les principes d’organisation du taylorisme et du fordisme
La crise du fordisme
Le système Toyota
B
Nouvelles formes d’organisation et conditions de travail
Les principes « toyotistes »
Les effets de cette nouvelle organisation.
Chapitre 2 > Croissance, progrès technique et emploi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
A
Les évolutions du monde du travail : Les formes d’emploi en mutation
Durant les trente glorieuses s’est constituée une norme d’emploi...
...que la crise économique des années 1980 remet en cause.
Quels sont les avantages pour l’entreprise de cette nouvelle gestion de la main-d’œuvre ?
B
Les stratégies de flexibilité ou la gestion flexible de la main-d’œuvre
On distingue plusieurs formes de flexibilité
La flexibilité et ses effets
C
Les effets du progrès technique sur l’emploi et le chômage
Une nouvelle relation entre croissance et emploi
L’impact des nouvelles technologies sur l’emploi
Le chômage et les analyses du marché du travail
© Cned – Académie en ligne

Séquence 3-SE01 67
Organisation du travail
et croissance
Introduction
Comment la division du travail favorise-t-elle la croissance ?
Depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle et la mise en œuvre des principes de la division du
travail d’Adam Smith, les économies de marché, dans les pays capitalistes développés, ont accru consi-
dérablement leur productivité et leur production de richesses.
Nous verrons si l’organisation du travail actuelle et les réponses qu’elle apporte à la crise qu’elle connaît
depuis le milieu des années 1970 sont à même de renouer avec la croissance.
De même, depuis le milieu des années 1970, le marché du travail connaît des évolutions considérables
qui portent à la fois sur les statuts, sur l’organisation et sur la place du travail dans nos sociétés.
Ces tendances donnent lieu à diverses interprétations :
Assiste-t-on à une remise en cause de la norme de travail qui s’était mise en place dans l’après seconde
guerre mondiale avec le développement du fordisme ?
Les nouvelles formes de travail remettent-elles en cause la condition salariale ?
S’agit-il de trouver des solutions à la crise du travail et au chômage de masse ?
ADu taylorisme au toyotisme, ou comment
l’organisation du travail favorise la croissance
Principes d’organisation du taylorisme
et du fordisme
F.W.Taylor (1856-1915) est un ingénieur américain qui a préconisé une organisation plus scientifique
du travail (l’OST) ; en cela il va rompre avec une organisation traditionnelle jugée pas assez productive
et qui permettait la « flânerie » des ouvriers.
En effet, ces derniers avaient le contrôle sur leur travail car ils étaient encore qualifiés dans l’exercice
de leur profession ; ils pouvaient donc imposer leur propre rythme.
Taylor pose les principes de l’organisation scientifique du travail :
Une division horizontale du travail qui parcellise les tâches : le travail devient du travail en « miettes ».
Le travail est « normé » c’est-à-dire que chaque ouvrier doit respecter des normes de gestes, précisément
définies, et des normes de temps, d’où l’introduction du chronomètre.
Une division verticale qui aboutit à la séparation des tâches de conception et d’exécution :
Un bureau des méthodes, avec des experts, décide de l’organisation optimale ; les contremaîtres sont
chargés de communiquer aux ouvriers les ordres concernant l’organisation, et de les contrôler.
Les ouvriers exécutent le travail selon les cadences imposées ; ils ne sont plus qualifiés et leur travail
devient monotone, répétitif et sans responsabilité.
© Cned – Académie en ligne

Séquence 3-SE01
68
Avec H. Ford (1863-1947) l’organisation du travail franchit une étape supplémentaire :
Ford invente le convoyeur mécanique qui permet le transport des pièces à travailler et rend inutile le
chronométrage.
Les pièces sont standardisées, ce qui diminue les coûts de production et permet de produire en masse.
Avec le fordisme, on accède à la production de masse.
D’autre part, Ford rend possible, avec le « five dollars day », l’ère de la consommation de masse.
En effet, en augmentant le salaire de ses ouvriers, il rend attractif le travail industriel mais il leur donne
aussi du pouvoir d’achat. Le fordisme se développera sur une grande échelle après la seconde guerre
mondiale. Selon R. Boyer, le « cercle vertueux fordiste » va permettre la croissance durable des trente
glorieuses.
La crise du fordisme
Le modèle fordiste a permis un « cercle vertueux » de croissance mais il va connaître, à partir des années
1970, des difficultés qui vont le rendre progressivement contre-productif.
Une crise du travail : les travailleurs acceptent de moins en moins bien une organisation qui rend
le travail monotone, répétitif et sans intérêt.
Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles à supporter.
Dès lors les taux d’absentéisme et les taux de turn-over augmentent, les grèves se multiplient.
Une crise de la demande : la relative saturation de la demande de biens de consommation cou-
rante (taux d’équipement proches de 100 %) et la demande de produits différenciés de la part des
consommateurs exigent une nouvelle façon de séduire ces derniers.
Une crise de l’offre : les gains de productivité nécessaires au modèle fordiste ralentissent et les
nouvelles technologies nécessitent de modifier le processus de production pour satisfaire la nouvelle
demande. Les nouvelles technologies, grâce à l’électronique et l’informatique, donnent aux entreprises
les moyens de flexibiliser la production.
Pour retrouver une compétitivité et une croissance, les entreprises doivent s’adapter sous peine de
disparaître face à la concurrence.
Le système Toyota
Avec la crise du fordisme dans les années 1960-1970, et avec la révolution technologique en cours, la
question est de savoir quelle organisation du travail il faut mettre en place pour retrouver la croissance
économique.
Toutes les tentatives pour sortir du taylorisme, qu’on qualifie souvent de « post-taylorisme », ont en
commun de reconnaître au facteur humain une nouvelle place, et d’établir une nouvelle relation entre
le travail, la technique et le client.
Dès la fin des années 1980 est apparue au Japon une nouvelle organisation du travail, popularisée
sous le nom de « toyotisme ».
Ce post-taylorisme s’est diffusé dans la plupart des pays industrialisés à la recherche d’une solution à
leur crise du travail.
Comment caractériser ce système ?
Au niveau du travail : le modèle taylorien, trop hiérarchique et disciplinaire, doit être remplacé par
l’implication des travailleurs, et ceci nécessite la polyvalence de ces derniers ; il faut enrichir le travail
de chacun, donner plus de responsabilités et compter sur la motivation du travail d’équipe.
© Cned – Académie en ligne

Séquence 3-SE01 69
Sur le plan de la rémunération, la responsabilité s’accompagne de formules d’intéressement, de primes
et de salaire au mérite.
La formation des salariés, la reconnaissance de leur savoir-faire, de leurs suggestions (grâce à des cercles
de qualité) sont désormais valorisées.
La contrepartie pour les salariés est : la sécurité de l’emploi, des perspectives de promotion, voire
l’emploi à vie dans les grandes entreprises japonaises.
Au niveau de l’entreprise : le mot clé est la
flexibilité
.
Il s’agit pour l’entreprise d’améliorer sa compétitivité, et la flexibilité des hommes et des outils est
indispensable.
Pour s’adapter à la demande plus exigeante des consommateurs il faut introduire un contrôle de qua-
lité de l’aval vers l’amont et non plus de l’amont vers l’aval typique du modèle taylorien autoritaire et
hiérarchique.
Des innovations dans la gestion de la main-d’œuvre, comme le Kan Ban, les flux tendus, les indicateurs
de qualité (les cinq zéros : zéro panne, zéro délai, zéro papier, zéro stock, zéro défaut) et de productivité
font partie, désormais, du succès de ce modèle.
Le but est de réduire les stocks coûteux, de ne fabriquer un bien qu’en fonction de la demande ; ten-
dre les flux permet de faire peser la pression du délai de livraison sur tous les postes de la chaîne de
production.
C’est la demande qui commande, et non plus l’offre comme dans le modèle taylorien.
Ce nouveau modèle productif rompt avec bien des aspects du taylorisme et du fordisme par les exigences
de polyvalence de la main-d’œuvre et de la reconnaissance de sa qualification, ainsi que par le souci
de flexibiliser les hommes et les outils grâce aux nouvelles technologies.
Cependant, pour bien des auteurs, s’agit-il vraiment d’un nouveau modèle ou de la continuation du
modèle taylorien sous d’autres formes : plutôt un néo-taylorisme qu’un post-taylorisme ?
Document 1
:
Les principes du toyotisme
B
Nouvelles formes d’organisation et conditions de travail
Les principes « toyotistes »
se traduisent-ils dans les statistiques sur l’autonomie dans le travail, les normes de qualité et la poly-
valence des hommes ?
© Cned – Académie en ligne
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%