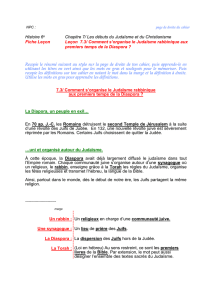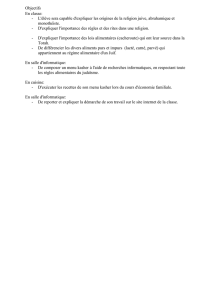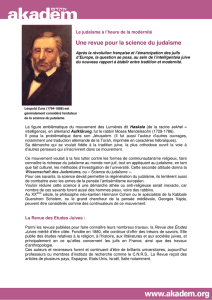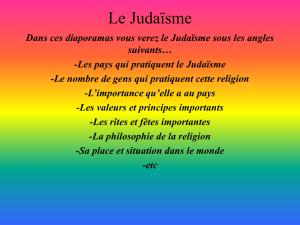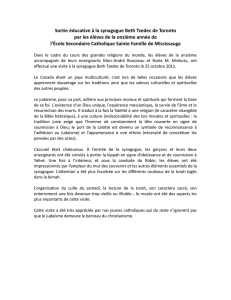NOTRE JUDAISME

le shofar
r e v u e m e n s u e l l e d e l a c o m m u n a u t é i s r a é l i t e l i b é r a l e d e b e l g i q u e
s y n a g o g u e
b e t h h i l l e l
b r u x e l l e s
N° d’agréation P401059 JUILLET/AOÛT 2007 — N°286 / AV/ELOUL 5767
Le Judaïsme libéral belge: qui sommes-nous?
Réformateur ou hérétique?
Sur le Rabbin Samuel Holdheim (1806-1860)
NOTRE JUDAISME

r e v u e m e n s u e l l e d e l a
c o m m u n a u t é i s r a é l i t e
l i b é r a l e d e b e l g i q u e
EDITEUR RESPONSABLE :
Rabbin Abraham Dahan
COORDINATION :
Jacqueline Wiener-Henrion
COMITÉ DE RÉDACTION :
Rabbi Abraham Dahan, Rabbi
Floriane Chinsky, Ralph Bisschops,
Serge Boruchowitch, Gilbert
Lederman, Philippe Lewkowicz,
Jacqueline Wiener, Emmanuel Wolf
ONT EGALEMENT COLLABORÉ A
CETTE LIVRAISON :
Rabbin Daniel Fahri, Rabbin François
Garaï, Rabbin Gunther Plaut,Henri
Lindner, Yaël Bienenstock, Nathanaël
Smadja, Martine Umflat
MISE EN PAGE :
www.inextremis.be
N°286 JUILLET/AOÛT 2007 / AV/ELOUL 5767
N° d’agréation P401059
Le Shofar est édité par la
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE LIBÉRALE
DE BELGIQUE A.S.B.L.
N° d’entreprise : 408.710.191
Synagogue Beth Hillel
80, rue des Primeurs,
B-1190 Bruxelles
Tél. 02 332 25 28
Fax 02 376 72 19
www.beth-hillel.org
CBC 192-5133742-59
RABBINS : Abraham Dahan
et Floriane Chinsky
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Avishaï Ben David, Patrick Ebstein,
Paul-Gérard Ebstein, Ephraïm
Fischgrund, Josiane Goldschmidt,
Gilbert Lederman, Philippe Lewkowicz,
Willy Pomeranc, Elie Vulfs, Serge
Weinber, Jacqueline Wiener-Henrion,
Emmanuel Wolf.
Les textes publiés n’engagent que
leurs auteurs.
Image de couverture et photos :
Serge Weinber

Sommaire
05 LE MOT DU PRÉSIDENT
Notre approche du judaïsme
par Philippe Lewkowicz
JUDAÏSME
Notre Judaïsme,
par Rabbi Abraham Dahan
Vérité et confiance, un judaïsme des lumières et
du ré-enchantement
par Rabbi Floriane Chinsky
Le Judaïsme libéral belge: qui sommes-nous?
par Jacqueline Wiener-Henrion
Réformateur ou hérétique? Sur le Rabbin
Samuel Holdheim (1806-1860)
entretien avec Ralph Bisschops, Dr. Phil.
Agenda
Qu’est-ce qu’un Juif religieux?
par le Rabbin François Garaï
Manger et agir kasher
par le Rabbin Daniel Farhi
Le mot clé «peut-être»
par le Rabbin Gunther Plaut
Quand l’Antiquité éclaire l’Actualité
par Henri Lindner
COMMUNAUTÉ
Yom Hashoa 5767: discours prononcé
par Rabbi Floriane Chinsky à Beth Hillel,
à l’occasion de l’office de commémoration
Nos Bné Mitsva, Yaël Bienenstock et Nathanaël
Smadja
D’un génocide à un autre
par Martine Umflat
Talmidi – Fête de fin d’année
Talmidi, le Talmud Tora de Beth Hillel
Beth Hillel accueille EUROJEWS
Quelques nouvelles d’Israël et d’ailleurs
Recettes pour les vacances
Informations utiles
15
31
40
07
08
11
15
24
26
27
29
31
35
38
40
28
43
43
41
42
11
47

Pour l’organisation de vos Simhot
Un nom:
Solange!
Un numéro:
0497.57.47.27!

le shofar
5
par Philippe Lewkowicz
« Une génération s’en va, une autre lui suc-
cède et la Terre subsiste éternellement »
(Ecclésiaste 1 :4)
Rabbi Abba ben Kahana déclare : Que
la génération qui arrive soit à tes yeux
comme celle qui est partie. Que tu ne dises
pas : si Rabbi Akiva était là, j’aurais été le
consulter ! Si Rabbi Zéra ou Rabbi Yoha-
nane étaient là, j’aurais été les trouver !
Mais considère la génération qui est la
tienne et le sage qui en fait partie comme
les générations passées et les sages d’an-
tan.» (Midrash sur Ecclésiaste 1 :4)
Le 3 juin dernier, lors de son émission, le
rabbin Josy Eisenberg présentait le nouveau
livre d’Isabelle Levy « Vivre en couple mixte
– quand les religions s’emmêlent ». L’auteur
et l’animateur exposaient les motivations
et les difficultés rencontrées par ces cou-
ples, qui représentent parfois plus de 50 %
des mariages dans certaines communautés.
Etaient bien sûr évoqués le taux très im-
portant de divorces, le problème identitaire
des enfants, l’intégration familiale, etc… Je
retiens surtout, aujourd’hui, l’évocation que
fit le rabbin Eisenberg sur la source d’assi-
milation importante que constitue ce type
d’union. Il constate le fait, le regrette et
malgré l’importance du phénomène, il n’ap-
porte aucune réflexion sur une solution ou
une approche de celle-ci. Ainsi, il n’évoque
pas, fut-ce de manière indirecte, l’approche
du Judaïsme progressiste qui pourtant sau-
ve la communauté juive américaine.
On pouvait s’y attendre, mais tant que des lea-
ders de communautés orthodoxes nous consi-
déreront comme un danger au lieu d’être des
alliés, ils passeront à côté de cette menace, si
importante pour la pérennité du peuple juif.
Notre approche moderne du Judaïsme, où
ce qualificatif ne veut rien dire d’autre que
permettre de vivre un judaïsme libre et in-
tégré mais toujours éclairé par les textes de
nos pères, permet à de nombreux jeunes de
s’épanouir dans une tradition familiale non
coercitive. Ainsi, au lieu de rejeter parfois
définitivement cet héritage, ils gardent en
mémoire la douceur de ce qu’ils ont vécu et
le moment venu, ils voudront à nouveau y
tremper leurs lèvres pour partager ce miel
avec leur famille. Après tout, d’innombra-
bles textes de la tradition nous invitent à
l’accueil (midrach Yalkout Shimoni – Bo
12) et évoquent la prise de conscience et la
responsabilisation progressive («On ne pèse
pas sur celui qui vient de se convertir, on
ne se montre pas tatillon» Yevamot 47a)
Bien sûr ce schéma est fort simple, mais il
résume peut-être assez bien l’aboutissement
désiré de la démarche: réussir la transmis-
sion.
Mais, pour en arriver là, le chemin fut long
et long encore il sera. L’histoire du judaïsme
libéral commence en Allemagne au milieu
du XIXème siècle pour « d’une part intégrer
la modernité à la tradition juive libérée du
ghetto, tout en restant fidèle au judaïsme ;
d’autre part endiguer une assimilation gran-
dissante en proposant aux Juifs des répon-
ses plus conformes aux réalités historiques
et mieux adaptées au changement des men-
talités »(1).
LE MOT DU PRÉSIDENT
(1)
Pierre Haïat dans l’introduction de son « Anthologie du Judaïsme Libéral » (Pierre Haïat et Rabbin Daniel
Farhi : éd Parole et Silence, 2007)
Notre approche du judaïsme
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%