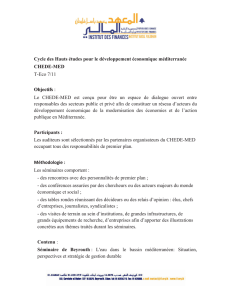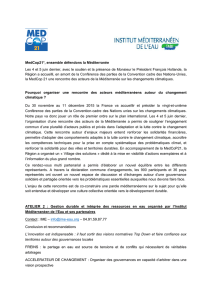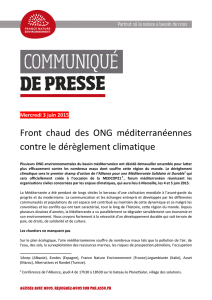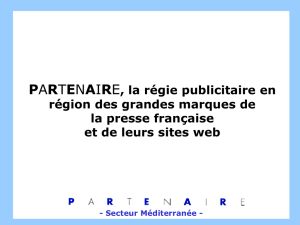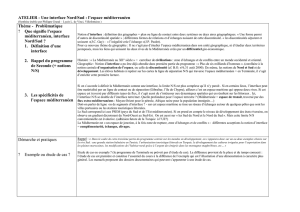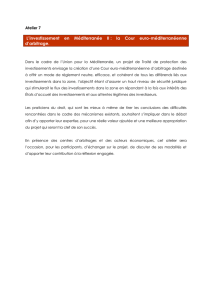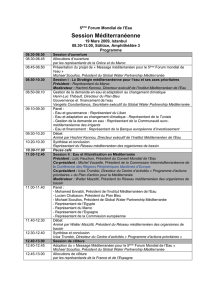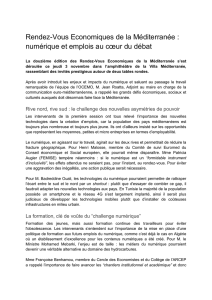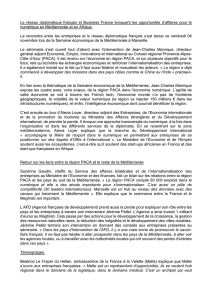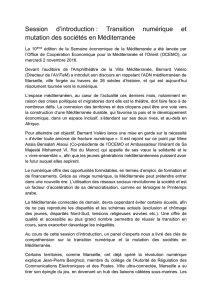Comment repenser la Méditerranée aujourd`hui ? Processus socio

Page 1 sur 6
Comment repenser la Méditerranée aujourd’hui ?
Processus socio-économiques, politiques et juridiques
1. La reconfiguration d’espaces sociopolitiques
L’histoire longue de l’espace méditerranéen est jalonnée de brassages, de métissages,
mais aussi de violences, de conflits, d’exclusions, avec leurs ressorts idéologiques
religieux ou racialistes qui constituent autant de prismes pour saisir le rapport à l’altérité
et dont les colonisations, les nationalismes et trois génocides furent les expressions les
plus douloureuses. Que reste-t-il de cette histoire dans les constructions
contemporaines de la Méditerranée ? Les empires ou les États, et les modèles politiques
et juridiques qui en sont issus (depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours), jouent-ils un rôle
dans la structuration ou dans la fragmentation contemporaine de l’espace
méditerranéen ?
A cette longue durée, doit s’ajouter, à différents niveaux d’analyse (macro, méso, micro),
une interrogation plus contemporaine sur les grandes transformations induites par
l’urbanisation et l’industrialisation rapide, les transitions démographique et économique,
les transformations des rapports au politique et aux liens sociaux primaires et
secondaires. Des mouvements sociaux se développent et engendrent de nouvelles
formes d’organisation sociale, des nouvelles façons de faire de la politique. Quels sont
les acteurs de ces processus de transformations sociale et politique ? On pourra aussi
s’interroger sur la réception et la mise en œuvre des grands textes de réglementation
européenne et internationale en Méditerranée. Quelles réceptions et formes de
résistance au niveau local ? Des enjeux de démocratie se posent dès lors, propres à
chaque pays, avec une reconfiguration des relations entre sécurité, démocratie et
liberté.
2. Frontières et circulations
La Méditerranée comme mer est une route de migrations, une zone de connexions, de
circulations et de refuge. Une approche diachronique pourrait être proposée sur les
modèles politiques et économiques en Méditerranée depuis l’Antiquité (voire depuis des
périodes antérieures), sur les villes et leur organisation, les processus de construction
des marchés du travail nationaux et méditerranéens, les infrastructures portuaires, sur
leurs empreintes territoriales actuelles et/ou sur les enjeux de la circulation formelle ou
informelle des biens et des populations.
Aujourd’hui, la Méditerranée devient de plus en plus un espace fermé et d’évitement des
circulations. Il y a actuellement une diversité de traitement et d’accueil des réfugiés

Page 2 sur 6
autour de la Méditerranée, avec au Sud des traitements très différents selon les États.
Comment et pourquoi les réfugiés « font crise » ou non, ou de manières différentes ?
Quel est le rôle des États dans la constitution des routes de la migration et dans la
gestion des mouvements migratoires ?
3. Transformations démographiques, différenciations sociales et formes
d’appartenance
De part et d’autre de la Méditerranée, on est confronté à des situations démographiques
contrastées mais, sur l’ensemble du pourtour, les questions de la place des femmes et
des jeunes sont souvent très centrales. Quelle(s) évolution(s) ont connu les rapports
entre les genres et entre les générations ? Comment les tendances démographiques
éclairent-elles cette question ? Quels impacts ont sur les relations entre genres et entre
générations, les évolutions juridiques au niveau de la famille et du travail ? Par ailleurs,
comment dans une insécurité ontologique et un « polythéisme des valeurs » croissant,
les jeunesses méditerranéennes trouvent-elle une orientation ?

Page 3 sur 6
Comment repenser la Méditerranée aujourd’hui ?
Processus culturels et dynamiques patrimoniales. Circulation des savoirs et des objets
1. Circulations des savoirs et des objets dans les cultures méditerranéennes
Dans le temps long, l’espace méditerranéen peut être considéré comme un espace de
partage de savoirs, d’idées et d’objets culturels, depuis les mathématiques, la médecine, la
littérature, les traductions, la musique, les conceptions de l’esthétique ou les pièces
archéologiques. Il est également le cadre d’affrontements, de hiérarchisation et de division
sociales entre des groupes politiques qui portent, défendent ou font circuler ces divers
objets et ces disciplines.
L’étude du transfert des savoirs et des objets en Méditerranée et sur ses marges, proches ou
plus lointaines, seront au centre d’un questionnement sur la place de ces partages et de ces
oppositions dans la constitution des cultures méditerranéennes, leurs rôles et usages
politiques à l’échelle internationale, notamment dans le cadre de l’émergence des États et
de la patrimonialisation.
Ces circulations et dynamiques pourront être interrogées de manière diachronique,
interdisciplinaire et en tenant compte des conditions matérielles et idéologiques qui les
contraignent ou qu’elles tentent de subvertir : supports physiques des échanges (écrit,
reproduction visuelle, traduction-translitération, conservation muséale, bibliothèque,
enseignement, internet), mobilités forcées ou volontaires, échanges internationaux officiels
ou alternatifs, réseaux transnationaux, diaspora, patrimonialisation, conflits,
instrumentalisation, etc.
2. La construction socio-économique et politique des biens culturels
Par qui et comment les biens culturels sont-ils manipulés, patrimonialisés ou détruits en
Méditerranée ? Il sera nécessaire d’envisager la diversité des procédés, des outils et des
intervenants dans les processus de circulation et mettre en question l’éventuelle spécificité
du contexte méditerranéen à travers des démarches comparatives et interdisciplinaires.
Les biens culturels en Méditerranée s’inscrivent en effet dans une économie au sens large
(marché, acteurs, régulations) qui fonctionne à plusieurs échelles spatiales, temporelles,
organisationnelles, institutionnelles, juridiques.
Plusieurs perspectives peuvent être envisagées, dont celles qui portent sur les institutions
(fondations, musées, bibliothèque, archives, organisations touristiques, organismes de

Page 4 sur 6
formation et de recherche...), les individus (depuis le défenseur du patrimoine à l’expert, en
passant par le passeur culturel ou le simple visiteur de musée), les spécialistes des
humanités (comment chercheurs, hauts-fonctionnaires, experts se positionnent-ils dans ces
jeux intellectuels et politiques), les normes et les valeurs (légitimation, hiérarchisation,
dynamiques).
3. Les objets et savoirs dans le processus de patrimonialisation
Le patrimoine ne peut donc pas être défini a priori, mais sa construction, sa définition et ses
usages doivent être analysés de manière critique et contextuelle. Que patrimonialise-t-on au
nom de la Méditerranée ou en Méditerranée ? Quelles sont les mutations culturelles ou les
discriminations sociales qui se jouent alors ? Quels types d’objets, de savoirs, de supports
sont privilégiés ? Que peut-on dire du croisement des dimensions matérielles et
idéologiques des patrimoines et des cultures ? La liste des objets de recherche est riche : les
manuscrits et leurs traductions, les collections muséographiques publiques ou privées, les
monuments et sites archéologiques, les paysages culturels, le patrimoine industriel, les
espèces végétales et animales, les mémoires collectives, les images, etc., mais également les
politiques publiques, initiatives privées, mécénats et mouvements associatifs locaux.

Page 5 sur 6
Comment repenser la Méditerranée aujourd’hui ?
Dynamiques territoriales et interactions hommes-milieux
1. Dynamiques territoriales dans la construction de la Méditerranée.
Affirmer l’existence d’un espace méditerranéen est le fruit d’une longue histoire culturelle et
de renégociations permanentes autour de dynamiques territoriales diverses à l’échelle du
pourtour méditerranéen. Il s’agira ici d’interroger cette unité et homogénéité territoriale et
culturelle supposée comme le résultat de dynamiques qui s’inscrivent dans des connexions
mondialisées. Comment les éléments naturels et anthropiques, les relations entre territoires
urbains et ruraux et les inégalités territoriales interviennent-ils dans cette construction et les
redéfinitions de cet espace ? Quelles sont les conséquences de sa fragmentation sur la
construction du territoire dit méditerranéen ? Les pratiques de la nature, les relations
hommes/milieux y ont-elles des formes spécifiques et/ou revendiquées qui contribuent à en
établir les limites ?
2. Dispositifs et usages des milieux et des ressources
Les éléments naturels présents sur le pourtour méditerranéen peuvent, selon les époques,
avoir été considérés ou non comme des ressources utiles et se prêter à des usages concrets
et symboliques divers. Comment les hommes et les femmes se sont-ils appropriés ces
ressources naturelles ? Leur appropriation implique la mise en place de dispositifs et
génèrent des formes de compétition/coopération, des conflits d’accès, des inégalités, la
mise en œuvre de réglementations coutumières ou juridiques, des stratégies de
confiscation. Comment ces dispositifs se déploient-ils et dans quelle mesure contribuent-ils
au marquage du territoire ? A quels savoir-faire, systèmes techniques et pratiques
d’exploitations ont-ils donné lieu et quels sont et ont été leurs impacts sur les écosystèmes
et leur gestion ? Les transformations de l’environnement génèrent-elles en retour de
nouveaux usages et des nouvelles formes d’appropriations ? Comment s’articulent les
modes de gestion traditionnels et l’idée contemporaine de protection (animaux et
végétaux) ?
3. Politiques publiques et usages locaux des éléments naturels
A chaque époque, les administrations publiques centralisées de l’aménagement du territoire
cherchent à composer avec les usages locaux. Comment les populations locales prennent-
elles en compte ces injonctions règlementaires dans une recherche de conciliation entre
l’exploitation et la préservation des ressources et éléments naturels ? Comment les normes
de gestion environnementales institutionnalisées sont-elles appropriées, détournées,
reformulées par les acteurs et groupes locaux ?
 6
6
1
/
6
100%