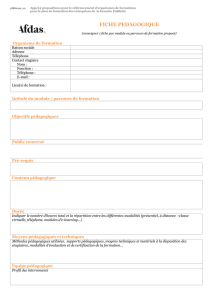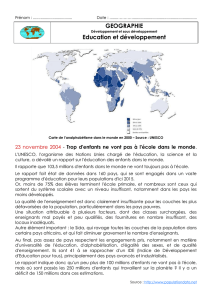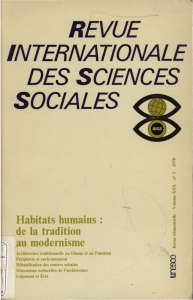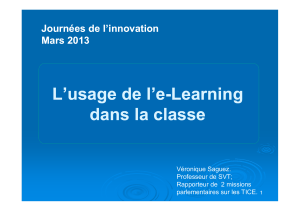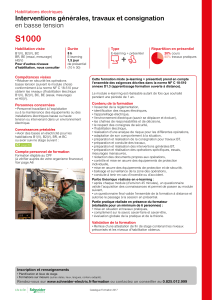Les Pays en développement à l`ère de l`e-learning

Christian Depover
François Orivel
Les pays en
développement
à l’ère de l’e-learning
UNESCO :
Institut
international
de planification
de l’éducation
Principes de la planification de l’éducation
96

Principes de la plani cation de l’éducation – 96

Les pays en développement
à l’ère de l’e-learning
Christian Depover,
professeur à l’Université de Mons
François Orivel,
directeur de recherche émérite au CNRS,
IREDU, Université de Bourgogne, Dijon
Paris 2012
UNESCO : Institut international de plani cation de l’éducation

Les idées et opinions exprimées dans cette publication sont celles des
auteurs et ne représentent pas nécessairement les idées de l’UNESCO
ou de l’IIPE. Les désignations employées dans ce document ainsi que
la présentation des données n’impliquent nullement l’expression d’une
quelconque opinion de la part de l’UNESCO ou de l’IIPE concernant le
statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de leurs autorités,
ni concernant le tracé de leurs frontières.
Les coûts de publication de cette étude ont été couverts par une
subvention de l’UNESCO et par les contributions volontaires de plusieurs
États membres de l’UNESCO dont la liste est donnée à la n de l’ouvrage.
Publié en 2012 par l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture
7 place de Fontenoy, F75352, Paris 07 SP
Conception couverture : Pierre Finot
Mise en page : Linéale Production
Imprimé par l’atelier d’impression de l’IIPE
ISBN : 978-92-803-2364-1
© UNESCO 2012

5
Principes de la plani cation de l’éducation
Les ouvrages de cette collection sont destinés principalement à
deux catégories de lecteurs : ceux qui occupent des fonctions dans
l’administration et la plani cation de l’éducation, tant dans les
pays en développement que dans les pays industrialisés ; ceux,
moins spécialisés – hauts fonctionnaires et hommes politiques,
par exemple – qui cherchent à connaître de façon plus générale
le mécanisme de la plani cation de l’éducation et les liens qui la
rattachent au développement national dans son ensemble. Ces
études sont, de ce fait, destinées soit à l’étude individuelle, soit à
des formations.
Depuis le lancement de cette collection, en 1967, les pratiques et
les concepts de la plani cation de l’éducation ont subi d’importants
changements. Plusieurs des hypothèses qui étaient sous-jacentes aux
tentatives antérieures de rationaliser le processus du développement
de l’éducation ont été critiquées ou abandonnées. Toutefois, si la
plani cation centralisée, rigide et contraignante, s’est manifestement
révélée inadéquate, toutes les formes de plani cation n’ont pas été
abandonnées pour autant. La nécessité de rassembler des données,
d’évaluer l’ef cacité des programmes en vigueur, d’entreprendre
des études sectorielles et thématiques, d’explorer l’avenir et de
favoriser un large débat sur ces bases s’avère au contraire plus vive
que jamais, pour orienter la prise de décisions et l’élaboration des
politiques éducatives. Personne ne peut faire des choix politiques
avisés sans évaluer la situation présente, en xant les objectifs, en
mobilisant les moyens nécessaires pour les atteindre et en véri ant
les résultats obtenus. Parce qu’elle élabore la carte scolaire, qu’elle
xe les objectifs, qu’elle entreprend et qu’elle corrige les erreurs,
la plani cation devient un moyen d’organiser l’apprentissage. La
plani cation de l’éducation a pris une envergure nouvelle. Outre
les formes institutionnelles de l’éducation, elle porte à présent sur
toutes les autres prestations éducatives importantes dispensées
hors de l’école. L’intérêt porté à l’expansion et au développement
des systèmes éducatifs est complété, voire parfois remplacé, par le
souci croissant d’améliorer la qualité du processus éducatif dans son
ensemble et de contrôler les résultats obtenus. En n, plani cateurs et
Institut international de planification de l'éducation www.iiep.unesco.org
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
1
/
98
100%