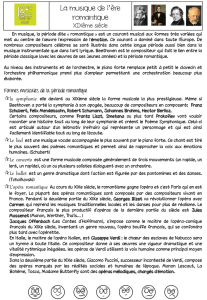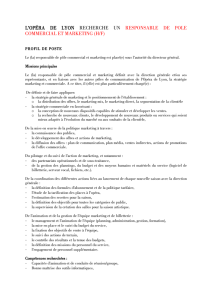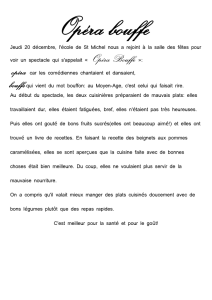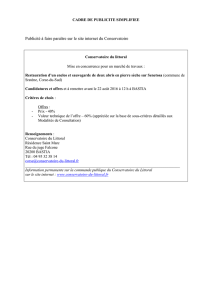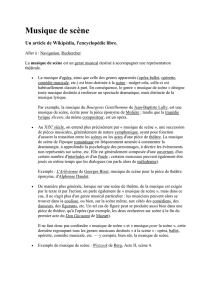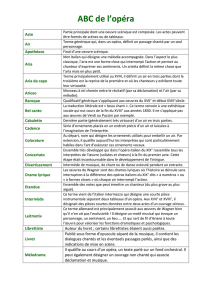programme du concert - Palazzetto Bru Zane

ÉTIENNE-NICOLAS MÉHUL
1817-2017
Bicentenaire de la mort du compositeur

2
SOMMAIRE
3
9
10
11
12
13
Connaissez-vous Monsieur Méhul ?
L’homme en quelques mots
Livre-disque : Uthal
Livre : Le Fer et les Fleurs
Disques autour du compositeur
Le Palazzetto Bru Zane

Connaissez-vous Monsieur Méhul ?
Alexandre Dratwicki
Le citoyen Méhul ouvre une route nouvelle
parmi les compositeurs.
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, 10 mai 1794
L’effigie d’Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817) trône aujourd’hui encore dans de nombreux lieux
de musique : que son nom orne une façade, son buste un foyer, son portrait un plafond d’opéra,
il est – comme Boieldieu ou Cherubini – le symbole d’une époque de l’histoire de la musique
française. Et ce, alors même qu’il ne fut plus guère joué à peine 10 ans après sa mort, si ce n’est
à l’occasion des reprises ponctuelles de Joseph tout au long du siècle… et à chaque fois que
la France en guerre trembla pour son salut, entonnant fièrement Le Chant du départ, hymne
révolutionnaire dont l’auteur ne pouvait assurément pas prévoir la longévité.
Il existe bel et bien un « mythe Méhul », fût-il nettement moins populaire que les légendes qui
entourent Mozart ou Beethoven. Toute cette imagerie née de la pensée romantique, cette glorification
qui n’existait pas pour les compositeurs baroques, s’appuie sur une passion du XIXe siècle pour la
vie secrète des artistes et leur destin d’exception. Mais deux catégories s’opposent : d’un côté les
auteurs « maudits » – devenu sourd comme Beethoven, mort trop jeune comme Mozart ou malade
et incompris comme Schubert –, de l’autre des figures plus lisses mais dont l’œuvre est brandie en
étendard flamboyant d’une école nationale :
Weber en Allemagne, Rossini en Italie, Méhul
– notamment – en France. Aux uns, l’anecdote sombre et personnelle, aux autres, la synthèse
lumineuse et universelle. Méhul est élu très tôt pour siéger dans ce cénacle des immortelles
gloires françaises. Certainement parce que les deux grandes « confréries » artistiques qu’il
participa à créer en 1795 – la classe des Beaux-Arts de l’Institut de France et le Conservatoire
de musique – avaient à disposition de quoi assurer la postérité de leurs membres les plus
prestigieux : la première définissait le Beau quand la seconde s’employait à l’enseigner. Et,
autour de 1815, le passé de la France postrévolutionnaire était bien trop récent pour qu’on se
prive de béatifier immédiatement après sa mort un compositeur de la stature de Méhul. De là
ces portraits gravés ou imprimés, ces médailles, ces bustes, ces blasons augustes qui ornèrent
et ornent toujours nombre d’édifices musicaux. Le centenaire de la Révolution, et ceux de la
naissance puis de la mort de Méhul, relancèrent périodiquement l’intérêt pour son souvenir.
Né sous l’Ancien Régime, l’homme a traversé les tumultes de la Révolution et les ors de l’Empire
pour mourir à l’aube de la Restauration. Sa musique est un parfait exemple de Sturm und
Drang à la française (appelons-le préromantisme « tourmenté ») : classique par ses formes, elle
3
aspire à une nouvelle esthétique, celle de l’expression du sentiment dans toute sa versatilité, et
plus volontiers dans ses méandres torturés ou pathétiques. Le style de Méhul balaye ainsi une
palette de coloris très large, allant de la pompe martiale (Adrien, Horatius Coclès) à l’affliction
intime (Mélidore et Phrosine, Euphrosine), en passant par le religieux (Joseph), le pittoresque
(Les Deux Aveugles de Tolède) et même l’exotisme de l’ossianisme, alors en pleine vogue (Uthal).
Si Méhul paraît plus à l’aise dans le style tragique, il laisse aussi quelques ouvrages légers (La
Dansomanie, Une Folie, etc.). À l’occasion du bicentenaire de sa mort, il paraît essentiel de
réaffirmer enfin l’importance de cet artiste en mettant notamment en lumière des facettes
restées méconnues de son catalogue.
Méhul et l’Histoire
Des études plus ou moins récentes, signées Adélaïde de Place, David Charlton ou Elizabeth
Bartlet, montrent la parfaite capacité de Méhul à épouser les courbes des revirements politiques
sans jamais renier sa personnalité artistique. Fut-il réellement le chantre le plus zélé de la
Révolution ? Il est sûr du moins que son Chant du départ, hymne patriotique à la mélodie
entêtante, est pour beaucoup dans cette image d’Épinal que la peinture romantique a même
immortalisé. Il est en tout cas certain que le compositeur ne rechigna jamais à l’ouvrage pour
fournir des pièces de circonstance honorant tel ou tel événement, et selon des contingences
pragmatiques souvent contraignantes. La musique de plein air, en particulier, requérait des
effectifs instrumentaux souvent limités aux instruments à vent dont il fallait parfaitement
connaître l’étendue et surtout les limites. C’est au Conservatoire que Méhul put se familiariser
avec la spécificité de chaque instrument, non pas comme élève mais comme inspecteur des
classes.
4
Timbre de 0,20 francs à l’effigie de Méhul, 1963

Méhul croyait que pour certains élans du cœur humain
il y a des accents mélodiques spéciaux
qui seuls les expriment dans toute leur vérité.
Berlioz, Les Soirées de l’orchestre
Méhul et les institutions
Âgé de 30 ans, Méhul est nommé à l’Institut national de musique – qui n’est pas encore tout
à fait le Conservatoire – le 21 novembre 1793. Il y occupera un rôle essentiel, tant dans la vie
quotidienne de l’école que dans le maintien de l’exigence élevé de ses objectifs. Et c’est sous le titre
glorifiant d’inspecteur que Méhul agira. Mais il reste à l’heure actuelle curieusement difficile de
savoir s’il exerça pleinement une activité de professeur de composition. À défaut de classe, on lui
connaît en revanche au moins un élève, et pas des moindres : Louis-Ferdinand Hérold, le futur
auteur de Zampa et du Pré aux clercs. C’est grâce à l’enseignement de Méhul qu’Hérold décroche
brillamment le prix de Rome en 1812 avec sa cantate La Duchesse de La Vallière.
Que Méhul ait été le professeur idéal pour obtenir ce prix ne fait aucun doute car, à l’instar de
Gossec et au contraire de Lesueur et Cherubini, Méhul siège au sein de la classe des beaux-arts
de l’Institut de France depuis sa création en 1795 : il assiste aux délibérations plénières et juge
chaque année les candidats du concours (à partir de 1803, date de sa création). Si l’occupation
d’un académicien n’est pas aussi prenante que celle d’un inspecteur du Conservatoire,
certaines tâches au long cours requièrent toutefois un réel engagement. Hormis l’organisation
et l’évaluation du prix de Rome, c’est surtout la publication collégiale d’un Dictionnaire de
l’Académie des beaux-arts qui va harasser Méhul pendant de longues années, entre 1810 et
1817. Car l’homme n’est pas du genre à refuser la besogne. D’autant qu’on lui prête une plume
solide et facile. Il avait d’ailleurs été sollicité pour la rédaction du Traité d’harmonie de Catel
et des méthodes de chant et de solfège du Conservatoire. À l’Institut, on reconnaît son écriture
dans beaucoup de rapports sur les envois de Rome ou dans les comptes rendus de brevets
musicaux soumis à la docte assemblée.
Cet engagement institutionnel se retrouve d’une autre manière au sein des théâtres lyriques,
peut-être plus involontairement. Car la soumission de Méhul à la politique – sinon par
conviction du moins par obligation ou calcul – fait de lui un compositeur « officiel » idéal pour
promouvoir certaines valeurs étatiques fortes. Sa carrière, ballottée d’une salle à l’autre dans
la décennie 1790, l’oblige à être attentif aux inclinations politiques des directeurs de salle et de
leur public. La vie mouvementée d’Adrien, opéra interdit en 1792 et créé dans des circonstances
rocambolesques en 1799, est peut-être l’épisode le plus représentatif du poids de la censure
pendant la période révolutionnaire. Mais des études historiques à paraître bientôt suggèrent
cependant que Méhul connut des périodes de disgrâces difficiles à traverser.
5
Méhul à l’ouvrage
À tout instant, Gossec fustigeait les « modernes ». Il écrivait à son élève Chelard : « Mélodie,
mélodie ! C’est le refrain des gens sensés et de la partie saine du public. Détours d’harmonie,
transitions barbares, chromatique outré, c’est celui des fous et des maniaques. Vous savez, mon
ami, que, de ce côté, nous voyons briller la majeure partie de nos jeunes musiciens français. »
Et d’ajouter plus loin : « [Guériront-ils] de cette fièvre modulatrice, de ce délire fruit de l’amour
du chromatique ? C’est ce que le temps nous apprendra. » À n’en pas douter, Gossec incriminait
là l’esthétique de Méhul dont le style particulièrement véhément s’appuie sur une harmonie
instable et volontiers modulante, chargée de septièmes diminuées. L’imagination de l’auteur
se retrouve tout autant dans sa capacité à revisiter le rythme (ce dont témoignent ses quatre
ballets-pantomimes) et à innover en matière d’orchestration (privant par exemple son opéra
Uthal de tout violon, ce qui occasionna le bon mot apocryphe de Grétry promettant de donner
un louis d’or pour entendre une chanterelle).
Mais la qualité de la musique de Méhul ne s’arrête pas à sa facture, si expérimentale et
innovante soit-elle. C’est sa dramaturgie même – c’est-à-dire sa maîtrise du rythme narratif, du
« temps scénique » – qui en fait le fleuron du premier romantisme. Euphrosine (1790) sembla
l’effet d’un coup de massue précisément par sa capacité à fusionner dans une progression idéale
les éléments dramaturgiques les plus divers.
Il y a là-dedans à la fois de la grâce, de la finesse,
de l’éclat, beaucoup de mouvement dramatique,
et des explosions de passion d’une violence
et d’une vérité effrayantes.
Berlioz, à propos d’Euphrosine et Coradin dans Les Soirées de l’orchestre
De ce pont de vue, une étude des récitatifs de Méhul serait à mener de manière systématique
car elle révèlerait sans doute une variété (et une évolution ?) qu’on trouve chez peu de ses
contemporains. D’un récitatif presque sans accompagnement (à la manière du « secco » italien)
dans certains passages d’Adrien (1791), Méhul évolue vers le récit accompagné de manière
systématique et chargée. Il n’est pas rare que ses œuvres de maturité fassent appel à un plus
grand orchestre dans un récit que dans l’air qui le suit. La fin des années 1790 voit également la
technique du mélodrame s’insinuer dans la texture opératique, et le panel d’effets dont regorge
par exemple Ariodant place Méhul à la pointe du progrès lyrique de son temps (combinant
des progressions « texte parlé => mélodrame => récit => air => ensemble »). Une telle
compétence théâtrale s’exprime également sans difficulté dans les genres théâtraux parlés, et
notamment dans celui, difficile, du mélodrame (musique de scène accompagnant la parole),
6

ainsi que l’a analysé Emilio Sala redécouvrant la partition des Hussites conservée à Bordeaux.
Enfin, le triomphe de l’ouverture du Jeune Henri souligne les capacités prémonitoires de la
pensée de Méhul, qui invente – sans le vouloir – le poème symphonique cinquante ans avant
que Liszt puis Saint-Saëns ne l’imposent en Europe.
Pour la première fois, des chiffres précis, révélés par Étienne Jardin dans un livre à paraître,
donnent une idée exacte de la présence de Méhul dans la vie musicale parisienne de son vivant.
Et l’on voit l’artiste connaître des revers de fortune au fil des créations, auquel il répond par
la production de genres nouveaux pour lui (la symphonie, notamment, à partir de 1808). On
observe aussi la persistance d’un certain opéra-comique pathétique (Joanna, Helena, Valentine
de Milan – ce dernier achevé par son neveu adoptif Joseph Daussoigne-Méhul) multipliant
les insuccès sous l’Empire alors que Méhul semble convaincu de son intérêt artistique. Cette
incompréhension de l’auditoire témoigne de la versatilité du goût du public. Et de la difficulté
de s’imposer durablement lorsqu’on fait figure de « compositeurs de transition » (comme l’écrit
Joël-Marie Fauquet dans son Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, pour déplorer
cette image convenue).
7
Postérité
De fait, la postérité de Méhul est paradoxale, comme nous l’écrivions pour commencer cette
introduction. S’il n’eut pas les obsèques flamboyantes d’un Grétry, mort en 1813, il ne disparaît
cependant pas dans l’indifférence. L’anecdote des élèves du Conservatoire chantant l’« Hymne
au sommeil » d’Uthal sur sa tombe semble véridique. Pour autant, sa postérité devra attendre
les années 1830 pour prendre son essor. Une nouvelle période du romantisme émerge de façon
sensible pour les penseurs et le public qui la vivent : l’éclosion du grand opéra, les aspirations
tragiques de l’opéra-comique sous la plume d’un Hérold ou d’un Boieldieu vieillissants, les
succès de Liszt et Paganini, l’inauguration de la Société des concerts du Conservatoire sont
légitimés par la revendication d’une ère nouvelle. Ce futur, écrit consciemment, s’appuie sur
un passé que l’on « muséifie » presque sans recul : Méhul, et avec lui Catel, Kreutzer, Dalayrac,
Grétry, Gaveaux, Isouard et tant d’autres, deviennent subitement les roses d’un jardin de
l’Histoire que l’orgueil français cultive avec fierté sans vraiment savoir si leurs ouvrages
traverseront le temps. Et ces fleurs délicates, qui laissent aujourd’hui le souvenir erroné d’une
élégance et d’une légèreté « à la française », sont pourtant les auteurs d’une « musique de fer1 »
élaborée en pleine période révolutionnaire dont on n’a plus guère conscience, malheureusement.
Quant à Méhul, en particulier, laissons Joël-Marie Fauquet donner la pleine mesure de
l’importance symbolique de sa musique :
On peut dire qu’elle féconde le XIXe siècle. Le duo d’Euphrosine (1790) sera un modèle de
musique dramatique que César Franck proposera à ses élèves, Stratonice (1792) décidera de
la vocation musicale de G. Onslow, Le Chant du départ (1794) sera sur toutes les lèvres quand
se jouera le destin de la nation, Le Jeune Henri (1797), présent au répertoire de la Société des
concerts du Conservatoire, verra l’écho de sa chasse répercutée par de nombreuses œuvres,
celles de Berlioz comprises, Ariodant (1799) prêtera son air « Femme sensible, entends-tu le
ramage » à l’un des cantiques les plus chantés jusqu’au XXe siècle Reviens pécheur à ton Dieu
qui t’appelle. Quel musicien n’envierait à Méhul cette gloire qui, pourtant, aujourd’hui le
laisse méconnu ?
(Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, Fayard, 2003, p. 764)
1 Au sujet de cette expression, on peut rappeler le mot d’Arnault : « La musique de cet ouvrage [Horatius Coclès (1794)]
est d’une extrême sévérité ; c’est de la musique de fer, pour me servir de l’expression de son auteur, qui, s’étudiant à
caractériser dans ses compositions les mœurs du peuple qu’il faisait chanter, et l’époque où se passait l’action, avait porté
cette fois un peu loin peut-être l’application d’un excellent système. » (ARNAULT, Souvenirs d’un sexagénaire cité par
Arthur POUGIN, Méhul, sa vie, son génie, son caractère, Paris : Librairie Fischbacher, 1889, p. 88)
8
Méhul, Musica, novembre 1911
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%