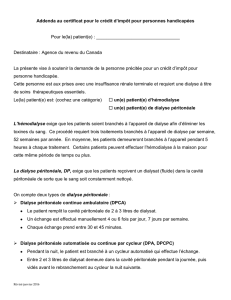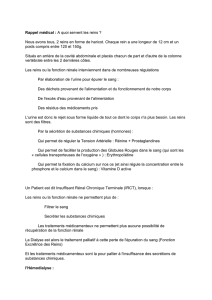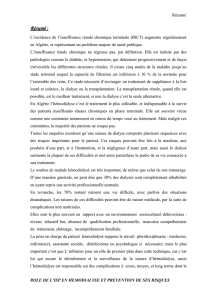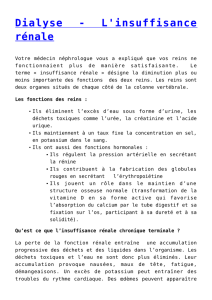L`hémodialyse conventionnelle Rein échos - Rein

Suite :
Voilà ce qui a conduit notre propre réflexion
et la justifie.
L’objectif de l’épuration extra-rénale est d’extraire toutes les toxines urémiques,
dans un temps réduit, tout en respectant la tolérance clinique, mais aussi
biologique (hémo-biocompatibilité).
Tout d’abord la dialyse est expliquée en images et au plus simple
ici : http://www.planetesante.ch/Mag-sante/Medicaments-et-Examens/La-dialyse-expliquee-
en-images
Nous nous contenterons de lire les écrits de chacun, n'étant pas habilité au savoir médical :
L’hémodialyse conventionnelle (90% de dialysés)
L’hémodialyse (rein artificiel) est une technique utilisée depuis plus de 40 ans pour épurer le
sang des patients souffrant d’insuffisance rénale sévère. L’appareil est constitué d’un filtre
dans lequel circule le sang du patient et également un liquide appelé dialysat avec lequel le
sang du patient est en contact. Il se fait des échanges entre les deux liquides (sang et dialysat)
de sorte que le sang élimine certaines substances (urée, créatinine, potassium, etc.) qui n’ont
pas été filtrées par les reins qui sont déficients. Le sang retourne par la suite au patient par un
système de tubulure.
L’hémodialyse a aussi pour rôle d’enlever l’excédent de liquide accumulé par le patient. La
plupart des patients nécessitant des traitements d’hémodialyse urinent très peu de sorte que
tous les liquides qu’ils absorbent s’accumulent. Souvent, un patient va ainsi augmenter son

poids de 1 à 2 kg par jour. Durant le traitement de dialyse, on peut enlever cet excédent de
liquide en créant une pression dans le filtre.
Pour que le sang puisse aller dans le filtre et par la suite retourner au patient, il faut
évidemment un système de tubulure et un accès vasculaire. La plupart du temps, on fera une
opération appelée fistule qui est une communication entre une artère et une veine d’un
membre supérieur. Ceci fera que la pression de l’artère sera transmise dans la veine qui se
dilatera par la suite. On pourra par la suite insérer à chaque traitement une aiguille dans la
veine pour que le sang puisse aller via la tubulure dans le filtre et une autre aiguille pour que
le sang puisse retourner au patient. On retire les aiguilles à la fin de chaque traitement.
Parfois, il n’est pas possible de faire la dialyse par une fistule. Il faut alors installer un cathéter
dans une grosse veine du cou ce qui permet ainsi d’avoir un accès au sang du patient. Ces
cathéters s’infectent souvent de sorte que, dans la mesure du possible, il est préférable d’avoir
un accès au membre supérieur.
La durée du traitement de dialyse est habituellement de 4 heures. L’on doit faire la dialyse 3
fois par semaine, à la fois pour épurer le sang et enlever l’excès de liquide. Le traitement
d’hémodialyse ne guérit pas la maladie rénale de sorte qu’il faut le continuer indéfiniment, à
moins que le patient ne reçoive une transplantation. Durant le traitement, le patient peut boire,
manger, lire, regarder la télé ou dormir. Après son traitement, il ressent une certaine fatigue
pendant quelques heures.
La dialyse péritonéale 10% des dialysés)
La dialyse péritonéale est une autre façon d’épurer le sang d’un patient. Le principe de ce
mode de traitement est d’utiliser la membrane du péritoine comme filtre. On insère un petit
tube dans l’abdomen du patient (cathéter) et on laisse une des extrémités à l’extérieur de
l’abdomen.
Par ce tube, on infuse un liquide (2 litres en général) qui ressemble au dialysat utilisé chez le
patient hémodialysé. Il se fait des échanges entre ce liquide et le sang du patient. Le péritoine
agit comme membrane à travers lequel se fait les échanges. Habituellement, on laisse le
liquide dans l’abdomen pendant 4 heures et, par la suite, utilisant toujours le cathéter, on
draine à l’extérieur le liquide où s’est accumulé les produits (urée, créatinine, potassium, etc.)
comme pour l’hémodialyse. Les patients qui choisissent cette forme de traitement doivent
faire habituellement quatre traitements par jour et ce, 7 jours par semaine. On peut enlever
l’excédent de liquide en modifiant les concentrations de glucose dans le liquide ce qui crée un
appel d’eau par un mécanisme d’osmose. Il faut en général 30 à 45 minutes pour drainer le
liquide et en infuser deux autres litres.
Plusieurs personnes diabétiques qui utilisent cette méthode de dialyse mettent l’insuline dans
le dialysat et ainsi n’ont plus à s’injecter de l’insuline en sous-cutanée. Il existe d’autres
formes de dialyse péritonéale où les traitements se font la nuit pendant 10 à 12 heures mais
ceci nécessite un appareillage plus complexe..
Le choix du traitement
Le choix entre les deux formes de traitement dépend de beaucoup de facteurs médicaux,
personnels et sociaux. La plupart des patients peuvent faire l’une ou l’autre des techniques.
L’hémodialyse nécessite que le patient se soumette à un horaire fixe et demeure à une
distance acceptable d’un centre de dialyse. Même s’il peut recevoir des traitements à
l’extérieur, il peut voyager plus difficilement car ceci est souvent compliqué à organiser. Par
ailleurs, il est plus libre à l’extérieur de ses périodes de dialyse.

La dialyse péritonéale nécessite que le patient fasse lui-même ses traitements. Il est d’une
certaine façon plus autonome devant venir pour des visites médicales 1 fois par mois
seulement. Il doit cependant organiser son horaire de vie et de travail en fonction de ses
traitements. Les patients ayant eu plusieurs chirurgies abdominales sont souvent de mauvais
candidats à la dialyse péritonéale car le péritoine dans ces cas n’est pas adéquat. La dialyse
péritonéale requiert que le patient fasse sa technique d’asepsie de façon rigoureuse car une
contamination peut entraîner des infections intra-abdominales.
En conclusion
Comme on le voit la dialyse que ce soit par hémodialyse ou dialyse péritonéale bouleverse la
vie des patients par la fréquence et le temps nécessaire au traitement.
L’adaptation à ce nouveau mode de vie est difficile initialement mais la plupart des patients
peuvent vivre une vie avec une qualité acceptable et ce pendant de nombreuses
années. http://www.diabete.qc.ca/html/vivre_avec_diabete/dialyse.html
C’est une contrainte l’hémodialyse conventionnelle, mais elle se pratique pendant des
années et n’occupe pas le patient toute la semaine, celui-ci est pris en charge dans un
établissement trois fois par semaine par un personnel formé et c’est certainement ce qui
explique le choix de cette technique par les malades les plus âgés.
Voyons de près cette technique : l'hémodialyse et ce qu'elle requiert....
Des informations sur les différentes méthodes sont ici : http://www.hug-
ge.ch/nephrologie/hemodialyse
La technique est complexe comme on peut le lire dans ce document :
GUIDE PRATIQUE D'HEMODIALYSE Docteur L. RADERMACHER CHU de LIEGE –
site NDB – URGENCES/SAMU
Une étude complète et fort intéressante, base de l’hémodialyse : http://www.nephro-liege-
chr.be/objets/guide_hemodialyse_lr_7OO2-L9W2.pdf
Ne jamais oublié que l’eau est l’essence même de la dialyse :
Une contamination même minime de l’eau pour hémodialyse, donc du dialysat, met en péril
les patients. Pour garantir leur sécurité, la mise en place d’une assurance qualité globale de
la chaîne d’hémodialyse permet d’optimiser l’entretien, la surveillance et le contrôle des
installations de traitement d’eau. Précise E. Marquès de l’Aura
L’eau ultrapure son obtention et ses applications sont dans ce
document : http://www.oieau.org/documentation/IMG/pdf/eau_ultrapure.pdf
La qualité de l’eau utilisée en hémodialyse est primordiale, ainsi que le dialyseur : L’eau du
robinet pourtant déjà traitée et propre à la boisson n’est pas assez pure pour servir
directement à la dilution du concentré permettant la réalisation du dialysat. Toute trace de
métaux par exemple ou d’aluminium présenterait un risque grave pour le malade.

Une station d’épuration d’eau, destinée spécialement au service d’hémodialyse produit
une eau « ultrapure », et ceci afin de réaliser le dialysat pour les générateurs. Pour purifier
cette eau on utilise du chlore et toute une chaîne de filtres.
L’eau pour l’ hémodialyse est un médicament qui présente deux caractéristiques :
Il est utilisé de façon massive
·Il est préparé extemporanément
Elle doit répondre à plusieurs impératifs :
· Maintien de la constante physico-chimique de la solution diluée
· Absence de toxicité pour le patient
· Bonnes qualités bactériologiques et pyrogéniques
A l’entrée de la chaîne, on a de l’eau brute c’est-à-dire de l’eau de ville. Sa dureté est de
15 environ, sa température de 18°C et elle contient des germes (microbes, bactéries), du Ca
2+, des électrolytes, des colloïdes, des chloramines et des métaux lourds.
La chaîne sert à filtrer, adoucir et osmoser cette eau et à la rendre pure c’est-à-dire sans le
moindre germe.
Elle est constituée d’une série de filtres dont le diamètre des pores diminue de plus en
plus, d’une pompe doseuse de chlore pour désinfecter l’eau du réseau, de deux
adoucisseurs permettant d’éliminer le calcium et le magnésium de l’eau et de deux osmoseurs
en série.
Elle peut également être complétée par une étape de polissage avec des résines échangeuses
d’ions et une étape
d’ultrafiltration. http://www.oieau.org/documentation/IMG/pdf/eau_ultrapure.pdf
Sur quels documents s’appuient-on, entre autres ?
Norme Afnor du dialysat
Présentation – Dr Alain RAGON
Laboratoire Pôle Uro-Néphrologie
Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
L’objectif du traitement de l’insuffisance rénale chronique par les techniques
extracorporelles de dialyse est de favoriser l’élimination des toxines urémiques. L’efficacité
de cette élimination par des phénomènes de transport par diffusion qui concernent des petites
molécules (type urée et électrolytes) et par convection (filtration de l’eau et épuration de
molécules de poids moléculaires plus élevés) est améliorée grâce à l’emploi de membranes
hautement perméables, de grandes surfaces d’échanges et des configurations géométriques
particulières de l’hémodialyseur (réduction du diamètre des fibres par exemple).
La membrane de l’hémodialyseur est ainsi le lieu où s’éliminent les toxines urémiques depuis
le sang vers le dialysat mais des échanges existent également en sens inverse. La membrane
constitue l’unique barrière de protection vis à vis des contaminants potentiels (chimiques,
micro biologiques) qui peuvent être transférés du dialysat vers le sang du patient par rétro
diffusion et rétro filtration. Ce risque de contamination est d’autant plus élevé que la
membrane est plus perméable et de grande
surface…….. http://www.dialyse.asso.fr/journaux/septembre08/article_6.htm
L’on verra ici que la technique se complexifie un peu. Voilà ce que dit le Pr Thierry
Petitclerc :

Le patient privé de toute fonction rénale peut survivre grâce au « rein artificiel » parce que
celui-ci est capable de compenser à la fois la fonction d’épuration des déchets et celle de
régulation hydroélectrolytique du milieu intérieur, toutes deux vitales pour l’organisme.
Cependant, si le rein artificiel assure la première aussi bien et même parfois de manière plus
performante que les reins naturels, la seconde n’est réalisée que de manière très grossière.
En effet, il n’existe encore aucune boucle de régulation permettant d’ajuster très exactement
les sorties aux apports particuliers à chacun, liés avant tout aux habitudes alimentaires. C’est
pourquoi l’expression système d’épuration extrarénale semble plus adéquate que rein
artificiel. Comme les reins naturels, les systèmes d’épuration extrarénale réalisent
l’épuration du plasma à travers une membrane dialysante. On désigne par ce terme une
membrane qui se comporte comme un tamis, c’est-à-dire qui reste imperméable aux
molécules de taille (ou de masse molaire) élevée et donc, nécessairement, à tout élément plus
gros (virus, bactéries, éléments figurés du sang…). La masse molaire au-dessus de laquelle la
membrane est strictement imperméable est appelée point de coupure (cut-off) de la
membrane. Les membranes dialysantes utilisées dans les systèmes d’épuration extrarénale
doivent être imperméables à l’albumine (M environ 70 000). Leur point de coupure, en
pratique compris entre 5 000 et 20 000 daltons, est largement inférieur à celui du filtre
glomérulaire (environ 58 000). Dans le cas du rein artificiel, l’épuration n’est pas
nécessairement assurée, comme dans le glomérule rénal, par un phénomène de filtration en
rapport avec un gradient de pression. Elle est souvent obtenue par un phénomène de diffusion
(qui, à travers une membrane dialysante, prend le nom de dialyse) en rapport avec
l’établissement d’une différence de concentration entre deux solutions circulant de chaque
côté de la membrane : le plasma contenu dans le sang, d’une part, et une solution
électrolytique appelée dialysat, d’autre part. La membrane dialysante, élément clé de tout
système d’épuration, peut être intracorporelle (dialyse péritonéale) ou extracorporelle,
nécessitant alors une circulation sanguine extracorporelle (hémodialyse au sens large) avec
un débit habituellement compris chez l’adulte entre 200 et 400 ml/min. Nous nous limiterons,
dans cet article, au traitement de l’insuffisance rénale chronique par hémodialyse et, plus
particulièrement, à ses aspects d’intérêt actuel parce qu’ils sont encore l’objet de
développements ou de controverses. Le lecteur intéressé trouvera une revue plus générale sur
le sujet dans des articles de synthèse ou des ouvrages spécialisés…
Définir le programme adéquat de traitement par hémodialyse pour un patient donné
nécessite, entre autres critères, de préciser la modalité technique et la membrane optimales
pour ce patient. Mais il convient de signaler d'emblée que les critères médicaux, qui devraient
en théorie être seuls pris en compte dans l'intérêt du patient, sont en réalité souvent masqués
par des impératifs économiques. En effet, le remboursement, en France, d'une séance de
dialyse par les organismes de protection sociale, d'un montant pourtant excessivement
variable d'une région à l'autre et même d'un centre à l'autre, est totalement forfaitaire et ne
prend en compte ni le coût de la technique (conventionnelle ou convective), ni celui de la
membrane (biocompatible ou non), ni l'efficacité de la séance (dose de dialyse délivrée), un
peu comme si le remboursement d'un traitement antibiotique ne prenait en compte ni la
nature ni l'efficacité ni la dose prescrite du médicament utilisé !
Choix de la modalité technique
L'hémofiltration n'est pas plus efficace que l'hémodialyse conventionnelle en ce qui concerne
l'épuration de l'urée et des petites molécules. Cependant, parce que le transfert convectif
dépend peu de la taille des molécules [34] et que l'hémofiltration nécessite l'utilisation d'une
membrane dialysante à forte pente dont le point de coupure est généralement élevé (de l'ordre
de 20 000 daltons), elle reste, contrairement à l'hémodialyse conventionnelle, très efficace
pour l'épuration des moyennes molécules (toxines urémiques de masse molaire comprise
 6
6
 7
7
1
/
7
100%