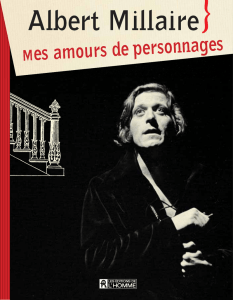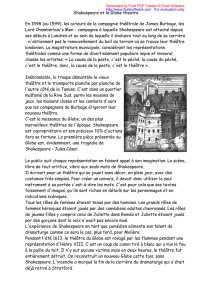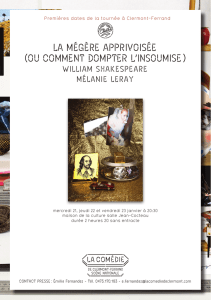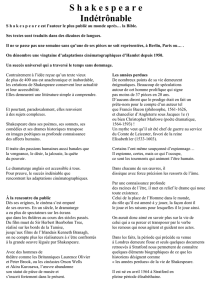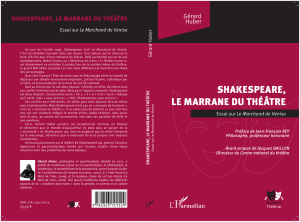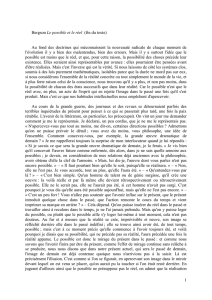La Mégère apprivoisée

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ÉTABLI PAR LE TNB SAISON 2014 I2015

2
WILLIAM SHAKESPEARE
MÉLANIE LERAY
La Mégère apprivoiséeCRÉATION
DE William Shakespeare
TRADUCTION Delphine Lemonnier-Texier
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE Mélanie Leray
DRAMATURGIE Delphine Lemonnier-Texier
SCÉNOGRAPHIE David Bersanetti
LUMIÈRES Christian Dubet
VIDÉO Cyrille Leclercq,David Bersanetti
COSTUMES Laure Mahéo
SON Jérôme Leray
ASSISTANTS À LA MISE EN SCÈNE Magalie Caillet-Gajan,Vincent Voisin
AVEC
Peter Bonke BAPTISTA
Ludmilla Dabo LA VEUVE
Laetitia Dosch CATHERINE
David Jeanne-Comello HORTENSIO
Clara Ponsot BIANCA
Yuval Rozman LUCIEN
Jean-Benoît Ugeux GRUMIO
Vincent Winterhalter PETRUCCIO
Jean-François Wolff GREMIO
PRODUCTION DÉLÉGUÉE
Théâtre National de Bretagne/Rennes
COPRODUCTION
Association 2052 – Théâtre de la Ville-Paris –
MC2 : Grenoble – Théâtre de Saint Quentin en Yvelines/
scène nationale – Maison de la Culture de Bourges –
Maison de la Culture d’Amiens.
La compagnie Association 2052 est soutenue par la région Bretagne,
la DRAC Bretagne, la ville de Rennes et le conseil général d’Ille-et-Vilaine.
La traduction de Delphine Lemonnier-Texier
est publiée aux Éditions de l’Arche.
DURÉE 2h15

3
SOMMAIRE
Le Grand Jeu IColette Godard p. 4
Note d’adaptation ID. Lemonnier-Texier p. 5
Notes de mise en scène IM. Leray p. 7
PISTES PÉDAGOGIQUES
À la découverte de la pièce p.10
Analyse de la mise en scène p.12
CORPUS POUR UNE ÉTUDE EN CLASSE
I. Une femme à dompter, quelques conseils p. 15
II. Femme adorée, femme abhorrée p. 18
III. La Révolte des femmes p. 22
ANNEXES
William Shakespeare p. 25
La Place de la femme dans la société p. 26
Définition de la mise en abyme p. 28
Le Monologue de Catherine dans l’acte V p. 29
Le Théâtre élisabéthain p. 30
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Mélanie Leray… p. 32
Rencontre ITournée I Facebook
Bibliographie ISéance audio description p. 35
Presse p. 36
© B. Enguerrand

4
La Mégère apprivoisée est une des comédies de Shake -
speare qui est rarement jouée en France. Il est vrai
qu’au départ, chacun prenant la place d’un autre et
réciproquement, il s’agit principalement de varia-
tions multiples sur les « jeux de rôle », peu compati-
bles avec notre esprit cartésien.
Mais pour Mélanie Leray, le problème n’est pas là.
Comme dans Contractions de Mike Bartlett (créé au
TNB en 2012, puis programmé au Théâtre des Abbesses
en 2013), s’il est question de rôle, c’est celui de la
femme, aujourd’hui, dans notre société occidentale.
C’est donc aujourd’hui que Catherine, l’insoumise
qui rebute les hommes, rencontre Petruccio, le cou-
reur de dot. Trouvant enfin un partenaire à sa taille,
elle accepte de l’épouser. Il est vrai que son père
refuse de laisser sa sœur cadette Bianca – pour qui
se bousculent les prétendants prêts à tous les dégui-
sements afin de l’approcher – se marier avant elle, et
ira jusqu’à la faire prisonnière.
Shakespeare place son intrigue en Italie chez de
riches et puissants aristocrates. Mélanie Leray rafraî-
chit l’esprit en transformant la taverne du prologue
en salle de projection, puis en passant l’intrigue
dans les halls de palace et les salles de jeu, où atten-
dent machines à sous et tables de poker. Dans notre
monde, chez des gens sans noblesse aucune, sans
scrupule aucun. Pour eux, l’argent se gagne, se prend
ou se perd, s’échange comme tout le reste, y compris
les personnes.
Au titre français qui d’emblée donne Catherine per-
dante puisque d’emblée apprivoisée, Mélanie Leray
préfère le titre anglais The Taming of the Shrew. Soit,
Comment dompter l’insoumise ? Manière de laisser la
place au combat. Mais en quoi Catherine apparaît-
elle comme une insupportable rebelle, une mégère
tout juste bonne à faire fuir les hommes? Simplement,
elle a ses idées, ses points de vue sur le monde qui
l’entoure, sur ce qu’il est et pourrait être. En somme,
une femme avec une conception politique de la vie.
Cela dit, il ne s’agit en aucune manière d’un mani-
feste féministe.
Mélanie Leray va plus loin. Dans le rapport de force
qui oppose Petruccio et Catherine se niche une atti-
rance complice que l’on pourrait qualifier d’amour. Et
surtout, ce combat offre à la femme la possibilité
d’étudier le comportement masculin, ses tactiques et
ses effets sur elle. En amenant Petruccio à se dévoi-
ler, elle mène le jeu. Non pour prendre sa revanche,
ni d’ailleurs sa place, ni pour dominer. Juste pour
comprendre, être à égalité, avec tout le risque que
cela comporte.
D’ailleurs, dès le prologue, il ne s’agit plus d’un groupe
d’ivrognes et de comédiens embarqués dans le tour-
billon du jeu avec le vrai et le faux, mais, dans un
pays en guerre, du discours de la première des reines
d’Angleterre. La toute première dans notre monde
occidental à assumer la fonction d’un homme de
pouvoir.
«Je suis venue parmi vous ici ce jour non pas pour ma
distraction et mon plaisir, mais parce que je suis réso-
lue à vivre et à mourir à vos côtés, au milieu et au plus
fort de la bataille, et pour offrir à mon Dieu et à mon
peuple mon honneur et mon sang même si je dois mor-
dre la poussière. Je sais que mon corps est faible, c’est
celui d’une faible femme, mais j’ai le cœur et l’estomac
d’un roi, et d’un roi d’Angleterre.»
Colette Godard
LE GRAND JEU
Qui donc est cette « mégère »? Une femme qui sait ce qu’elle veut,
et pourquoi. Capable d’entrer dans le jeu des hommes,
et d’y trouver sa place.
© Ch. Berthelot

5
NOTES SUR L’ADAPTATION
La société de l’époque de Shakespeare est fondamen -
talement patriarcale. À tous les niveaux, la femme est
assujettie à l’homme. Pourtant, dans les premières
pièces historiques qu’il écrit au début des années
1590, Shakespeare joue avec les stéréotypes en déve-
loppant des rôles féminins forts, autour desquels
l’action gravite. La Mégère apprivoisée prend pour
sujet la figure de la femme insoumise, en rébellion
contre l’autorité: elle refuse de se cantonner au rôle
social que lui dicte la norme en vigueur, celui de
l’épouse dont le devoir est, par excellence, de s’enfer-
mer dans le silence. Ces femmes qui refusent de se
taire sont qualifiées de mégères et des punitions
publiques leur sont infligées (port d’une bride de
mégère, exposition publique sur des charrettes, sévices
divers…). Face à cette violence faite à la femme et à
son corps, Shakespeare prend le parti de la comédie.
LA LANGUE DE LA MÉGÈRE DE SHAKESPEARE:
UN SENS INNÉ DE LA RÉPARTIE
Le personnage de Catherine détonne. Le cadre im po -
sé par les conventions sociales (une fille doit se marier
et épouser celui que son père choisit) ne lui convient
pas, et elle le rejette, soulignant le côté convenu en dé -
nonçant son artificialité et le jeu social (et théâtral)
dont il relève. C’est une femme qui manie parfaite-
ment la rhétorique et l’humour, qui a un sens inné
de la répartie, qui sait jouer avec le langage et avec
les mots. Elle fait donc peur à tous les hommes, et se
retrouve isolée et rejetée. Ce n’est qu’avec Petruccio,
initialement intéressé par la richesse de sa famille,
qu’elle trouve, enfin, un partenaire de jeu, de dialogue,
à la hauteur de son talent. La première rencontre des
deux personnages est un festival de réparties, toutes
plus vives et drôles les unes que les autres. La logique
est donc l’inverse exact des punitions infligées aux
mégères à l’époque de Shakespeare: la langue de la
femme insoumise est la source vive d’un moment de
théâtre jubilatoire pour le spectateur autant que pour
les deux protagonistes.
LE RÉGIME IMPOSÉ À CATHERINE
Catherine, contraire de la femme idéalisée, presque
éthérée – elle a les pieds sur terre, et elle a un solide
appétit – est mise au régime par Petruccio, qui la sèvre
de viande (comme on sèvre un rapace pour le dresser
à chasser pour l’homme). Il empêche, dans un premier
temps, sa nouvelle épouse de se livrer à son activité
favorite, récriminer, ronchonner, râler, crier et tem-
pêter. En prenant littéralement le rôle de la mégère,
il en prive Catherine. Alors qu’elle assénait à tous ce
type de discours, c’est maintenant elle qui doit les écou -
ter et les subir. Jusqu’au moment où elle comprend
qu’il joue…
L’apparente tyrannie du tyran se déjoue aisément
dès lors que l’on a compris qu’il faut entrer dans son
jeu. Catherine a intégré la leçon, l’élève se hisse à la
hauteur du maître, et jubile autant de lui que des
bons tours que cela leur permet de jouer aux autres.
L’ÉCOLE DE PETRUCCIO
De retour à Padoue, Petruccio lance une compétition
pour voir lequel des autres hommes récemment ma -
riés aura l’épouse la plus obéissante, récompense en
or à la clé. Catherine, complice, montre le visage de
l’obéissance la plus parfaite et s’offre le luxe de faire
la leçon aux deux autres épouses, dont sa sœur que
toujours on a placée au-dessus d’elle. Le discours
qu’elle prononce et qui met en parallèle l’obéissance
au monarque et celle de l’épouse est aussi celui qui
lui donne le premier rôle. Sa plaidoirie pour l’obéis-
sance conjugale est prononcée avec toute l’emphase
d’un discours trop énorme pour ne pas être ironique.
Elle monopolise la parole et un certain type de dis-
cours pour mieux piéger son auditoire. Elle joue le
rôle de la femme soumise pour extorquer à son pro-
pre père une coquette somme d’or tout en faisant
passer sa sœur pour une idiote avec tout le talent et
la jubilation à jouer un rôle qu’elle a appris de
Petruccio; loin de réduire Catherine au silence, la fin
de la pièce la met de plus en plus au centre. Consciente
que tout discours est affaire de circonstances et d’au-
ditoire, et que les mots prononcés n’ont de valeur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%