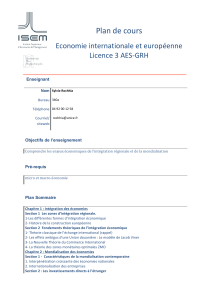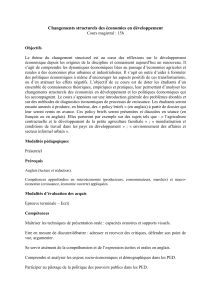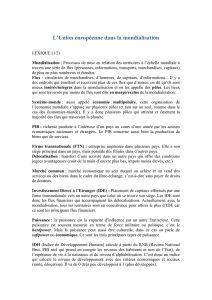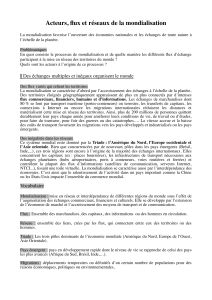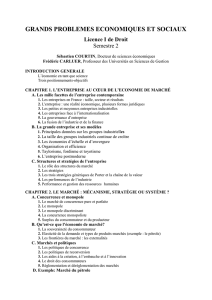Les pays en développement face à la mondialisation

J
usqu’à une date récente, les deux phénomènes
parallèles de mondialisation et d’émergence
économique apparaissaient comme les deux
faces d’une même pièce, et l’intégration dans l’éco-
nomie mondiale était vantée comme l’une des clefs
du développement. La succession de crises dont
certaines économies émergentes ont été victimes
au cours des dernières années a amené à s’inter-
roger sur les bienfaits de la mondialisation, en par-
ticulier dans sa dimension financière. Par ailleurs,
l’aggravation apparente des inégalités entre pays
riches et pays pauvres est de plus en plus fré-
quemment imputée au mouvement de mondiali-
sation qui profiterait à un groupe limité d’écono-
mies dans le monde. L’hostilité ouverte au processus
de mondialisation, qui s’est manifestée à l’occa-
sion de la conférence de Seattle en novembre 1999,
témoigne de ce type de convictions.
Plusieurs considérations théoriques suggèrent
que les économies en développement ont intérêt à
participer plus activement à la mondialisation.
Cependant, cette dernière impose des ajustements
complexes et coûteux qui suscitent des craintes
fondées. Alors que les résistances à la mondiali-
sation se multiplient et que le risque d’un retour
en arrière est de plus en plus fréquemment évo-
qué, le moment semble venu de faire le point sur
ces diverses questions.
Après un bref examen de la réalité de la mon-
dialisation pour les PED, ce chapitre s’efforcera
de préciser ce que les économies en développe-
ment peuvent espérer de ce processus, mais aussi
ce qu’elles peuvent en craindre et quelles mesures
il conviendrait de mettre en place pour leur per-
mettre de tirer le meilleur profit de ce nouvel envi-
ronnement économique et de ces nouvelles
contraintes.
PED et mondialisation :
état des lieux
LES PED AU CŒUR DE LA
MONDIALISATION
Comme le remarquait le FMI (1997), « la par-
ticipation accrue des pays en développement repré-
sente l’un des traits saillants de l’expansion du
commerce et des flux de capitaux observée dans
le monde au cours des dix dernières années ». De
l’avis unanime, la montée en puissance de la mon-
dialisation constitue l’un des faits marquants de la
fin du XX
e
siècle
1
. Le rythme de l’intégration éco-
1. 61
Les pays en
développement face
à la mondialisation
Françoise Nicolas
1. La mondialisation se traduit par un maillage extrêmement serré des
activités économiques au plan international et par des structures d’inter-
dépendance accrue. Ce mouvement s’est appuyé sur la libéralisation des
politiques économiques, sur une accélération des progrès techniques en
matière de transports et de communications et sur l’internationalisation
croissante des activités des entreprises. Il a en outre de fortes chances de
se confirmer au cours des prochaines années, sous l’effet combiné de la
poursuite de la libéralisation des échanges commerciaux sous l’égide de
l’OMC et des flux de capitaux, mais aussi de la chute des coûts de trans-
ports, et du maintien de la dynamique de libéralisation et de privatisa-
tion.

RAMSES 2001
nomique mondiale s’est en effet considérablement
accéléré au cours des dernières décennies, avec
une intensification et un approfondissement des
échanges, à travers l’ensemble de la planète, quelle
que soit la nature de ces échanges, c’est-à-dire
qu’ils concernent des marchandises ou encore des
services et des capitaux. Ce mouvement n’est pas
complètement inédit et un phénomène comparable
a déjà pu être observé à la fin du XIX
e
siècle (plus
précisément de 1870 à 1914)
2
; toutefois, la mon-
dialisation affecte aujourd’hui de manière profonde
un nombre beaucoup plus grand de pays en dehors
de l’Europe, de l’Amérique du Nord et du Japon
(Goto et Barker 1999). C’est donc l’ampleur géo-
graphique du mouvement actuel qui lui confère
toute son originalité.
Le degré d’ouverture des pays en développement,
défini comme le rapport entre le commerce exté-
rieur et le PIB, est passé de 22,8 à 38 % entre 1985
et 1997, ce qui leur a permis d’augmenter leur part
du commerce mondial de 23 à 30 % au cours de la
même période (OMC 1998). En outre, ces pays ont
considérablement diversifié leurs relations com-
merciales, du point de vue tant géographique que
sectoriel. La part des produits manufacturés dans
leurs exportations est passée de 47 % en 1985 à
70 % en 1998. Ils détiennent aujourd’hui environ
25 % des exportations mondiales de produits manu-
facturés (contre moins de 7 % au début des
années 70), ce qui reflète la force du mouvement
d’industrialisation de cette partie du monde.
Autre trait important, le mouvement de mon-
dialisation s’est accompagné d’un changement spec-
taculaire dans le volume et la nature des flux de
capitaux à destination des pays en développement.
En termes de volume, la reprise des flux de fonds
à destination de ces pays est clairement sensible à
compter du milieu des années 80, une fois apaisées
les craintes engendrées par la crise de la dette latino-
américaine. Les flux de capitaux à destination des
PED sont passés d’à peine 35 milliards de dollars
en 1980 à 60 milliards en 1990 et près de 200 mil-
liards en 1996 (FMI 1998). Rapportées au PIB, les
entrées de capitaux ont approximativement doublé
entre 1986 et 1996. Les flux de capitaux privés
l’emportent désormais très nettement sur les flux
publics, avec en outre une montée en puissance des
titres de participation et des investissements de por-
tefeuille au détriment des prêts bancaires, qui étaient
la norme dans les années 70. Les investissements
directs étrangers, vecteurs par excellence de la mon-
dialisation
3
à côté des flux commerciaux, ont connu
des taux de croissance particulièrement spectacu-
laires ; les PED ont accueilli jusqu’à 37 % des flux
mondiaux d’IDE en 1997
4
. Cette modification dans
la nature des flux à destination des PED reflète le
regain de confiance dont ces pays bénéficient. Après
2. Voir FMI (1997) ou encore Crafts (2000) en particulier sur ce point.
3. C’est en effet à travers les IDE que s’organise la nouvelle division
internationale du travail qui permet de resserrer les structures d’interdé-
pendance.
4. L’inflexion observée en 1998 (26 % des flux mondiaux d’IDE) résulte
d’une part des bonnes performances enregistrées par les économies
industrialisées, mais aussi, et peut-être surtout, du contrecoup de la crise
asiatique.
62
Graphique 1
Croissance des échanges (en % du PIB)
% 50
40
30
1981 83 85 87 89 91 93 95 97
PED
Pays industrialisés
Source
: World Bank (1999),
World Development Indicators
, Washington,
D.C.
Graphique 2
Flux nets de capitaux privés à destination des PED
1998
1990
200
150
100
50
0Flux publics Flux privés
créateurs de
dette
Flux de
portefeuille
IDE
milliards de dollars
Note
: Les flux privés créateurs de dette incluent les prêts bancaires et
les obligations.
La Corée du Sud est incluse dans les chiffres des pays en développement.
Source
: World Bank (1999),
Global Development Finance
, Washington, D.C.

Les pays en développement face à la mondialisation
avoir littéralement explosé au cours de la première
moitié des années 90, les entrées de capitaux au
titre de prise de participation ont quelque peu reflué
pour être compensées par une reprise des prêts ban-
caires
5
.
DES SITUATIONS CONTRASTÉES
Cette évolution globale largement positive
témoigne d’une insertion active des PED dans le
mouvement de mondialisation. Toutefois, elle dis-
simule des disparités importantes. Jusqu’à présent,
les fruits de la mondialisation ont été répartis de
manière extrêmement inégale, ce qui a conduit à
une hétérogénéisation croissante du monde en déve-
loppement
6
. Alors que certaines économies (en
particulier en Asie de l’Est) ont su tirer profit de
la mondialisation en adoptant des stratégies de
développement fondées sur l’ouverture écono-
mique et les exportations
7
, d’autres semblent être
restées en marge.
Ces disparités sont perceptibles dans les diffé-
rentes dimensions de la mondialisation (financière
et réelle). À titre d’exemple, la part de l’Afrique
dans le total des flux nets de capitaux à destina-
tion des PED n’a cessé de diminuer depuis les
années 80, passant de 27 % en 1980 à 17 % en
1990 pour atteindre à peine 8 % en 1996 (FMI
1998). Parallèlement, l’extrême concentration des
flux d’IDE à destination d’un petit nombre de pays
n’a fait que s’accentuer au cours des dernières
années puisque les 5 principaux pays destinataires
(Chine, Brésil, Mexique, Singapour et Indonésie)
ont recueilli 55 % du total des IDE en 1998, contre
41 % en 1990. La participation de l’Afrique au
mouvement d’expansion des IDE est particulière-
ment limitée. Selon la CNUCED, la part de cette
région dans l’ensemble des IDE à destination des
PED serait passée de 11 % pour la période 1986-
1990 à 5 % pour la période 1991-1996, puis à 3,8 %
en 1996. La Malaisie à elle seule reçoit plus d’IDE
que l’ensemble du continent africain. Par ailleurs,
au sein du continent africain, la répartition est très
inégale entre les pays : ainsi le Nigeria totalise
44 % du total des IDE entrants de la région. De
manière plus générale, les pays les moins avancés
ne participent pas au mouvement général d’ac-
croissement des flux d’IDE et leur part dans les
flux mondiaux demeure inférieure à 1 %.
En fait, les modalités d’intégration des PED aux
circuits financiers internationaux diffèrent nette-
ment d’une région à l’autre et reflètent, dans cer-
tains cas, la persistance d’une véritable situation
de dépendance. Ainsi, dans le cas des économies
africaines, les flux officiels continuent de domi-
ner largement, même si la part des flux privés a eu
tendance à s’accroître quelque peu au cours des
5 dernières années.
5. Cette inversion de tendance s’est produite à partir de la crise mexi-
caine, qui a entraîné une chute des flux de portefeuille.
6. Voir le chapitre « La fin de l’aide au développement ? » dans
RAMSES 98
.
7. Les stratégies de forte croissance fondées sur la croissance des expor-
tations ne sont cependant pas l’apanage des économies d’Asie de l’Est,
elles ont également été le fait du Chili depuis le milieu des années 80 et
de la Chine depuis le milieu des années 70.
63
1948 1953 1963 1973 1983 1993 1998
Exportations
Amérique latine 12,3 10,5 7,0 4,7 5,8 4,4 5,2
Afrique 7,4 6,5 5,7 4,8 4,4 2,5 2,0
Moyen-Orient 2,1 2,1 3,3 4,5 6,8 3,4 2,6
Asie de l’Est 3,0 2,6 2,4 3,4 5,8 9,7 9,6
Importations
Amérique latine 10,6 9,3 6,8 5,1 4,4 5,0 6,2
Afrique 7,6 7,0 5,5 4,0 4,6 2,6 2,4
Moyen-Orient 1,7 2,0 2,3 2,8 6,3 3,2 2,6
Asie de l’Est 3,0 3,4 3,1 3,7 6,1 10,0 8,0
Tableau 1
Commerce mondial des marchandises par région, 1948-1998 (en pourcentage du total)
Source
: OMC (1999).

RAMSES 2001
La situation n’est guère plus favorable en matière
de commerce international, une douzaine de PED
regroupant à eux seuls 70 % des exportations en
provenance du monde en développement
8
. La part
de l’Afrique dans les échanges mondiaux de biens
et services n’a cessé de s’amenuiser, passant de
5 % en 1950 à 2 % en 1998 (OMC 1999)
9
. Le ratio
exportations sur PIB est également en baisse ; de
plus, les exportations sont toujours concentrées
sur les produits de base, et les termes de l’échange
ne cessent de se détériorer. Le principal problème
auquel les économies africaines ont à faire face
tient à la structure de leur production manufactu-
rière et de leur spécialisation.
INÉGALITÉS ET MARGINALISATION
Les observations qui précèdent méritent d’être
interprétées avec prudence. Ainsi elles ne doivent
pas nécessairement conduire à la conclusion que
la mondialisation est source de marginalisation,
dans la mesure où l’accroissement des échanges
ne concernerait par exemple qu’un petit nombre
de pays, en majorité industrialisés. Même si la part
de certains PED dans les échanges mondiaux a
baissé, cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont
restés de côté mais simplement que les autres ont
davantage bénéficié de la mondialisation qu’eux
10
.
La baisse de la part de certaines économies dans
les échanges mondiaux ne signifie pas nécessai-
rement qu’il y ait eu réduction du montant absolu
de leurs échanges ; en fait le niveau absolu des
échanges a fréquemment augmenté, mais moins
fortement que dans d’autres régions. La mondia-
lisation ne semble donc pas avoir entraîné une mar-
ginalisation systématique des PED.
Même s’il n’est pas possible d’affirmer que la
marginalisation est inhérente à la mondialisation,
force est de constater que ce mouvement s’est
accompagné de la persistance de graves inégali-
tés entre pays riches et pays pauvres. L’Asie de
l’Est est la seule région à avoir enregistré une
convergence de son niveau de vie vers celui observé
dans les économies industrialisées : le niveau de
revenu par tête a augmenté dans cette région de
6 % par an en moyenne au cours de la dernière
décennie
11
, alors qu’il a chuté dans le cas des éco-
nomies africaines sur la même période (– 0,3 %
par an pour la période 1989-1998). Le revenu moyen
par tête de cette région en termes réels était en
1998 sensiblement inchangé par rapport au niveau
de 1970
12
. Au sein du groupe des économies en
développement, seuls les pays arabes enregistrent
des performances aussi médiocres.
8. Ce même groupe de pays (Argentine, Brésil, Chili, Mexique, Chine,
Hong-Kong, Malaisie, Corée, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Indonésie)
absorbe 80 % des flux d’investissement et plus de 90 % des flux de por-
tefeuille à destination des PED (Nayyar 2000).
9. La part de l’Afrique dans le commerce des marchandises est passée de
près de 7 % dans les années 50 à 2,4 % en 1998, alors que parallèlement
celle des 6 pays commerçants d’Asie de l’Est a augmenté de 3 à près de
10 % (OMC 1999).
10. Dans un article récent, Low
et al
(1998) cherchent à établir si la mon-
dialisation a débouché sur une plus forte concentration des flux de com-
merce et de capitaux. Ils constatent d’une part que la concentration du
commerce mondial a peu évolué au cours de la période 1976-1995, et
d’autre part que, si l’on tient compte de l’accroissement du commerce
mondial, cette concentration a diminué.
11. Sous l’effet de la crise financière de 1997-1998, le revenu par tête a
toutefois connu une croissance négative (– 1,1 %) en 1998.
12. En ce qui concerne les pays d’Afrique subsaharienne, les perfor-
mances en termes de croissance du PIB, qui semblent s’être améliorées,
sont trompeuses dans la mesure où elles ne sont pas accompagnées
d’une meilleure maîtrise de la croissance démographique.
64
Graphique 3
Répartition des exportations des pays d’Afrique
subsaharienne non producteurs de pétrole, 1990-1997
Agriculture Métaux et minéraux Produits manufacturés
80
60
40
20
0
1990 1994 1995 1996 1997
Source
:Banque mondiale,repris de
Global Economic Prospects 2000
,1999.
%
Graphique 4
Taux de croissance des exportations
de marchandises, 1987-1997
%14
12
10
8
6
4
2
0
Moyenne monde = 6,6%
Économies
industrialisées
Afrique sub-
saharienne
Asie de l'Est
et Pacifique
Asie du Sud
Amérique latine
et Caraïbes
Europe et
Asie centrale
MENA
Source
:Banque mondiale,repris de
Global Economic Prospects 2000
,1999.

Les pays en développement face à la mondialisation
La prudence est une fois encore de mise dans
l’interprétation de ces données. Il n’existe pas
nécessairement un lien de causalité entre mondia-
lisation et inégalités des revenus. Tout d’abord,
contrairement à ce qui est fréquemment avancé,
les inégalités de revenu au niveau mondial ont eu
tendance à s’amenuiser au cours des 20 dernières
années, sous l’effet combiné de la hausse des
niveaux de vie de la Chine et de l’Inde (Boltho et
Toniolo 1999)
13
. Par ailleurs, l’évolution régionale
des revenus semble avoir suivi un cours parallèle
à celui de l’intégration définie par exemple en fonc-
tion des parts du commerce mondial (FMI 1997),
ce qui suggère que l’intégration à l’économie mon-
diale, loin d’être un facteur d’appauvrissement, est
un puissant facteur de croissance.
Au cours de la dernière décennie, les efforts
réformateurs se sont intensifiés dans certains des
PED les moins avancés. Nombre de pays africains
ont par exemple profondément modifié leurs légis-
lations relatives aux IDE en augmentant le nombre
des secteurs ouverts aux étrangers, en assouplis-
sant les conditions d’accès, en simplifiant les pro-
cédures ou encore en supprimant les restrictions
sur le rapatriement des profits (FMI 1999). Suite
à la mise en place de vastes programmes d’ajus-
tement, une légère amélioration des performances
macroéconomiques des économies les moins avan-
cées a été enregistrée durant la deuxième moitié
des années 90. Parallèlement, il semble que ces
économies commencent aussi à s’intégrer à l’éco-
nomie mondiale, même si les résultats sont encore
précaires – l’augmentation de plus de 50 % entre
la première et la deuxième moitié de la décennie
90 de la part dans le PIB des flux de capitaux à
destination de ces économies en est une illustra-
tion. L’augmentation des flux d’IDE rapportés au
PIB ne doit cependant pas tromper : elle peut sim-
plement refléter un niveau extrêmement bas du
PIB mais aussi s’expliquer par le fait qu’une bonne
partie de ces flux sont destinés aux secteurs des
ressources naturelles qui n’ont pas grand rapport
avec la taille ou le dynamisme du marché local.
L’ÉMERGENCE D’UN DIKTAT
IDÉOLOGIQUE
En matière de politique de développement, depuis
la mise en place des institutions de Bretton Woods,
un consensus s’est progressivement forgé autour
13. Cette estimation s’appuie sur le calcul d’un indice de Gini, qui
montre, au niveau agrégé, une diminution de l’inégalité de la distribution
des revenus.
65
Région 1966-1973 1974-1990 1991-1998
Croissance du PIB
Monde 5,2 3,0 2,5
Économies à revenu élevé 5,0 2,8 2,3
Économies à revenus faible et intermédiaire 6,2 3,8 3,2
Asie 5,8 6,5 7,6
Amérique latine 6,2 2,6 3,6
MENA17,8 1,4 2,9
Afrique subsaharienne 4,5 2,1 2,8
Croissance du PIB par tête
Monde 3,1 1,2 1,0
Économies à revenu élevé 4,1 2,1 1,6
Économies à revenus faible et intermédiaire 3,7 1,8 1,6
Asie 3,1 4,5 6,0
Amérique latine 3,5 0,4 1,8
MENA 4,9 – 1,7 0,6
Afrique subsaharienne 1,8 – 0,8 0,1
Tableau 2
Taux de croissance réels du PIB
1. Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Source
: Banque mondiale, repris de
Global Economic Prospects 2000
, 1999.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%