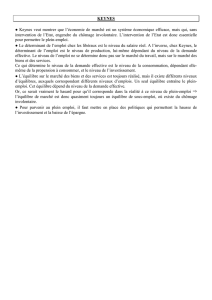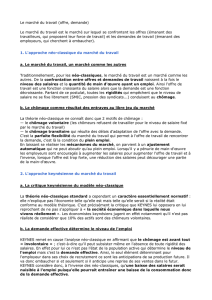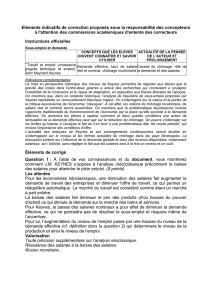Les causes du chômage Analyse keynésienne

Les causes du chômage (II)
Le 18 janvier 2016, le Président François Hollande présentait lui-même un « plan d’urgence
pour l’emploi », le chômage ne cessant de remonter depuis la crise de 2008 (3 590 000
personnes de catégorie A en décembre 2015, soit un taux de chômage de 10.1 % près du
maximum de 10.4 % atteint en 1995 ; et 5 475 700 personnes de catégories A,B,C). Les
mesures annoncées suffiront-elles à inverser durablement la courbe du chômage ? Pour lutter
contre le chômage de masse que connaît la France depuis 40 ans, il faut bien sûr faire un
diagnostic des causes. Or cela est difficile dans la mesure où il n’y a pas de consensus sur ce
sujet. Les analyses sont nombreuses, diversifiées et opposées le plus souvent. C’est un peu
comme si chaque courant de pensée économique avait son explication du chômage :
néoclassique, keynésienne, structurelle (progrès technique, frictionnel et nouvelles théories...).
Cet article fait suite aux articles du 26 mai 2014 sur les chiffres et courbes du chômage et des
28 mars et 22 avril 2014 sur le fonctionnement du marché du travail (offre de travail =
demande d’emploi des travailleurs ; demande de travail = offre d’emploi des employeurs).
Il reprend pour l’essentiel, en les résumant pour les rendre aussi accessibles que possible à
tous, les principales analyses théoriques sur le chômage. Dans une première partie, nous
avions présenté l’analyse des économistes libéraux ou néoclassiques (27 janvier 2016). Dans
cette seconde partie, nous allons présenter l’analyse keynésienne totalement opposée (puis les
analyses structurelles dans un troisième temps).
I) Analyse libérale ou néoclassique du chômage
:
le salaire brut est un coût
pour l’employeur
(article du 27 janvier 2016)
II) L’analyse keynésienne : priorité à la demande globale, le salaire est un
revenu
Cette analyse domine chez les économistes keynésiens c’est-à-dire adeptes de la pensée de
John Maynard Keynes (économiste anglais, 1883-1946) tels que John Hicks, Nicolas Kaldor,
…rappelons que les keynésiens sont des macro économistes (raisonnement en terme
d’économie nationale, de circuit) qui soutiennent l’intervention de l’Etat dans l’économie. Le
livre le plus important de Keynes est « Théorie Générale de l’emploi, de l’intérêt et de la
monnaie » paru en février 1936.
A) hypothèses de départ concernant le marché du travail :
• Keynes distingue le marché des biens et le marché du travail : il les lie ; le marché du
travail dépend du marché des biens donc de la demande de biens (et services),
• Le salaire est perçu comme un revenu (et non plus un coût)
• Concurrence sur les marchés
• Loi offre-demande fonctionne partiellement sur le marché du travail (rigidité à la
baisse du salaire : syndicats ou salaire minimum)
B) Le fonctionnement du marché des biens et services et de l’économie selon Keynes ;
La demande « effective » (expression keynésienne) détermine le niveau nécessaire de
l’emploi à atteindre, donc la demande est au centre et l’emploi n’est qu’une résultante du
système.

La demande « effective » est la demande qui a des effets attendus sur l’économie (sur la
production, le revenu national). C’est le montant de la consommation et de l’investissement,
c’est-à-dire la demande interne, tels que les entrepreneurs les prévoient au moment où ils
fixent le volume de l’emploi nécessaire. Aujourd’hui, il faudrait lui ajouter les exportations
(demande externe), pour obtenir une demande globale.
Keynes : « Nous appellerons demande effective le montant du « produit » attendu D au point
de la courbe de la demande globale où elle est coupée par l’offre globale ».
(Théorie Générale p 49-50, Petite bibliothèque Payot, Paris, 1971)
Y
Demande globale
Offre globale
O
Ct
Inv
(PIB)
D
Chez Keynes, la demande précède l’offre, c’est-à-dire la production. Celle-ci, à son tour,
détermine le niveau de l’emploi à atteindre, donc les embauches à réaliser.
Schéma simplifié :
(jseco22)
Demande
de biens et
services
(consomma
tion)
Demande de
biens
d’équipement
(investissement
privé)
Demande
étrangère
(exportations)
Demande
« effective » Niveau de
la
production
à réaliser
Niveau
nécessaire
de l’emploi
Création ou
suppression
d’emplois
Niveau du
chômage

Attention, sur ce schéma n’apparaissent pas les déterminants de la consommation ni de
l’investissement chez Keynes (voir schéma final, plus bas), de même que n’apparaît pas
l’investissement public (politique de relance)
C) De quoi dépend l’offre de travail des individus ?
Offre de travail
Qté de trav
Sal
nominal
L’offre de travail est une fonction croissante du salaire, mais il y a 2 différences avec les
néoclassiques :
1) ce salaire est le salaire nominal ou courant et non le salaire réel ou déflaté de la hausse des
prix (le pouvoir d’achat). Selon Keynes, les travailleurs sont « victimes de l’illusion
monétaire » (en clair, une augmentation de quelques euros est perçue comme une bonne
augmentation alors qu’il faudrait en retirer la hausse des prix) ;
2) ce salaire est rigide à la baisse. La courbe ne descend pas continuellement. Elle s’arrête à
un palier que l’on pourrait appeler salaire minimum. Les travailleurs refusent de travailler
pour un salaire inférieur à ce niveau minimum. Les syndicats de salariés défendent cette
position.
D) De quoi dépend la demande de travail des entreprises ?

Demande de travail
Qté de
travail
Sal
réel
La demande de travail des entrepreneurs est une fonction décroissante du salaire réel, comme
dans l’analyse néoclassique. Plus le salaire est élevé et moins les entreprises embauchent et
inversement.
E) La confrontation offre –demande et le chômage « involontaire »
1) Pour Keynes, il peut y avoir un équilibre de sous-emploi sur le marché du travail tel
que :
offre = demande de travail sur ce marché avec du chômage appelé « involontaire ».
chômage
sal
Qté L
Demande de travail des
entreprises
D1
Offre de travail
des individus
chômage
ou sous-emploi
jseco22
Équilibre de sous-emploi
E1
L1 L1*
Salaire nominal

Explication : Keynes considère que le niveau de la demande « effective » de biens peut-être
tel (ci-dessous en DG1) qu’il est insuffisant pour assurer le plein-emploi sur le marché du
travail. En clair, la demande « effective » de biens et services DG1 est insuffisante, d’où la
demande de travail des entreprises est insuffisante et vient croiser l’offre de travail en E1 sur
sa portion droite, donc rigide (sur cette portion, le salaire ne baisse pas, comme chez les
néoclassiques ou libéraux). Dans cette situation, la demande de travail des entreprises est L1
alors que pour ce salaire nominal, l’offre de travail des travailleurs est L1*. Le segment L1
L1* représente du chômage.
Le chômage ou sous-emploi L1 L1* (graphique) est involontaire au sens où il est causé par
l’insuffisance de la demande sur le marché des biens. Il n’est donc pas expliqué par les
comportements sur le marché du travail, donc il n’est pas « volontaire » au sens des
néoclassiques.
Y
Demande globale
Offre globale
O
Ct
Inv
(PIB)
D1
DG1
2) Mais il peut aussi y avoir un équilibre de plein-emploi sur le marché du travail
D2
sal
Qté L
Offre de travail
des individus
Demande de travail des
entreprises
Équilibre de plein-emploi
jseco22
E2
L2 (plein-emploi)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%