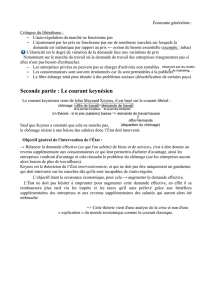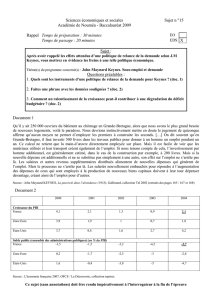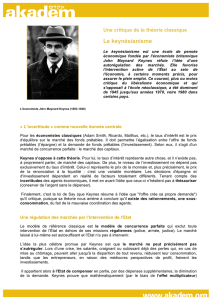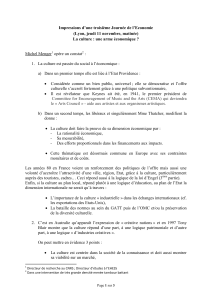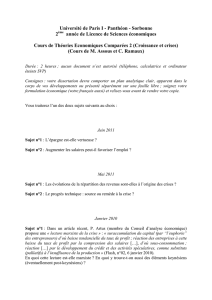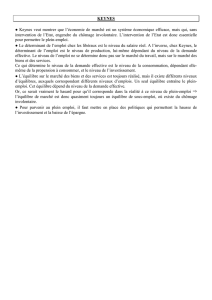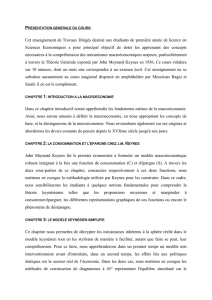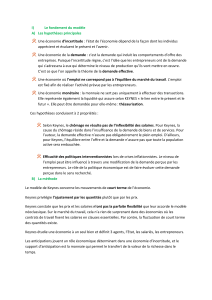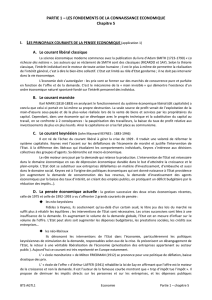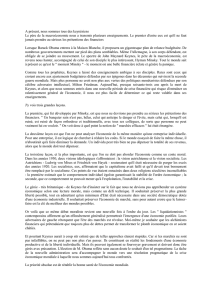Incertitude, rationalité et institution. Une lecture croisée de Keynes et

Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RECO&ID_NUMPUBLIE=RECO_592&ID_ARTICLE=RECO_592_0265
Incertitude, rationalité et institution. Une lecture croisée de Keynes et
Simon
par Nicolas POSTEL
| Presses de Sciences Po | Revue économique
2008/2 - Volume 59
ISSN 0035-2764 | ISBN 2-7246-3105-0 | pages 265 à 289
Pour citer cet article :
— Postel N., Incertitude, rationalité et institution. Une lecture croisée de Keynes et Simon, Revue économique 2008/
2, Volume 59, p. 265-289.
Distribution électronique Cairn pour les Presses de Sciences Po.
© Presses de Sciences Po. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur
en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

265
Revue économique – vol. 59, N° 2, mars 2008, p. 265-290
Incertitude, rationalité et institution
Une lecture croisée de Keynes et Simon
1Nicolas Postel*
Keynes et Simon parcourent tous deux, à cinquante années de distance, un chemin
épistémologiquement très proche. Tous deux élaborent une théorie de l’action ration-
nelle présentant des caractéristiques communes (intuitive, empirique, non calcula-
toire). Cette théorie les amène à prendre conscience du rôle des institutions sur le plan
cognitif et, partant, sur celui de la coordination. Enfin, leurs deux théories se bouclent
sur une même défense du rôle d’une certaine coercition sociale et politique, quoique
sous une forme très différente. Ce parcours parallèle nous indique la voie à suivre :
prendre davantage en compte la dimension éthique des institutions.
UNCERTAINTY, RATIONALITY AND INSTITUTION
ACROSS READING OF KEYNES AND SIMON
Keynes and Simon traverse all two, fifty year from distance, an epistemolo-
gically similar way. Both work out a theory of the rational action presenting very
closed characteristics (intuitive, empirical and in a non calculative form). This theory
leads them to become aware of the role of the institutions on the cognitive and
coordinating level. Finally their two theories insist on the needing of a certain social
and political coercion, though in a very different form. This parallel course indicates
the way to us to be followed : we have to stress the lay on the ethical dimension
of the economic institutions.
Classification JEL : B21, B 41, B50, E 12, D 81
« Agir signifie au sens le plus général prendre une
initiative, entreprendre, mettre en mouvement. […] Il
est dans la nature du commencement que débute quel-
que chose de neuf auquel on ne pouvait s’attendre. »
(A. Arendt [1961], p. 234).
Il y a dans toute prise de décision un risque qui tient au fait que l’action écono-
mique se déploie dans un environnement humain dans lequel, on le sait au moins
depuis la philosophie aristotélicienne, règne la « contingence ». L’action écono-
mique se déploie en effet dans le cadre d’une pluralité d’actions et d’acteurs
* Université Lille1 et clerse (umr 8019 cnrs). Correspondance : ustl (Lille 1), Faculté des Scien-
ces économiques et sociales, 59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex. Courriel : nicolas.postel@univ-lille1.fr
L’auteur remercie les deux referees anonymes de la Revue économique, dont les remarques ont
permis d’améliorer nettement la clarté et la lisibilité du texte. Nous remercions aussi pour leurs criti-
ques et commentaires : Arnaud Berthoud, Oliver Favereau, Étienne Farvaque et Benoît Lengaigne.
Nous restons évidemment seul responsable du contenu de cet article.

Revue économique
266
Revue économique – vol. 59, N° 2, mars 2008, p. 265-290
qui interagissent, tant et si bien que les conséquences de notre acte dépendent
essentiellement de la manière dont les autres acteurs réagiront à cet acte1. Si l’on
s’accorde sur le fait que chacune de ces réactions (qui s’insèrent dans l’action
mise en œuvre par chacun des acteurs, actions que l’on ne connaît pas lorsque
l’on décide d’agir) est en elle-même imprévisible, on admettra aussi qu’a priori
l’ensemble de ces réactions l’est davantage. Autrement dit, lorsqu’on agit, c’est-
à-dire lorsque les actes que l’on entreprend se déploient dans la pluralité humaine,
on ne peut pas connaître avec certitude les conséquences de nos actes.
Partant de ce constat, John Maynard Keynes et Herbert Alexander Simon ont
cherché tous deux à bâtir une théorie économique fondée sur l’existence d’une
incertitude non calculable limitant toute possibilité de prévision. On peut les
ranger dans le camp des théoriciens de l’incertitude radicale, même si l’adjectif
radical dramatise inutilement une situation inhérente à la condition humaine et
qui n’est donc en rien extrême ou exceptionnelle. Tous deux ont l’ambition de
proposer une théorie générale du comportement économique, et il leur paraît
indispensable de construire une représentation générale de l’action économi-
que qui se déroule dans un environnement contingent pour asseoir une science
économique « empiriquement fondée » (Simon [1997]). Cette théorie générale
n’exclut pas bien sûr que certaines décisions puissent être prises dans un cadre
simplifié où seul le risque probabilisable (même subjectivement), voire la certi-
tude, demeure. Mais ils récusent tout à fait qu’une théorie puisse se déployer en
prenant ces situations qu’ils considèrent exceptionnelles comme étant la règle.
En cela ils s’opposent aux théoriciens tenants de la maximisation de l’utilité
espérée, héritiers de Ramsey [1926], auquel s’opposa fermement Keynes [1931],
et de Savage [1954], auquel s’oppose fermement Simon ([1983], p. 12-17)2.
En théoriciens conséquents, Keynes et Simon cherchent donc d’emblée à défi-
nir la rationalité du comportement économique des individus en présence d’incer-
titude. Ils ne disposent pas d’une définition de la rationalité qui serait forgée pour
un contexte (non humain) de certitude avant d’être appliquée au contexte (humain)
contingent. Cette démarche qui leur est, à près de cinquante années de distance,
commune, est souvent associée à l’expression « rationalité limitée », expression
fautive en ce qu’elle prend encore comme étalon de la rationalité le principe de
la maximisation qui ne fonctionne que dans les situations exceptionnelles car
dépourvues d’incertitude. Sur la base de cette représentation du comportement
humain, et de la condition humaine, ils élaborent deux théories de l’institution qui
présentent des caractéristiques et, selon nous, des limites étonnamment proches.
Cet article défend donc la thèse selon laquelle ces deux auteurs partagent,
au fond, une conception très similaire de la rationalité (I). Cette manière de
concevoir la rationalité économique les amène tous deux à mettre en évidence
la nécessité des institutions collectives qui guident le comportement individuel
et pallient les lacunes cognitives des individus (II). Cette manière commune
d’introduire l’institution collective comme correctif aux défauts de coordination
1. En logique modale, « contingent » est le contraire de « nécessaire » : c’est ce donc qui peut
se produire ou pas. Cette opposition permet de bien mettre en évidence ce qui signe pour Aristote
la spécificité de l’environnement humain : ce qui s’y produit est l’effet conjugué d’actions libres
des humains, et non pas le produit d’une contrainte transcendante qui supposerait que les choses ne
puissent être autrement qu’elles sont. Pour une présentation limpide de cette idée, on peut se reporter
à l’étude désormais classique d’Aubenque [1976].
2. Dans l’ensemble du texte, les numéros de page indiqués renvoient, lorsqu’elle existe, à la
traduction française indiquée en bibliographie.

Nicolas Postel
267
Revue économique – vol. 59, N° 2, mars 2008, p. 265-290
et de rationalité des individus débouche sur une théorie coercitive et fonctionna-
liste de l’institution que les auteurs ne questionnent pas suffisamment (III).
Retrouver cette communauté d’esprit entre Keynes et Simon permet ainsi de
mieux identifier ce lien essentiel entre contingence, institution et coercition et
par là même de mieux le questionner.
RATIONALITÉ
« Seule la peur de commettre un énorme anachronisme me retient d’affirmer
que Keynes est le véritable instigateur de l’économie de la rationalité limitée. »
(Simon [1997], p. 16.)
Keynes expose ses conceptions en matière de rationalité individuelle dans le
Treatise on Probability qui est rédigé en 1904 mais publié en 1921. Cet ouvrage sur
les probabilités est plus largement l’occasion pour Keynes d’exposer ce qu’il pense du
raisonnement rationnel en général. Il est frappant de constater à quel point les thèses
que Simon [1947] commence à développer de manière parfaitement indépendante,
une quarantaine d’années après Keynes, sont extrêmement proches de celles de ce
dernier (même si seule cette très tardive et unique citation en atteste explicitement).
L’approche de Keynes
Le Treatise on Probability est un ouvrage philosophique qui vise à donner un
fondement logique au jugement de probabilité, même et surtout lorsqu’il ne prend
pas la forme d’un calcul. Le projet de Keynes s’inscrit en cela dans le mouve-
ment des tentatives menées à Cambridge, notamment par Russell, pour donner un
fondement logique aux mathématiques1. De ce fait, comme le souligne O’Donnel
([1989], p. 31), le livre de Keynes « aurait tout aussi bien pu être titré Traité sur la
logique ou Traité sur la raison plutôt que de recevoir le titre trompeur de Traité sur
les probabilités ». Keynes désigne en effet par probabilité toute la connaissance
que l’on n’obtient pas directement mais indirectement, c’est-à-dire par raisonne-
ment logique : « Il y a une partie de notre connaissance que nous obtenons directe-
ment, et une autre partie que nous approchons par le raisonnement. La théorie des
probabilités concerne cette forme de connaissance que nous obtenons par le raison-
nement. » ([1921], p. 3.) Dans cette optique, son Treatise vise à définir les critères
inductifs et déductifs permettant de qualifier de rationnelle une décision fondée
sur des connaissances indirectes. Il expose donc une véritable théorie générale du
comportement rationnel, plutôt qu’une stricte théorie des probabilités.
Dans une optique très proche des théoriciens du cercle de Vienne2, Keynes
suppose que la rationalité procède d’un jugement de validité sur la relation
qui unit un ensemble de prémisses, connues avec certitude, et un ensemble de
1. Keynes, dans sa préface, place son Treatise sous la double influence de Moore et Russell.
2. On désigne par l’expression « théoriciens du cercle de Vienne » les participants à un groupe
de recherche, regroupés initialement autour de Verner Schlick. Ce groupe a été rendu célèbre et
identifié comme une véritable école de pensée à partir de la parution en 1929 du « manifeste du cercle
de Vienne » rédigé par Carnap, Neurath, Hahn qui y exposent une conception scientifique du monde
et jette les bases de l’empirisme logique.

Revue économique
268
Revue économique – vol. 59, N° 2, mars 2008, p. 265-290
conséquences de ces prémisses, qui sont, elles, seulement probables. Le jugement
de rationalité est alors : « le degré de croyance qu’il est raisonnable d’entretenir
[en cette relation] dans des conditions données » ([1921], p. 4). Ainsi, on juge de
la possibilité de la pluie à partir de notre observation des nuages effectivement
présents, et notre caractère raisonnable tient à notre capacité à bien juger de la
relation logique qui unit la présence de ces nuages à la possibilité de la pluie1.
Ce jugement est bien sûr fondamentalement incertain : (1) l’ensemble d’infor-
mations n’est jamais exhaustif (on peut n’avoir pas perçu l’existence d’un vent
fort) ; (2) l’existence d’une relation logique entre données présentes et événe-
ment futur peut n’avoir pas été perçue par l’acteur (on peut ne pas avoir perçu que
le vent fort allait chasser les nuages et donc la pluie selon une relation de cause à
effet) ; (3) le savoir présent peut perdre de sa pertinence dans le monde futur (un
brusque et imprévisible refroidissement peut transformer la pluie en neige).
Cette conceptualisation du jugement rationnel permet à Keynes de mettre
l’accent sur le processus délibératif qui permet à l’acteur rationnel de juger du
degré de crédibilité des informations dont il dispose concernant l’avenir. Pour
Keynes, le jugement de probabilité est de nature pratique : il repose sur la capacité
des individus à percevoir, dans la réalité qui les entoure, les relations logiques
qui unissent les événements présents aux événements futurs possibles et à juger
du degré de possibilité qu’ont ces relations logiques « possibles » de s’actualiser
effectivement. Il dépend donc des connaissances concrètes de l’acteur autant
que de ses capacités déductives. C’est la raison pour laquelle les probabilités
ne peuvent que rarement prendre une forme mathématique. La rationalité n’est
donc pas purement calculatoire. Elle dépend des facultés pratiques de l’acteur,
de sa capacité à percevoir les informations pertinentes sur le plan empirique et
à avoir l’intuition des enchaînements logiques qui peuvent unir les éléments
dont il a connaissance. Non calculatoire, empirique, intuitive : ces trois grands
aspects de la logique keynésienne définissent une forme de rationalité distincte
de la rationalité standard2.
La rationalité individuelle selon Keynes est non calculatoire, contrairement
à ce que suppose le principe de la maximisation de l’utilité espérée que Keynes
rejette absolument (voir, par exemple, Keynes [1937], p. 112). Cette impossibilité
de donner une représentation calculatoire du mode de raisonnement individuel
est une conséquence de l’impossibilité de disposer d’une approche calculable
de l’avenir (c’est-à-dire des « probabilités »). Selon Keynes, en effet, les deux
grandes approches calculables de Laplace (approche mathématique) et de Venn
(approche fréquentiste) sont toutes deux partielles.
Keynes reproche à Laplace de faire primer le caractère mathématique de la
prise de décision rationnelle sur sa dimension empirique. Il récuse en particulier
l’axiome d’équiprobabilité des différentes occurrences possibles, qui est la base
de l’analyse laplacienne du jugement de probabilité : n événements doivent
être dits « équiprobables » lorsqu’il n’existe aucune information permettant de
1. Formellement, la théorie keynésienne prend la forme suivante : « Supposons que nos prémis-
ses représentent un ensemble de propositions h, et que nos conclusions constituent un autre ensemble
de propositions a, alors, si notre connaissance de h justifie une croyance rationnelle en a de degré α,
nous disons qu’il existe une relation de probabilité de degré α entre a et h. Cela s’écrit : a/h = α. »
(Keynes [1921], p. 4.)
2. Dostaler et Jobin [2000] mettent particulièrement clairement en évidence la dimension
intuitive de la prise de décision chez Keynes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%